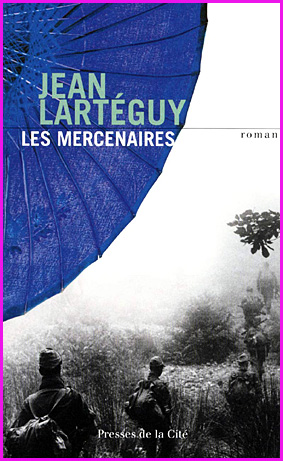
Jean Lartéguy est né Lucien Pierre Jean Osty en 1920 et mort en 2011 à 90 ans. Il passe son enfance en Lozère, comme son héros, Pierre Lirelou ; comme lui il a un oncle prêtre, le chanoine Osty. Mais, au lieu de se faire curé, il passe sa licence d’histoire à Toulouse et s’engage à 19 ans en 1939 pour faire la « drôle de guerre » et de s’évader en 1942 pour devenir commando d’Afrique. Son Pierre envoie le froc aux orties à 17 ans pour baiser une gitane à qui il laisse « un fils » et partir s’engager chez les anti-franquistes en Espagne avant de faire le maquis et de s’engager dans l’armée Leclerc. C’est dire combien Les mercenaires sont inspirés de ce qu’a vécu l’auteur ou des personnages qu’il a rencontrés. Il est la réédition remaniée de son premier roman, Du sang sur les collines, passé inaperçu parce qu’il évoquait la guerre de Corée. Après le succès des Centurions, l’auteur a décliné les thèmes des Prétoriens puis des Mercenaires.
Ce ne sont pas des vendus au plus offrant ni des avides de gloire, à cette époque, mais des romantiques égarés dans le siècle. Imaginez une France frileuse, pacifiste après la Grande guerre (la plus con, celle de 14), sa démographie en berne à cause des classes creuses, le moral au plus bas face aux pouvoirs autoritaires qui l’entourent de plus en plus (Mussolini, Hitler, Staline, Franco), et empêtrée dans son parlementarisme de petits intérêts de petits partis, sans chef qui s’impose, ni projet politique. Tiens ! Cela vous dit quelque chose de notre époque ? Eh oui, si l’histoire ne se répète jamais, elle bégaie. Reviennent les idées des années 30…
Ces jeunes hommes écœurés de leur patrie, trop vieille et rassie,« combattent de 20 à 30 ans pour refaire le monde », dit l’auteur, avant de se ranger et de faire des enfants, s’ils ne sont pas tués. Lartéguy aura deux filles, Ariane et Diane. Pierre aura deux enfants, d’une juive israélienne qui bâtit son pays, et d’une congaï vietnamienne qui tente de construire un régime non colonial et non communiste. Mais, engagé dans le Bataillon français de Corée, il semble qu’il n’y survivra pas. C’est que la France a connu la guerre, sans interruption, de 1939 à 1962 avec la Défaite, la Résistance, l’Allemagne, l’Indochine, la Corée, l’Algérie. Ce pourquoi les années 60 enfin de paix retrouvée ont semblé un âge d’or, avec un chef légitime (de Gaulle), un plan économique, une monnaie stabilisée, une croissance forte (jusqu’à 7 % par an). Cet optimisme s’est manifesté par la natalité et l’ascension sociale. Jusqu’à ce que les crises du pétrole (1973 et 1979), puis les illusions de la gauche (trois dévaluations du franc de 1981 à 1983) cassent l’optimisme. Depuis, les Français vivent « en crise » permanente, d’où leur pessimisme, leur déclinisme, leur repli. Une atmosphère d’année 1940.
L’intérêt de relire Les mercenaires est de retrouver cette énergie de jeunesse, ces garçons qui partent combattre à 17 ans, ces lieutenants de 22 ans qui prennent avec leur section une ville entière, comme « M. » pour Lirelou, ces commandos entraîneurs d’hommes parce qu’ils les aiment. Si tous les personnages sont imaginaires dans ce roman, ils sont tous « vrais », car ce sont des types d’homme que l’on peut reconnaître dans la réalité. Tous différents, tous attirés par la guerre comme aventure, poursuite d’un rêve, surtout de camaraderie virile. Le médecin-capitaine Martin-Janet qui a quitté le confort de sa bibliothèque et de son cabinet parisien prospère pour faire ce qu’on n’appelle pas encore de « l’humanitaire », mais du soin aux blessés de toutes nations. Le capitaine Sabatier et le seconde classe « l’ignoble Bertagna ». Le capitaine Lirelou, après des « affaires » en Iran pour le lobby du pétrole, passé en Indochine où il a pacifié la plaine des Joncs avec le pirate Nguyen van Ty. Le lieutenant Dimitriev, fils de Russe blanc émigré en France, qui a trahi sans le savoir des résistants avant de tuer l’indicateur collabo et de s’engager dans l’armée d’Afrique. Le lieutenant Rebuffal, réserviste rengagé, aspirant débandé par la défaite de 40, blessé et soigné par la Wehrmacht. Le lieutenant Ruquerolles, Normale Sup, débandé lui aussi en 40 : « Tout un pays qui foutait le camp avec ses généraux, ses pompiers, ses ministres et ses catins. Une journée entière, je les ai regardés passer ; j’en étais soufflé. » Le sergent-chef Andreani, un Corse à l’oncle dans le Milieu marseillais, amoureux de sa femme Maria, à qui il dédie son héroïsme : il veut une médaille américaine pour pouvoir y émigrer. Et puis il y a le seconde classe Maurel, en réalité le lieutenant Jacques de Morfault, engagé dans la LVF (Légion des volontaires français contre le bolchevisme) après l’amère défaite de 40. « À cause de son nom, celui d’une des plus grandes familles huguenotes de France, de sa beauté, on en fit un officier après un stage rapide. La revueSignal publia la photo du nouvel archange de la collaboration sous le casque d’acier. »
Jean Lartéguy, laissé de côté par la mode intello parce qu’il était anticommuniste (donc du côté du « diable »), a été apprécié depuis sa mort par les généraux américains : son expérience de l’Indochine puis de l’Algérie a inspiré les techniques de contre-insurrection. Elles auraient permis de pacifier l’Irak si elles avaient été appliquées… mais voilà : l’arrogance yankee n’a que faire de la façon humaine de voir des Européens. A la psychologie et à la politique, elle préfère la technique, l’industrie ; les soldats ne sont pour eux que des robots efficaces, sans état d’âme. Dans le roman, le général US Crandall, en Corée, est de ceux-là : il n’hésite pas à sacrifier 1500 hommes pour prendre aux Chinois une série de collines qui l’ont séduites par sa beauté, les White Hills – pour rien. Ce n’était ni stratégique, ni nécessaire.
« Je crois même que je n’aime pas du tout la guerre » dit Lirelou à Dimitriev. « Mais elle crée parfois un certain climat dans lequel tout ce qui paraissait impossible devient soudain réalisable. Elle seule arrive parfois à ressembler un peu à ces rêves que l’on porte en soi depuis l’enfance : l’île déserte, la conquête d’un royaume. (…)Le mercenaire, c’est peut-être un type qui se bat pour un rêve qui l’a fait étant gosse ou qu’il a déniché dans quelque vieux roman d’aventure »
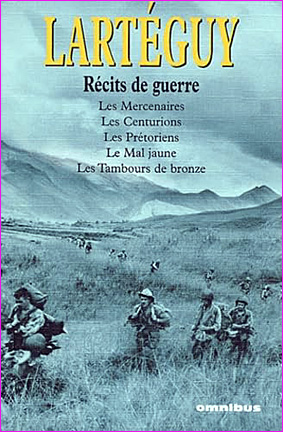
Jean Lartéguy, Les mercenaires (réédition remaniée 1960 Du sang sur les collines paru en 1954), Presses de la Cité 2012, 442 pages, occasion vintage hors de prix pour fana mili…
Jean Lértéguy, Les Mercenaires, Les Centurions, Les Prétoriens, Le Mal jaune, Les Tambours de bronze, Omnibus 2004, 1411 pages, €69,90
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

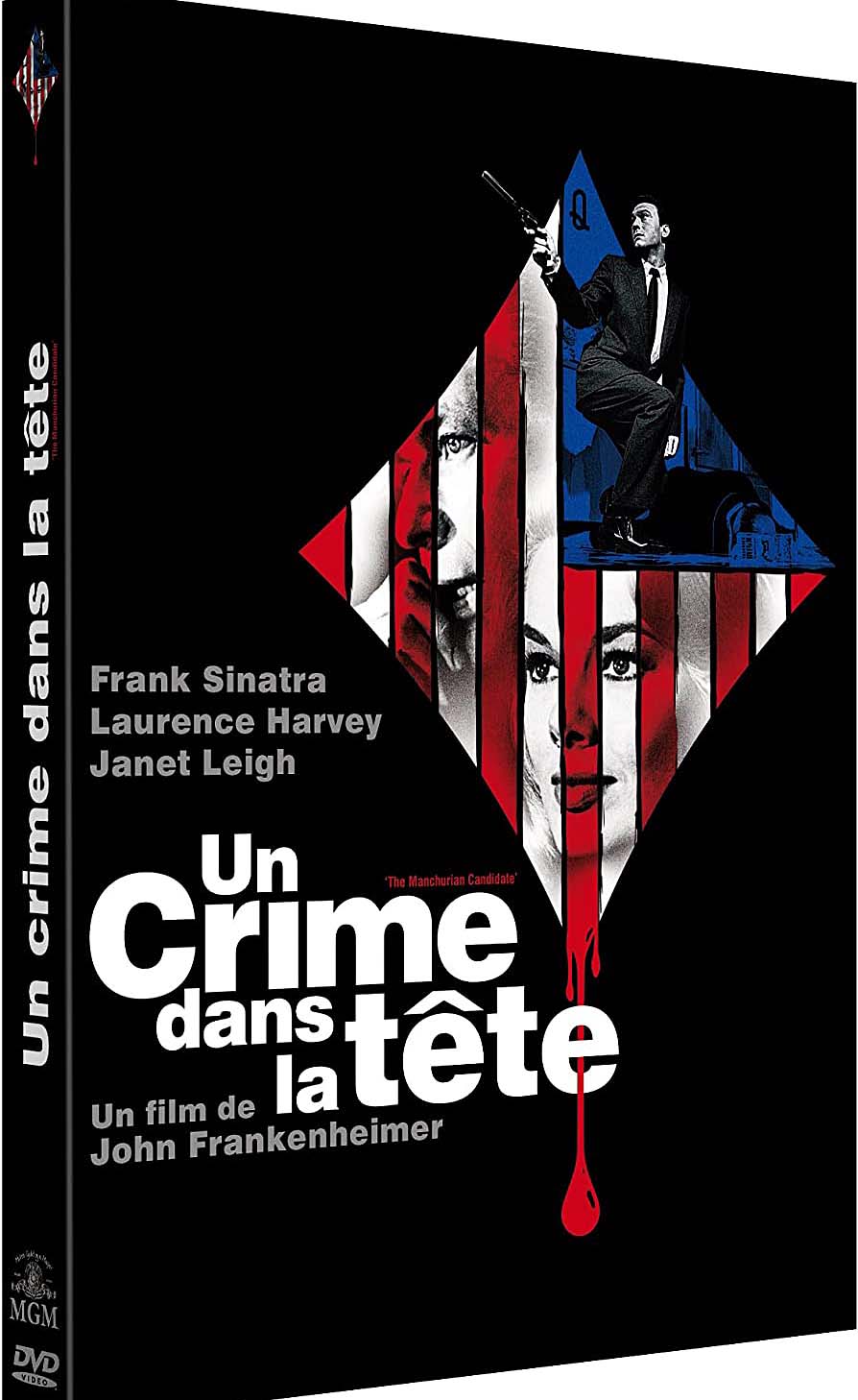








Commentaires récents