En ce dernier matin du dernier jour, nous visitons la ville. Dès 9h30, nous partons pour longer la mer et passer devant les cabines de bain alignées sagement sur la jetée parfois fortement battue par les embruns. Des sauveteurs en mer, dont le bureau se trouve là, sont déjà en slip et testent la fraîcheur de l’eau comme entraînement.
Nous montons les marches vers la villa rose aux entourages bordeaux de Christian Dior Les Rhumbs (secteurs de la rose des vents) et son jardin, rachetés par la Mairie et devenus publics. La pergola offre une belle vue sur le large du haut de la falaise, la roseraie embaume.
Un buste de Christian Dior (1905-1957) donne un air lunaire à la tête de l’artiste, reflétant probablement l’essentiel de son caractère. Elevé ici, fils d’industriel chimiste à la production puante, l’enfant a pu observer les mille nuances de gris du ciel et de la mer avant de les reproduire sur les robes, et sentir les mille parfums des roses et autres fleurs avant de renverser le préjugé sur son nom. Auparavant en effet, les engrais du père faisaient dire « ça pue le Dior » ; avec les parfums que Christian a créés, nul ne le peut plus.
Deux photos affichées dans les jardins montrent l’enfant à 9 ans pour la première communion en 1914, l’air ahuri, et à 7 ans en 1911, nettement plus tendre et mignon.
Nous poursuivons par les rues intérieures, le stade et un petit parc zoologique, avant d’aborder le marché couvert. Il est plein et bruyant, les paysans locaux viennent y proposer leurs produits comme au bon vieux temps, mais aussi des artisans.
Nous passons ensuite à la ville haute – et il faut encore monter, ce qui éprouve les genoux. Nous prenons les escaliers près du casino pour atteindre le blockhaus dont les canons commandaient les deux directions du nord et du sud. S’ouvre le musée d’art moderne Richard Anacréon, collectionneur de Granville et libraire à Paris qui a légué ses peintures et ses livres rares à la ville. Nous ne le visitons pas, faute de temps et parce qu’il est souvent vrai qu’un musée du lard moderne est empli de cochonneries.
Les rues bourgeoises sont serrées et austères, comprenant de vieilles maisons de pierre grise dont une date de 1621 avec Adam et Eve sculptés. L’église Notre-Dame domine depuis le XVe siècle tout en granit. L’intérieur est sombre bien que des vitraux des années 1950 par Jacques Le Chevalier tentent d’égayer le chœur.
Les anges de l’autel, roses et dorés, se pâment la main sur le sein ou le téton pointant vers le fidèle en guise de délice pâtissier promis dans l’au-delà. Leur attitude langoureuse, leur longue chevelure, leur costume doré qui découvre la moitié de la poitrine, sont destinés plus à la sensualité des prêtres qu’à l’édification des fidèles. La chair est trop présente pour évoquer les purs esprits célestes…
Une plaque sur une maison de la haute ville rappelle que le prince de Monaco est descendant des Matignon, gouverneurs de Grandville de 1578 à 1790. Il a été reçu ici le 15 juin 2015. La rue Lecarpentier, qui domine le port et la rue des Juifs, donne une vue étendue sur les toits qui rappelle Paris, si ce n’est la mer.
Les adieux sont rapides, chacun est mal garé, doit retrouver sa voiture et quitter la ville avant les restrictions de circulation de la parade du Débarquement. Je mets six heures pour revenir, devant faire un détour pour route barrée avant Argentan.
FIN du voyage en Normandie















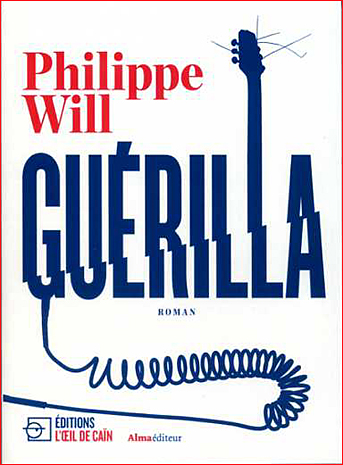
Commentaires récents