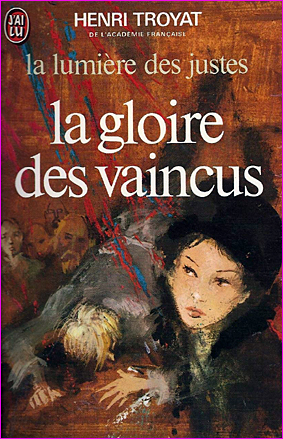
Chaque tome peut se lire indépendamment, même si les cinq volumes forment un cycle romanesque.
Dans celui-ci, nous suivons Nicolas, 31 ans, qui tente un coup d’État avec ses amis nobles de Saint-Pétersbourg, lors de la transition du trône après la mort d’Alexandre 1er en décembre 1824. Ces révoltés seront dès lors nommés les Décembristes. Les jeunes nobles sont pour Constantin, mais celui-ci a décliné la couronne impériale. C’est Nicolas qui va l’endosser et devenir Nicolas 1er. Les conjurés, idéalistes, mal préparés et toujours respectueux du tsar, lieutenant de Dieu sur la terre, hésitent, bafouillent, brouillonnent, ne peuvent se décider.
Ils sont bientôt encerclés sur la place du Sénat, face au palais, sans avoir rien fait. Les régiments restés fidèles au serment les encerclent et ils sont sommés de se rendre. Par bravade stupide, ils n’en font rien. Les canons tirent, les chevaux les enfoncent, ils sont sabrés. Peu en réchappent. Les meneurs sont condamnés à être pendus, les autres répartis en plusieurs groupes selon l’importance de leur faute. Nicolas est condamné au bagne, 12 ans, puis à la relégation, après déchéance de tous ses titres et confiscation de tous ses biens.
Il est amer, mais se tient. Il a voulu la liberté, cherché à imposer la monarchie constitutionnelle plutôt que l’autocratie absolue. Sa femme, Sophie, est française. Il l’a rencontrée à Paris à 20 ans, lorsque les Russes ont envahi Paris le 19 mars 1814 – il y a 210 ans – et qu’il était l’un de leurs officiers. Sophie lui a appris les Lumières et la valeur des libertés. Il ne conçoit désormais plus qu’un peuple puisse s’en passer. Et pourtant… Le peuple russe est habitué au servage depuis les Mongols et même avant ; il ne veut rien, ne rien décider, toujours obéir – c’est plus sécurisant de n’avoir jamais à prendre aucune décision mais d’attendre les ordres. Ceux venus de Dieu, ceux venus du tsar, ceux venus du barine.
Henri Troyat écrit sur la Russie d’il y a deux siècles, mais on croirait qu’il évoque celle d’aujourd’hui : « Chez nous, [le Russe] accepte l’épreuve comme un signe de la colère de Dieu. Plus le coup est inattendu et douloureux, plus il lui semble venir de haut. L’autocratie finit par trouver sa justification dans l’iniquité même de ces actes. Des siècles de soumission forcée nous ont préparé à cela. Ne sommes-nous pas fils d’une nation qui a connu la domination des Varègues, des Tartares, le joug d’Ivan le Terrible, la poigne de Pierre l le Grand ? Que nous le voulions ou non, nous avons tous un respect atavique du pouvoir » p.139.
La version noire est celle du tsar, « petit père des peuples » implacable et vengeur, ou du père de Nicolas, autocrate égoïste et borné. La version rose est celle de Nikita, le fidèle serf de Nicolas, qui se mettra au service de Sophie lorsqu’elle rejoindra son mari dans l’Extrême-orient sibérien. Beau, grand blond, musclé, candide, il tombe amoureux d’elle, elle le sent. Mais si elle est sensible à la sensualité du corps du jeune homme, elle n’aime que son mari prisonnier. Nikita, par une intrigue du beau-père puis du général donnant les autorisations de voyager, sera privé de passeport ; il enfreindra l’interdiction pour se lancer à la poursuite de la barynia afin de la protéger, d’être auprès d’elle. Il se fera prendre, sabrera un policier, et périra sous le knout qui lacère les chairs, avant le centième coup.
L’autocratie, la mise à mort des opposants, le goulag pour les réfractaires, le peuple ignorant et servile, c’était la Russie des tsars, ce fut celle de Staline, c’est encore celle de Poutine. La liberté ? C’est l’esclavage – Orwell n’aurait pas dit mieux : « Une révolution ne peut réussir sans l’appui du peuple et de l’armée. Or, ni l’un ni l’autre, en Russie, n’était préparé à comprendre le sens de la liberté et à lutter pour elle. Il aurait fallu éduquer les masses, les éveiller, les former, avant de passer à l’attaque » p.182.
Après des mois de forteresse en attente de son jugement, Nicolas est déporté au goulag des tsars, dans la lointaine Sibérie, à Tchita, à l’est du lac Baïkal, à 6200 km de Moscou. Il ne sera jamais autorisé à revenir.
Henri Troyat, La gloire des vaincus – La lumière des justes III, 1959, Folio 1999, 375 pages, occasion €2,32
Henri Troyat, La lumière des justes (5 tomes : Les compagnons du coquelicot, La barynia, La gloire des vaincus, Les dames de Sibérie, Sophie ou la fin des combats), Omnibus 2011, 1184 pages, €21,61
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)







Commentaires récents