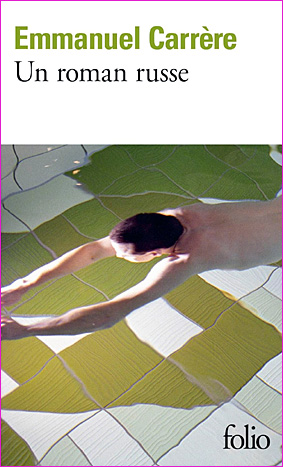
Emmanuel Carrère, fils de, est médiatique parce qu’il mêle, selon le gloubi-boulga de notre époque, tous les genres : le roman, le cinéma, le reportage, la vie intime, et surtout le sexe. C’est un genre qui me déconcerte et ne m’agrée pas, une façon de se défiler tout en se glorifiant, de zapper sur ce qui dérange pour insister sur ce qui est soi-disant « secret » et que tout le monde connaît : l’Origine du monde.
Dans cette histoire, la Russie est un prétexte, un pays et une origine qui font problème à cet angoissé instable, névrosé profond qui avoue aller « trois fois par semaine » chez son psychanalyste, on ne sait pour quel résultat… Le prétexte est le surgissement dans l’actualité d’Andras Toma, paysan hongrois enrôlé dans les forces fascistes puis capturé par l’Armée rouge en 1944. Ballotté de camp en camp, il échoue interné pendant cinquante-six ans en URSS, dernier prisonnier vivant de la Seconde guerre mondiale, avant d’être finalement rapatrié à Budapest en 2000. Il était fou, ou jouait les fous, n’ayant peut-être jamais appris le russe, recroquevillé dans sa coquille.
Cet Andras a fasciné Carrère, envoyé « spécial » de France 2 pour un documentaire sur lui, sur le village de Kotelnitch à 800 km au nord-est de Moscou. L’arrière grand-oncle de l’auteur a été gouverneur de la région et Emmanuel, qui parle « un joli russe » appris de sa mère mais ne le parle plus depuis l’âge de 5 ans, entreprend laborieusement à 40 ans de s’y remettre. C’est qu’il se sent personnellement des affinités électives avec Andras, ce décalé de la vie, exilé de sa patrie, renfermé dans son monde imaginaire. Comme lui, incapable de se fixer, Carrère erre de femme en femme en croyant toujours vivre le grand amour de sa vie (qu’il confond avec le sexe frénétique) avant de déchanter sous les assauts de la triste réalité. Ce sera « Soso » après une précédente qui lui a donné deux fils, puis Hélène qui lui donnera une fille. Mais, à chaque fois, il s’en sépare.
Des affinités aussi que son grand-père Georges a vécues, émigré de Géorgie en 1920 après la révolution de 1917 et la reprise en main par Lénine de toute la Russie, y compris les provinces dissidentes qui se croyaient émancipées par le communisme. Un grand-père qui avait des idées de droite conservatrice radicale et qui a collaboré avec l’armée allemande en servant de traducteur économique à Bordeaux durant la guerre. Il a « disparu » en 1944, probablement exécuté par les résistants de la dernière heure : un bouc émissaire facile, « étranger » d’origine, inapte à tout métier, pauvre et perdu dans sa nouvelle patrie. Un « secret de famille » bien gardé par sa mère, l’Immortelle Hélène Carrère d’Encausse qui ne voulait pas entacher sa réputation (bien que responsable en rien des faits et gestes de son père). Secret qu’Emmanuel s’empresse de divulguer, pour se faire bien voir ou plutôt, croit-il, pour exister.
Ce « roman » russe est une sorte de Romand Jean-Claude, un récit qu’il a écrit en 2000 sur le massacreur de toute sa famille qui se faisait passer pour médecin important de l’OMS à Genève. Encore un mythomane, comme lui. Il mélange à la Philippe Sollers, qui semble son modèle d’écrivain dans les années 2000, le documentaire télé, ses notes et impressions de voyage, ses observations sur les gens, ses fantasmes érotiques et les petites histoires qu’il échafaude à partir de rien, son expérience in vivo de nouvelle érotique écrite en 2002 dans Le Monde, journal de référence politiquement correcte des bobos. L’Usage du Monde met en scène (beaucoup trop longuement, dans une complaisance destructrice) la Soso nue sous sa robe légère dans un train à grande vitesse tandis que l’auteur joue de l’érotisme des suggestions et des mots dans un délire pubertaire. Il détruire ce désir, comme les autres, dans un délire paranoïaque de haine au téléphone, poussant ladite Soso à se faire avorter… d’un bébé qui n’était d’ailleurs pas de lui !
Autant j’ai aimé et admiré sa mère Hélène, autant je n’aime pas Emmanuel Carrère. Son tempérament angoissé, dépressif, cyclothymique, égocentrique, me déplaît. Or un écrivain est avant tout un tempérament, quoiqu’il écrive. Sa névrose obsessionnelle le hante et il s’y complaît, il en fait des livres. Incapable au fond d’inventer, il ne cesse de mettre en scène lui-même au travers de personnages réels : un pédophile dans La classe de neige qu’il avoue avoir mis « sept ans à écrire », le tueur faux médecin Romand dans L’adversaire, les apôtres dans Le Royaume.
Emmanuel Carrère se sent toujours un autre, tout en ne se croyant pas grand-chose. Il cherche constamment, névrotiquement, le « secret » qui lui permettrait de revivre, la clé pour se libérer d’un inconscient qu’il traîne comme un boulet. Il la voit dans l’emprisonnement d’Andras, dans la vie étriquée à la soviétique de la Russie des années 2000 avec sa pauvreté, ses non-dits, ses mafias qui tuent, son FSB qui contrôle ; il la voit dans la langue russe qui lui permettrait de « comprendre » – quoi ? Son grand-père conservateur égaré ? Sa névrose d’émigré jamais pleinement intégré à ses yeux ? Sa fascination fusionnelle pour sa mère devenue immortelle ? Il la voit dans le secret du pédophile, le mensonge jusqu’au meurtre de Romand, la répulsion des femmes de Paul de Tarse. Il la voit dans la croyance chrétienne, dans le yoga pratique, dans les reportages au loin, dans l’exil intérieur, dans l’éternel nombrilisme de son écriture…
Bref, lisez-le si vous voulez, il paraît que ça plaît aux ménagères de 50 ans fascinés par les grands malades et qui adorent discuter intello en médiathèque. Pour ma part, je ne le relirai pas, ce qui est mon critère de qualité des livres.
Emmanuel Carrère, Un roman russe, 2007, Folio 2009, 401 pages, €9,90 e-book Kindle €8,49
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)






Commentaires récents