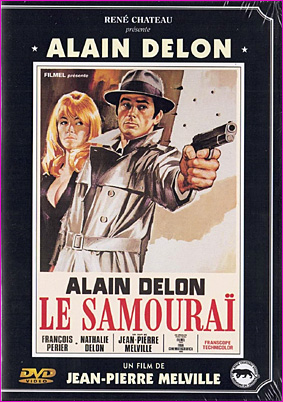
L’un des meilleurs films avec Alain Delon dans toute sa gloire, avec La Piscine et Plein soleil. C’est une tragédie de la solitude, une fois de plus, l’éternel replay à la Ripley de l’abandon dans l’enfance. Le samouraï est un être implacable, sans affect, un tueur à gage. Il opère avec minutie, couvrant ses arrières, se fabriquant un alibi. Il séduit les femmes qu’il utilise mais ne les aime pas. Il est seul et solitaire, avec pour seul compagnon un oiseau.
A Jeff Costello (Alain Delon), le professionnel, est confié un contrat sur la tête d’un patron de boite de nuit parisienne. Il l’exécute. Il vole une voiture, une DS Citroën dont il a tout un jeu de clés de contact du modèle et dont il va faire changer les plaques à Montreuil. Sa maîtresse Jane (Nathalie Delon), lui fournit un alibi pour l’heure de la mort, une table de jeu privée un autre. Mais il est reconnu dans le couloir de la boite par la pianiste Valérie (Cathy Rosier), une métisse de Martinique, qui le voit clairement à moins d’un mètre, tandis que les serveurs ne l’aperçoivent qu’en silhouette en imperméable mastic et chapeau sur les yeux.


Curieusement, Jeff ne se débarrasse pas de ce déguisement reconnaissable, qui fournit le portrait-robot des témoins, ce qui serait la moindre des choses. Aussi, quand les flics qui sont en nombre à l’époque raflent tout ce qui porte chapeau et imper dans Paris la nuit, il est du lot. Parmi les quatre cents suspects, quelques-uns sont retenus, dont lui, bien qu’il se soit débarrassé de l’arme et des gants qu’il portait. Les alibis tiennent, les témoignages sont contradictoires, sauf celui de la fille du couloir et celui du « fiancé » en titre de Jane (Michel Boisrond). La première affirme que ce n’est pas lui qu’elle a vu, le second affirme que c’est bien lui qu’il a aperçu. Pas lui dans le couloir de la boite de nuit où le crime a eu lieu ; lui dans l’entrée de l’immeuble de son alibi.
Jeff Costello est donc relâché. Mais le commissaire qui a du nez (François Périer) sent que quelque chose ne tourne pas rond. Selon les méthodes autoritaires et quasi fascistes de l’époque, il va donc faire pression sur les témoins pour qu’ils revoient leurs témoignages, et va faire suivre Costello où qu’il aille. Pas difficile semble-t-il de savoir où il habite ; un gros micro d’époque est donc posé chez lui, qu’un flic va écouter dans l’hôtel en face. Sauf que l’oiseau en cage (un bouvreuil) est agité et que le samouraï, attentif à tout ce qui change dans ses habitudes de solitaire, s’en aperçoit et découvre l’engin. Le bouvreuil est un oiseau très discret qui s’éclipse dès qu’on l’approche – tout comme son maître. Jeff va donc téléphoner d’un café au lieu de le faire de chez lui.


En allant rendre compte de la réussite de son contrat, l’intermédiaire (Jacques Leroy) tente de le tuer. Le commanditaire n’a pas apprécié qu’il ait été arrêté et, même relâché, qu’il puisse mener à lui. Jeff détourne l’arme mais est blessé à l’avant-bras gauche. Il se soigne tout seul, comme un soldat – comme un samouraï. Mais il veut ne pas laisser impuni une telle entorse aux règles. Quel serait le métier si chacune des parties ne respectait pas son contrat ? Aucun affect, comme par exemple la vengeance, juste les affaires.


Il va donc retrouver la pianiste de jazz de la boite pour en savoir plus. Elle lui demande de lui téléphoner deux heures plus tard mais elle ne décroche pas. Lorsqu’il revient chez lui, Jeff trouve une fois de plus son oiseau agité – et est braqué par l’intermédiaire qui a voulu le tuer. Sauf que, cette fois-ci, c’est pour le rassurer : ses alibis ont tenu et la police l’a relâché. Il lui propose donc un second contrat pour deux millions de francs en liquide, payé d’avance. Jeff, qui n’aime pas être menacé, malmène l’intermédiaire et lui fait avouer le nom du commanditaire mais accepte le contrat. Il le laisse cependant ligoté chez lui pour qu’il ne puisse alerter son chef et que, s’il ne revient pas, la police le trouve et lui fasse cracher le morceau.


Car il se rend chez le commanditaire Olivier Rey, à la même adresse que Valérie qui est sa maîtresse, dont il veut manifestement se débarrasser. Tout en semant dans le dédale des lignes de métro les cinquante flics et vingt auxiliaires que le commissaire a mis à ses trousses : on avait les moyens en personnel, dans la police de l’époque ; une gabegie inefficace, car Jeff échappe à ses suiveurs/suiveuses. Il vole une seconde DS et se rend chez le commanditaire, qu’il descend alors que l’autre s’apprête à tirer sur lui. Puis il va dans la boite où il doit exécuter le contrat.
Sauf que, cette fois-ci, il a décidé qu’il était bidon. Peut-être tombé amoureux de la victime désignée, en tout cas heurté par le manque d’honneur des commanditaires de la nouvelle époque, il ne peut plus être solitaire, ni lui-même. Il se suicide donc comme un samouraï pratique le seppuku d’honneur, en menaçant d’une arme vide sa victime potentielle, ce qui fait tirer les flics postés à proximité qui ont réussi à le localiser. La tragédie est consommée dès son entrée : il laisse son chapeau au vestiaire, mais aussi le ticket qu’on lui donne. Il passe un moment au bar et fixe le barman dans les yeux pour qu’il le reconnaisse bien, cette fois-ci. Il est auparavant allé chez sa maîtresse alibi pour lui rendre visite et savoir que tout va bien. Il a organisé sa fin en bon professionnel.


La mise en scène sobre et les dialogues a minima font de ce film un grand film psychologique et de suspense. La noirceur du métier mime celle de la nuit interlope et de ce Paris de grisaille des années post-guerres coloniales où l’argent est roi, l’organisation anonyme la règle, et plus aucun honneur n’est reconnu comme valeur humaine. Le meurtre est devenu une industrie, un service payé par les requins des affaires. On ne se bat plus par passion mais pour l’argent. Seul le commissaire cherche à coincer le tueur par passion, mais « les procédures » et la fonctionnarisation croissante feront dériver aussi ce métier vers l’anonymat industriel et la rentabilité. Film de la fin d’une époque, d’un Paris bourgeois véreux, du duel flics et voyous. Mai 68, l’année suivante, allait balayer tout cela – au grand dam d’Alain Delon qui regrettera le bon vieux temps de sa jeunesse et virera réactionnaire. Pourtant non, ce n’était pas « mieux avant ».
DVD Le samouraï, Jean-Pierre Melville, 1967, avec Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon, Cathy Rosier, Jacques Leroy,, Rene Chateau 1001, 1h40, €14,99
avec digibook et livret Pathé 2011, €23,22
Blu-ray 4K ultra HD, Pathé 2024 €19,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)
Déjà chroniqué sur ce blog :



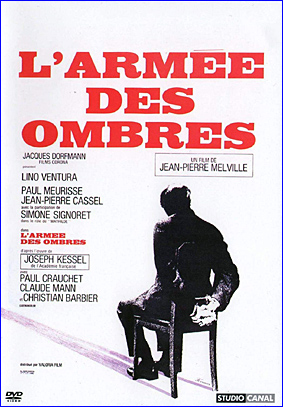



Commentaires récents