
Un ignoble salaud écrase un enfant dans un petit village de Bretagne. Le gamin (Stéphane di Napoli, joli blond de 9 ans) est fils d’un écrivain (Michel Duchaussoy) qui, dès lors, n’aura plus qu’une idée : retrouver le coupable (Jean Yanne) et lui faire expier. Tel est le thème de Claude Chabrol en 1969, adapté d’un roman de 1938 de l’auteur anglo-irlandais Nicholas Blake (père de l’acteur Daniel Day-Lewis) intitulé The Beast Must Die. 1969 était une année plus de gauche qu’érotique, malgré Gainsbourg, avec la série Jacquou le croquant de Stellio Lorenzi qui remémore la lutte des classes.
Bien sûr, il y a ces portraits sociaux de l’artiste engagé, du bourgeois égoïste, méchant et sans scrupules (Jean Yanne), opposé à son fils de 15 ans, jeune, généreux et qui le hait. Bien sûr, il y a ce poncif post-68 de la rédemption du temps par la jeunesse qui refuse le fric pour rêver à la société fraternelle. Bien sûr, il y a cette confrontation de classe et de culture entre l’écrivain intello dépressif et le gros garagiste macho et gueulard, beauf et égoïste (j’en ai détesté Jean Yanne pour des années). Bien sûr il y a cette voix off monocorde et lancinante comme l’Histoire en marche ou le Destin déjà écrit, tellement dans la pensée binaire du temps, le marxisme ayant remplacé le christianisme dans l’eschatologie des fins dernières. Mais c’est le tribut à l’époque et au gauchisme ambiant, assez pesant d’ailleurs cinquante ans plus tard – quoi, c’était cela la France de la fin des Trente glorieuses ? Cette caricature d’Ancien régime entre des aristos cultivés sensibles et des gros cons ignares contents d’eux ?
Heureusement, ce qui sauve le film est que le fond est ailleurs.

Il est dans la blessure béante au cœur du père qui a perdu brutalement son enfant – après avoir déjà perdu sa femme. Non seulement sa mort mais pire encore, l’injustice absurde de cette mort violente. Ce n’est ni une maladie, ni une catastrophe naturelle, ni un accident qui a fait disparaître le petit garçon. C’est un meurtre. Il a été tué presque volontairement et sans remords. La tragédie est là : la révolte contre le destin sans recours, le visage et le corps du coupable qui continue à vivre comme si de rien n’était. Le père ne peut faire autrement que de rechercher le meurtrier et de se venger, allant jusqu’à coucher avec l’ex-amante du garagiste et à faire semblant de devenir ami avec lui. Son destin à lui est là. Une tragédie à l’antique, tiraillée entre la Morale supérieure aux dieux et la Loi qui remplace désormais les dieux.

Un autre enfant s’accusera du crime, le fils du monstre (Marc Di Napoli, 15 ans). Pour racheter peut-être l’acte de son propre père aux yeux de la destinée. Pour sauver l’homme qu’il estime, l’écrivain à qui il s’est confié, père aimant (contrairement au sien) du petit tué. Le spectateur ne saura pas, à la fin, qui a vraiment empoisonné le salaud : le fils qui hait son père violent ou le père du fils écrasé. L’un s’accuse formellement, l’autre écrit une lettre aux autorités. Cette ambiguïté est la marque du destin (pour ne pas encourager de faire justice soi-même).
Le papa écrivain ira jusqu’au bout de son acte. Sans son enfant, il n’est plus rien ; dépressif, il n’a plus le désir de vivre dans une société où le crime impuni est possible, où la bagnole compte plus que la vie d’un gosse. L’automobile, dans la France de Georges Pompidou, était la déesse à laquelle on sacrifiait tout, les quais de Seine pour les voies rapides et les champs fertiles pour les autoroutes. La voiture individuelle était la promotion sociale, l’indépendance du lieu de résidence assigné, la liberté d’être égal à tout le monde sur la route – où la hiérarchie sociale se reconstituait quand même avec les grosses cylindrées. La Ford Mustang noire du meurtrier était la quintessence de cette déesse bagnole : puissante, américaine, sombre comme la mort. Redoutable.

Sa vengeance accomplie, le père veuf de son fils partira seul, sur un petit voilier comme sur une arche. Il ira au large pour ne plus revenir, laissant au destin le choix de son sort, laissant à la justice immanente le dernier mot.
« Il faut que la bête meure… » disait Brahms, paraphrasant l’Ecclésiaste, « mais il faut que l’homme meure aussi ». Aurais-je agi autrement que ce père sans espoir ?
DVD Que la bête meure, Claude Chabrol, 1969, avec Jean Yanne, Michel Duchaussoy, Caroline Cellier, Anouk Ferjac, Marc Di Napoli, Panoceanic Films 2015, 1h48, €16.89

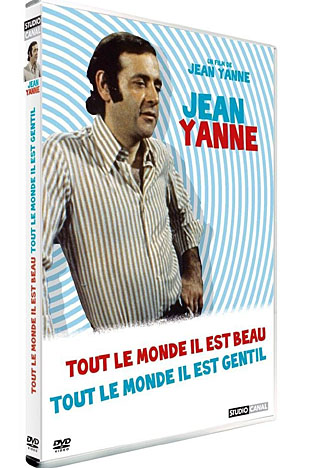



Commentaires récents