Pour rejoindre le chemin des Fils du Soleil je commence par avoir des difficultés à bâtir mon sac. Le séjour sera en altitude, pulls et chemises prennent de la place. Avec ce que je porte sur moi, cela fait près de 30 kg de bagages pour trois semaines dans les solitudes andines. Il faut bien cela pour aller sur les traces de Tintin dans Le temple du soleil, cette bande dessinée qui ont fait rêver mon enfance, ces histoires aux Amériques qui ont cultivé mon goût de l’aventure.
A Roissy, une fille tête en l’air qui va aussi au Pérou a perdu sa carte bleue à quelques places de l’endroit où je suis assis. Ses copains lui disent : « vite, téléphone pour faire opposition ! l’avion va partir dans une demi-heure ». Malgré tout, ils ont des doutes : « tu es bien sûre de l’avoir perdue, tu ne l’aurais pas rangée quelque part ? – non, non, j’ai regardé partout ! » Elle se précipite à la cabine téléphonique pour faire opposition. Bien sûr, elle retrouve la carte dix minutes plus tard en cherchant sa gourde ! L’imbécile se précipite alors à nouveau vers le téléphone pour annuler son opposition mais la banque, entre temps, a fermé. Elle doit appeler ses parents pour qu’ils tentent de lever l’opposition signalée bien légèrement quelques minutes auparavant. Il est faux de croire que certaines personnes « attirent » les ennuis : elles ne font que les susciter par inattention, gaucherie, réactions sans réflexion. Une carte bancaire, ce n’est pas un kleenex que l’on fourre dans un coin du sac, que diable ! On la garde sur soi, avec son passeport et ses billets d’avion. Cela n’a même pas effleuré l’esprit de cette nunuche qui accusera « les autres », l’Etat, « le capitalisme », « le système » ou que sais-je encore si un jour elle n’a plus de travail ou si elle fait un placement malheureux. La France crée une société d’assistés permanents, d’irresponsables congénitaux.
Dans le Boeing d’Avianca, la compagnie colombienne qui nous véhicule par-dessus l’Atlantique, je me retrouve entouré d’enfants piaillards, tous colombiens. Je les entends en quadriphonie. Un bébé reste sage jusqu’à ce que sa mère, maladroite, le remue et excite sa colère. Un autre gamin de trois ans a une tête qui me rappelle au même âge le frère de mon filleul. Un braillard de deux ans prépare ses gammes pour l’avenir. Je remarque une fois de plus combien certaines mères peuvent être abusives, agaçantes pour leurs bébés. Ils se tiennent tranquilles et voilà que, par perfectionnisme, ou par souci d’assurer son pouvoir, la mère tourne le petit, lui colle un ourson sur la figure, l’asphyxie de poutous, lui rectifie son pull, et autres dérangements intempestifs. Derechef le bébé braille, et la mère s’agite plus encore pour le calmer, ayant retrouvé un rôle vis-à-vis du public. Les pères sud-américains ont l’air plus tranquilles avec leurs enfants – au point de les laisser faire à peu près ce qu’ils veulent.
Je profite de ces moments pour lire entièrement un roman de l’écrivain péruvien Vargas Llosa, Lituma dans les Andes. (Je l’ai d’ailleurs chroniqué sur ce blog). Il conte une histoire d’amour, de pauvreté et de superstition : le Pérou d’il y a dix ans à peine. Frissons : un couple de français très typé naïf (catho reconvertis tiers-mondiste et « de gôche », croyant en la bonté du monde) s’y fait assassiner à coups de pierres par les paysans du Sentier Lumineux. C’est un professeur de philosophie de l’université d’Ayacucho, Abimael Guzman qui a fondé le parti communiste maoïste. Il revenait d’un voyage en Chine. Le premier attentat a eu lieu le 17 à mi 1980 au Pérou ; en dix ans il y a eu près de 25000 morts. Il reste quelque chose d’étrange à vouloir faire « le bonheur » des peuples par la voie du massacre. Guzman a été arrêté à Surco, au sud de Lima, le 13 septembre 1992 et condamné (seulement !) à la prison à vie. Depuis, les sentiers ne sont plus lumineux au Pérou, mais praticables.

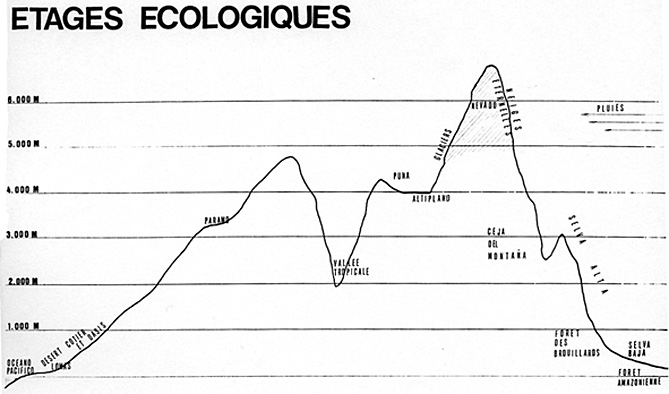




Commentaires récents