Le roman a pour thème le handicap, survenu par hasard, par accident, qui peut arriver à n’importe qui. Comment le surmonter ? Faire avec ? Reconstruire une vie différente ?
Angèle, au prénom d’ange et de glace, travaille quelque part dans le social. Au cours d’une visite en voiture, elle est doublée sous la pluie par une puissante voiture qui dérape en aquaplaning, et c’est l’accident. Un amas de tôles et de ferraille qui laissent la victime meurtrie et paralysée, ne pouvant plus parler.
Les institutions, la famille, l’aide-soignante, les autres malades, les relations, vont peu à peu permettre de réémerger. Tant que l’on ne se sent pas seul, un espoir subsiste, tel est peut-être le message du livre. Un autre est que le silence imposé peut être compensé par le regard et l’écoute de l’arc-en-ciel des autres, à condition d’avoir une force en soi. « Cette nouvelle souffrance sera offerte » p.37 ; « sa passion à l’écoute de l’autre » p.38, ces expressions très catholiques sont orientées social-optimiste. Le lecteur ressent cela comme un peu boy-scout, New Age ou gauche façon 1981 (avant la victoire) mais, pour la génération du baby-boom, ça tient.
En revanche phrases courtes, points de suspension, d’exclamation, majuscules, retours à la ligne – tout pointe visuellement l’émotion. Réussit-on un roman en pavant d’émotions ses bonnes intentions ? La maîtrise manque un brin, le recul nécessaire à l’analyse, la distance exigée pour l’empathie. Le lecteur se trouve emporté dans un tourbillon d’affects et ne sait plus où il en est avant que, vers le milieu du roman, tout finisse par s’apaiser suffisamment pour y voir clair. Il n’y a pas que l’élan pour bien écrire. Sans élan, pas de roman, mais sans construction non plus.
Exprimer n’est pas « hurler » comme il est manifesté trop souvent dans le livre. Tout comme ce jargon du branché courant, si peu efficace pour transmettre une idée : « revendiquer son autonomie », « un impact sur toi », « reconstruction de la cellule familiale », « le manque de l’autre », « garder son vécu ». Exprimer, c’est dire en mots précis et non enchaîner des mots-valise dont le sens, déjà très flou, sera oublié dans dix ans. Des « haïkus » (bien peu japonais) en tête des chapitres, une profusion de « remerciements » avant même de lire, et sur deux pages… Tout cela concourt-il à faire de ce roman un bon roman ? Trop, c’est trop, peut-être.
Le lecteur aborde l’histoire confusément. Il passe d’un personnage à l’autre en chapitres éclatés, lettres insérées, pages de calepin, journal de bord du siècle passé. Est-ce l’accident qui produit ce kaléidoscope qui éclate le temps selon les bouffées affolées de l’esprit ? Pourquoi pas. Mais quelques petites remarques amicales : ces prénoms décalés qui se veulent à toute force originaux, comme Silvin (sans a), Poline (sans au), à quoi servent-ils dans l’histoire ? Volonté de faire « moderne » ? Post-68 ? Il manque cependant les SMS et les vidéos… comme dans un entre-deux de la « modernité ». Les trois filles d’Angèle enregistrent leurs messages sur cassette, à l’heure où l’on joue du Smartphone dès 7 ans. Le lecteur a le sentiment de se retrouver suspendu dans ce qui n’est ni du passé ni du « post-moderne ». Pourquoi ne pas avoir actualisé ces détails de la vie courante ?
Pour un premier roman, disons qu’il se lit bien, même si le thème choisi du handicap est très fort, donc difficile à traiter. Parce qu’il s’agit d’un thème fort le lecteur demande du soin d’écriture, les mots justes et une approche délicate. « Même si écrire est son métier, elle n’écrit peut-être pas aussi justement quand il s’agit de parler d’elle et de tout ce qu’elle ressent au plus profond d’elle-même. Elle essaie, personne ne lui dira si oui ou non elle a le juste ton. Elle est elle-même son propre ‘client’ » p.34. L’objectif de cette chronique est de dire que le ton va trop vers le pathos et pas assez vers la relation (ce que l’auteur a senti vers le milieu de l’histoire, et a corrigé peu à peu). Il est de dire aussi que le roman tient et que l’on s’attache doucement aux personnages, même s’ils apparaissent presque « idéaux » (la victime, le mari, les filles, la soignante, la jeune handicapée amie…).
L’auteur décrit « cette maman anéantie (…) mais plus forte que tout par son amour de la vie et de sa famille, qui a écrit sa douleur, qui a su aussi écrire la douleur de certains autres pour mieux se reconstruire et surtout recoudre point par point le tissu déchiré de ses attachements » p.190. Tout est dit de la force qu’il faut, du désir de relations réciproques et de l’aide que tous les bien-portants se doivent d’apporter aux handicapés – qui dépendent d’eux mais qui leur apportent aussi leur humanité.
Michèle Edmonde Paris, Le silence de l’arc-en-ciel, 2017, éditions Les soleils bleus, 191 pages, €18.00 www.lessoleilsbleus.com
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

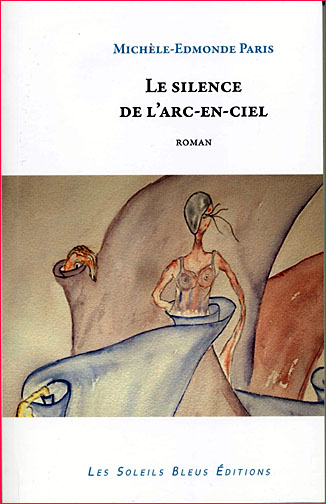
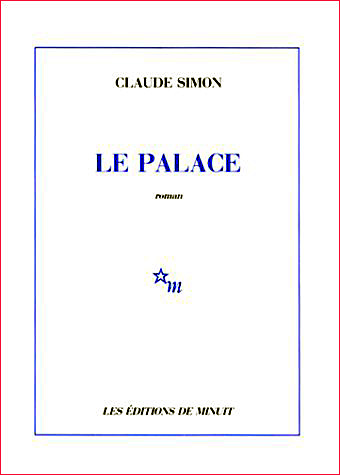

Commentaires récents