Je suis surpris que tant de gens, aujourd’hui, sacralisent autant la parole. A l’heure de l’écrit, de l’image, du « signe », seul « ce qui est dit », de façon officielle, publique, par une personne « ayant autorité », est considéré.
Les informations des scientifiques, reprises par les journaux ou la télévision, entrent par un œil ou une oreille et en ressortent par l’autre. Les gens restent indifférents ou sceptiques, dubitatifs. Ils en ont trop entendu et « attendent de voir », on « ne leur fait pas ». Ainsi la dégradation du climat dû à l’industrie est-elle restée durant des décennies un prêche dans le désert. Il suffit en revanche qu’un histrion de télé, un « intellectuel médiatique » ou un homme de pouvoir reprennent l’information, pour qu’on l’entende et que chacun réagisse alors selon « la » morale en vigueur. C’est ainsi que naissent en France les « polémiques » et que les « scandales » arrivent.
Prenons la maladie dite de la vache folle, née de l’alimentation en farines animales d’herbivores, et ses conséquences humaines, la maladie de Creutzfeld-Jacob. L’information est connue depuis des années déjà. Je me méfie moi-même de la viande de bœuf. Non que je pense que le muscle des rôtis et biftecks puissent être infectant, mais j’effectue un boycott citoyen visant à forcer notre glorieuse Administration, si lente, si lourde, si irresponsable, tellement tiraillée par des lobbys contraires, a secouer sa mauvaise graisse pour justifier sa prétention à « servir l’intérêt général ». Une traçabilité claire et contrôlée est-elle vraiment établie ? L’information était dans l’air mais peu étaient comme moi à en tirer les conséquences. Il a suffi que le président de la République le dise pour que 87 % des Français sondés se mettent à le croire, 13 % déclarant n’en avoir rien à faire. Peu importe que Jacques Chirac ait agi à l’époque par tactique politicienne, pour détourner l’attention des affaires, du temps où il était maire de Paris, ou pour mettre en porte-à-faux le gouvernement socialiste empêtré dans les intérêts syndicaux des catégories ayant intérêt au statu quo. Peu importe : il l’a dit, donc c’est devenu « vrai ».
Même chose dans les entreprises. Bouche-à-oreille et bruits de couloir, confidences internes ou regards extérieurs, font passer l’essentiel des informations importantes. Mais ces informations n’existent dans la réalité les esprits que si la hiérarchie les exprime « officiellement » par une note ou lors d’une réunion. La vérité tombe ainsi comme une parole divine. Étrange superstition des mots à l’heure des échanges en continu des réseaux, du mobile et de l’Internet !
Notre culture latine, catholique, monarchique et jacobine n’y serait-elle pas pour quelque chose ? Il y a quelques dizaines d’années, au temps de mes études universitaires, j’avais déjà été frappé de la survivance du sacré qui entourait le « cours magistral » des professeurs. Cela des années après la grande remise en cause de mai 1968 et la fameuse « réappropriation » de la parole. Alors qu’il existait d’excellents manuels publiés sous le regard critique des pairs, mis régulièrement à jour, ainsi que des travaux dirigés efficaces, chaque élève se devait d’aller écouter religieusement le cours en amphi. J’étais presque le seul à ne jamais suivre un cours magistral et à apprendre plutôt dans les livres. Notre éducation ne nous a-t-elle pas conditionné à attendre le savoir des élites et l’information des interprètes qualifiés de la parole de Dieu ? Curé, notable, médecin, instituteur, adjudant, nous disent toujours comment faire. Le roi, les évêques et (dans la dissidence, ou à la télé) les intellectuels, nous disent ce qu’il faut connaître. La pensée personnelle n’est pas encouragée. C’était péché d’orgueil, que l’on contrôlait par la confession (aujourd’hui appelée repentance). Rares étaient les Montaigne ou les Pascal. Les Descartes, Voltaire et autres Hugo devaient s’exiler.
Le système a trouvé son apothéose dans le fils tyrannique enfanté par nos révolutionnaires : le système soviétique. Le citoyen pouvait penser ce qu’il voulait mais, s’il avait le malheur de l’écrire ou de le dire et qu’on l’écoute, sa « parole » devenait chose et se dressait, objective et autonome, contre lui. Les organes n’avaient de cesse, alors, d’extorquer de l’individu des « aveux », autres paroles de culpabilité contre les paroles d’expression. Comme si les mots venaient de Dieu, de la vérité même de l’Histoire, et que seuls d’autres mots propitiatoires pouvaient les contrer. Jette-on des sorts en émettant des mots ? Au siècle des réactions nucléaires et de l’intelligence artificielle, c’est à croire.
Est-ce plutôt une particularité de ma forme de mémoire qui me rend différent de la majorité ? J’ai une mémoire plus visuelle qu’auditive. Il m’est plus efficace de lire en prenant des notes que d’écouter quelqu’un. Le débit de la parole est trop lent pour mon esprit ; sa musique et son ton brouillent le fond du discours et détournent de sa logique interne. Sauf à trouver justement dans ce non-dit exprimé une information supplémentaire – ce qu’il m’arrive de trouver dans un autre contexte, auprès de dirigeants de sociétés cotées en bourse ou de financiers intéressés à me vendre quelque chose. Mais la matière même passe moins bien oralement à ma mémoire que l’écrit. Car ce qui est couché sur le papier est lisible d’un coup d’œil, objectivé et exprimé d’un seul coup, aligné noir sur blanc, disposé sur la page ou l’écran. Sa cohérence, son rationnel, passe avant le ton qui est la teinture émotionnelle de la voix. Ce qui est dit apparaît directement sans dérouler le fil du pas à pas.
Seuls les Grecs, peut-être, révéraient la vue plus que la parole. Pour eux, la lumière révélait la vérité des choses en raison, la musique servant plutôt à convaincre et à séduire. Dans l’idéal, ils connaissaient un bon équilibre entre la connaissance et la politique, entre la science et l’enseignement, entre la beauté physique du locuteur et la valeur morale qu’il exprimait. Il est vrai que, pour les Grecs, toute parole venait des hommes ici-bas et non pas de Dieu au-delà. Elle n’était qu’argument, pas une vérité révélée.
Après des siècles de culture vouée au mot, de l’exégèse biblique byzantine aux disputes orales du Moyen Âge jusqu’aux effets de tribune des parlementaires et aux prises de parole des intellectuels, peut-être le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et l’Internet vont-ils peu à peu changer la donne ? Une mémoire plus imagée, une intelligence moins lente, moins engluée dans le carcan du vocabulaire et de la grammaire (avec ses mots tabous et ses artefacts de structures dénoncés entre autres par Nietzsche) vont-elles produire une pensée plus vive, plus équilibrée, prenant l’habitude d’aller de suite à l’essentiel avant de reconstituer pas à pas sa logique ? Nous passerions alors de la superstition des mots au sens des choses. Nous prendrions le recul nécessaire pour un jugement mieux équilibré parce que l’œil voit plus vite, plus large et plus loin que la langue. Peut-être verrions-nous alors autrement le monde ? Ou peut-être pas : car le regard rapide peut aussi être superficiel, le regard large un regard vague et le regard lointain une abstraction hors sol.
Au fond, la parole est un outil comme un autre, dont les bienfaits ou les méfaits dépendent de l’usage qu’on en fait.





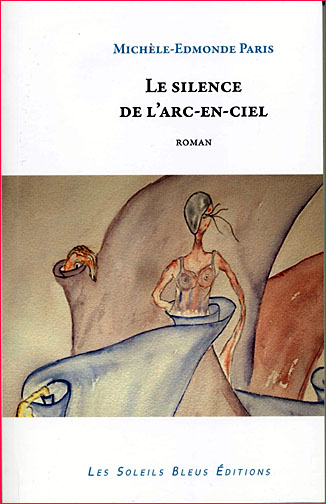









Commentaires récents