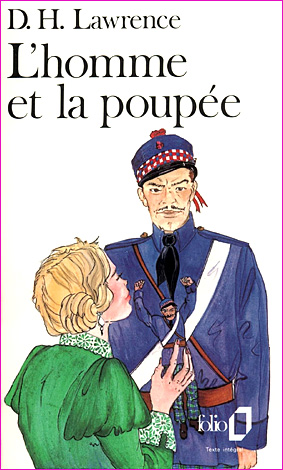
Une troisième novelle de 1917, publiée seulement en 1923 (traduite aussi par L’homme et la poupée) qui reprend les thèmes qui obsèdent l’écrivain : le trio amoureux antagoniste, le mari, la femme, l’amante, l’amour possession jamais accompli, le choc des volontés et des emprises. La situation est toujours la même, la fin de la guerre de 14-18, la démobilisation, les hommes déboussolés, les femmes émancipées, les âmes retournées.
Hannele, la comtesse exilée en Rhénanie occupée par les Alliés, et dont le titre aristocratique a été aboli par l’Allemagne de 1919, survit à Cologne en cousant des broderies et des poupées reconnues pour leur qualité. Elle en réussit une fort réaliste du capitaine Alexander Hepburn, son amant non consommé. La poupée du capitaine est donc en premier un objet réel qu’Hannele manipule à l’envi, « et c’était tout à fait indécent », note l’auteur. Mais elle peut représenter aussi son autrice, la comtesse elle-même, qui exorcise ainsi son « amour » (quel que soit le nom qu’on donne à cette emprise) et l’objective à ses yeux. Car le capitaine est « mince, délicatement fait, les épaules légèrement et élégamment voûtées (…) des yeux sombres grand ouverts, et cet air de hauteur et de parfaite modestie qui caractérise l’officier et le gentleman. (…) de belles jambes fines » p.704 Pléiade.
Par ailleurs, ce capitaine est incapable d’aimer, comme de vivre. Son épouse restée en Angleterre vient le reconquérir, amie du général commandant son mari. Elle a eu vent de rumeur d’une liaison et ne veut pas quitter sa situation confortable d’épouse ayant fait son devoir, donné deux enfants au capitaine, tout en le voyant peu, toujours avec courtoisie. Une indépendance dans la reconnaissance sociale, état enviable dans la société d’après-guerre. C’est pour cela qu’ayant vu la poupée, elle veut à tout prix l’acquérir, elle assure ainsi, comme dans le culte vaudou, son emprise sur son mari. Lequel la revoit à l’hôtel, couche avec elle si elle le désire – mais lui n’en a pas. Lorsque sa femme écrit à Hannele pour la menacer de la faire expulser si elle ne lui vend pas la poupée promise, le capitaine s’aperçoit qu’elle est tombée par la fenêtre et s’est tuée. Accident ou crime ? La coïncidence est troublante, mais le sujet est éludé au profit de la métaphore d’un oiseau en cage qui se serait enfin envolé.
Après cela, Hepburn rentre en Angleterre, quitte l’armée, établit ses enfants qui lui sont indifférents en pension, et liquide ses affaires. Il n’est attaché à rien, se contente de faire son devoir, de suivre les règles. La guerre a fait dégénérer les hommes, les a rendus lâches, soumis aux ordres, donc à leur femme au retour. Hannele s’en rend compte lorsqu’elle prend le thé avec l’épouse et le capitaine, ce ne sont de la part du mari que « oui, mon amie ! Certainement. Certainement j’irai » p.740. Le militaire est la poupée de la maîtresse de maison et Hannele ne l’avait pas vu ainsi. L’amour féminin est celui d’une goule : il enserre, emprisonne, soumet – dévirilisant le mâle pour en faire une poupée (p.791). Lawrence avait une peur bleue de cette dévitalisation.
Pour lui, comme pour ses personnages masculins, l’amour est une volonté d’absorber l’autre au lieu d’être une passion égale. D’où le choc des volontés : active pour le mâle, qui veut conquérir, dompter, se faire adorer ; passive pour la femelle, qui veut agripper, conserver, soumettre. Hepburn a été chevalier servant de la dame son épouse, il envisage désormais d’être vénéré comme un dieu par sa maîtresse, qu’il veut comme nouvelle épouse. Il reste objet, mais de poupée se veut statue, aussi froid et mort, inaccessible, que cette lune qu’il contemple dans son télescope les nuits claires. Hannele reste envoûtée par sa présence physique, comme une femelle animale soumise au mâle de par la nature.
Lawrence insiste beaucoup sur le côté physique des êtres humains. Leurs corps révèlent leur désirs, leurs passions, leur âme. Leur attrait fait leur beauté, et peut permettre le lien sensuel, affectif et spirituel que l’on englobe sous le terme fourre-tout « d’amour ». Ce serait au fond une attraction universelle des énergies, analogue au magnétisme pour le minéral. Lors d’une excursion dans le Tyrol, il note la nudité des « cous virginaux », des bras, des torses, rendant les jeunes hommes blonds des Siegfried wagnériens et les jeunes femmes robustes, « corsage déboutonné », des guerrières germaines (p.768). Lorsqu’il traverse le lac dans une barque pour prendre le thé avec Hannele qui l’a invité chez des amis, Hepburn aperçoit « un grand jeune homme coiffé d’un petit bonnet rouge et vêtu d’un minuscule pagne rouge autour de ses minces et jeunes hanches (…) Un garçon dont la mue est presque achevée » p.759. Il dit son admiration pour ce corps animal, « le garçon nu, qui marchait avec sang-froid. Il ferait un homme splendide, et il le savait » p.762. Lui aurait pu « aimer » son fils, s’il était comme cela.
L’altitude exalte l’énergie génésique, chez l’homme comme chez la femme. L’écrivain le décrit bien : « Elle détestait l’effort de l’ascension, mais l’air de l’altitude, le froid dans l’air, le hurlement de chat sauvage que produisait l’eau, ces affreuses parois de roche bleu foncé, tout cela l’exaltait, l’excitait, induisant un autre type de sauvagerie » p.767. L’ex-capitaine Hepburn veut aussi soumettre la propension au sublime des romantiques anglais qui ont inventé l’alpinisme, comme des romantiques allemands qui se sont laissés griser par les montagnes à la Caspar David Friedrich. Il déteste ces paysages grandioses où le minéral règne, où toute activité demande un effort, où des hordes de touristes en short arpentent les sentiers. Mais il veut vaincre, comme la nature qui semble se mordre elle-même dans une frénésie quasi sexuelle, « les grands crocs et balafres de glace et de neige plantés dans la roche, comme si la glace avait mordu dans la chair de la terre. Et de la pointe des crocs l’eau rauque poussait son cri natal en dégringolant » p.770. Ce pourquoi il monte sans assurance sur le glacier, juste pour prouver qu’il est supérieur aux forces naturelles : « c’était son unique désir, monter dessus » p.780. Une métaphore sexuelle, d’autant que « la glace parût si pure, comme de la chair. Non pas brillante, parce que la surface était douce comme un épiderme doux et profond, mais la glace était pure jusqu’à des profondeurs immenses » p.781.
Il aurait pu glisser, tomber, périr, et le lecteur un instant s’y attend, mais non. Ce n’est pas l’objet de la nouvelle. Elle est sur l’amour – impossible sans compromis. Pour lui, une femme qui aime ne doit pas faire une poupée de son mari, mais respecter les règles. Celles du mariage selon la bonne société et la religion, que Lawrence raille lorsqu’il est proféré que l’épouse doit honorer et obéir à son époux – « cela figure dans la cérémonie du mariage » p.793. Lui préfère « une épouse, aimée et chérie en tant qu’épouse, et non en tant que femme qui flirte » p.793. La fin offre une sorte d’amour, bancal, un os laissé à ronger au lecteur.
David Herbert Lawrence, L’homme et la poupée, Folio 1982, 352 pages, €9,50
D.H. Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley et autres romans, Gallimard Pléiade 2024, 1281 pages, €69,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans de D.H. Lawrence déjà chroniqués sur ce blog
















Commentaires récents