
Laird Koenig, décédé en 2023 à 95 ans, était un maître du thriller à l’américaine, au temps où les séries télé n’avaient pas dévasté la profession. Le thriller, à sa grande époque, était « écrit » ; il était découpé en séquences comme au cinéma ; il maintenait le suspense comme dans les romans policiers. Surtout, il faisait la part belle à la psychologie, au caractère des personnages. Le décor n’était qu’un prétexte pour mettre en avant les sentiments, les grandes questions humaines. L’auteur a fait des études de lettre et de psychologie, pas de cinéma ni de marketing. Les fraîchement retraités s’en souviennent, il a été coscénariste de Flipper le dauphin, série ado animale de 1964 à 1967.
Dans cet opus, nous sommes à New York en 1980. La ville est une Babylone soupçonnée de tous les péchés, la ville satanique par excellence où, en particulier à la fin des années 70, toute la faune marginale et désaxée se retrouve pour des crimes sans nom. Crise économique, irruption du Sida, prostitution, enlèvements, pauvreté. La police est débordée, corrompue, fonctionnaire. Elle touche, elle ramasse, elle ne fout rien. La ville se désagrège, la drogue fait des ravages et la violence est permanente. Comme le dit une journaliste dans le roman, une jeune femme seule le soir sur un trottoir a de grandes chances de se faire voler, violer, trucider – dans cet ordre.
Susannah Bartok, tout fraîchement débarquée de sa Californie, où elle a couvé un beau bébé blond aux yeux bleus de désormais 2 ans, l’apprend à ses dépens : tout peut arriver. Par exemple, son gamin vaut 100 000 $ sur le marché de l’adoption illégale. Elle a quitté le doux soleil californien qui a doré son bébé à cause de Scott, le géniteur qui l’a quittée pour une plus jeune. C’était l’époque décérébrée du Californien-type, trop magnifiée par ceux qui pensaient y voir la liberté : aucune lecture, baise à tout va, surf, et drogue en stimulant. Susannah a pris son enfant et des vêtements légers pour s’envoler voir son père, dans le nord-est des États-Unis. Elle n’avait pas prévu le retard d’avion, le froid polaire, la grande ville anonyme et dangereuse. C’est qu’une femme agit par impulsion, sans réflexion : nombreux sont les romans policiers américains à mettre ce genre de comportement en évidence, bon ressort d’intrigue. Les personnages doivent ressembler à leurs lectrices.
Au lieu de rester à son hôtel, voilà la gourde qui, en pleine soirée de fin décembre, à déjà 22 h, cherche à « aller faire des courses ». Elle emmène le petit dans les rues passantes où les passants passent indifférents. Sauf ceux qui vous zieutent, soupèsent votre bon poids en fric – et passent à l’action. Un tour de bonneteau, une giclée de macis ou d’ammoniaque dans les yeux, et hop ! Le bébé est subtilisé à la main de sa mère, qui ne voit plus rien et se débat comme une poule affolée. La foule s’en fout.
Un bébé flic vaguement noir s’émeut de sa détresse, mais n’a pas été « formé » pour y répondre ; il contacte son supérieur, qui embarque l’agitée dans le fourgon. Car Susannah se démène, veut rester sur place, chercher en tous sens, surtout ne pas quitter l’endroit, vite, vite, courir ici ou là. Hystérie sans effet. Elle est emmenée au poste, où un inspecteur lui assène des paroles lénifiantes, sans faire grand-chose que « signaler » la disparition et envoyer la photo du petit blond à tous les postes du quartier. Et de remplir un interminable questionnaire bureaucratique au lieu d’agir. La mère, amputée de son enfant, en devient folle.
Heureusement, Victoria, une journaliste underground, passait par là en quête de scoop. Elle la prend sous son aile. Solidarité de femme, peut-être désir de gouine, puisqu’elle l’est et vient de larguer sa mannequine blonde. Toujours est-il qu’elle met en branle sa connaissance intime de New York, son entregent de journaliste abonnée aux exclusivités, ses relations dans les milieux inavouables, pour tracer un plan de recherche. Elle liste les pistes à suivre : police, FBI, recherche de cas dans les journaux, voyant, bureaux d’adoption pour le marché noir des bébés, assistantes sociales, intuition…
Roy le drogué la renvoie pour 20 $ à Michelle, qui a vendu son bébé engendré lors d’une passe parce qu’elle ne voulait pas l’élever, laquelle pour 100 $ dit la marche qu’elle a suivie : un docteur, un avocat qui s’occupe de jouer les intermédiaires, et le bébé livré à l’adoption pour 500 $ avec faux papiers. Le célèbre voyant Zellner, être hypersensible assisté de son trop beau jeune Kurt, délivre ce qu’il voit pour avoir sa photo dans The Pressoù Victoria a décroché sa pige. La police n’aurait même pas eu l’idée d’enquêter dans ces milieux non respectables. Sauf que ça marche : le voyant voit le bébé dans une boite au milieu de nombreuses boites, il a froid. Est-ce la morgue ? Un saut audit lieu prouve que non. Alors où ? Un grand hôtel désaffecté est le bout de la piste, d’où le titre français. Là sont les malfrats qui, pour quelques piquouses, font tout ce que « la Chienne » leur dit de faire. Et justement, un couple de riches brésiliens leur a commandé via un avocat un exemplaire de petit garçon blond aux yeux bleus…
Tout va se jouer à la minute : trouver la planque, faire avouer les kidnappeurs, empêcher l’envol de l’avion, prévenir la police – mais quand tout est réglé, sinon les lenteurs de la procédure mettraient des bâtons dans les roues. Victoria va se sacrifier pour la cause du scoop et pour son amour naissant envers Susannah. Laquelle, en mère courage, va se révéler bien plus pugnace qu’elle ne croit elle-même, et le laisse paraître.
Un bon thriller qui vous agrippe par la bonne bouille du petit blond, espèce en voie de disparition avec le métissage, qui vous tient par la découpe haletante de l’action, qui vous inonde de joie au dénouement. A (re)lire : même si on l’a lu une fois et que l’on connaît la fin, on marche toujours. C’est la progression qui compte, pas le résultat.
Laird Koenig, Labyrinth Hotel (Rockabye), 1981, Livre de poche 1982, 381 pages, €3,21
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)


















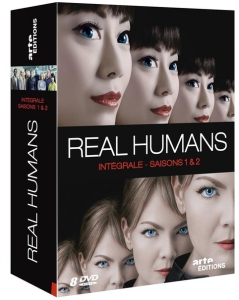
Commentaires récents