
Le siècle dernier nous a légué certains petits romans qui demeurent des délices de lecture – ou de relecture. Je relis en effet Clochemerle, chronique d’un village français moyen, sis dans les monts du Beaujolais. Il y a, comme toujours, le maire, le curé et l’instituteur, plus le notaire, le docteur et le pharmacien, mais aussi la baronne, cheftaine des enfants de Marie et proche de l’archevêque de Lyon. Sans parler des relations éloignées, le député Focart et l’ancien ministre Bourdillat, enfant du pays. Tout ce petit monde grenouille entre les vignes du Seigneur, plus ou moins imbibé entre deux vendanges, et la grande affaire est de s’affairer entre les cuisses des femmes.
Mais ne voilà-t-il pas qu’une lubie a traversé le chef ambitieux de Barthélemy Piéchut, maire de Clochemerle-en-Beaujolais ? Il l’a confiée à Ernest Tafardel, l’instituteur pédant et lyrique, mais bon faire-valoir manipulable à merci. « Je veux faire construire une pissotière ! » – la seule du village, où jusqu’ici chacun faisait où il voulait. En 1922, date de l’histoire, le progrès d’après-guerre passait par l’édification de services publics.
Piéchut est un gros vigneron, gros propriétaire, gros ambitieux et gros matois, en bref un Gros. Il s’est fait (presque) tout seul car c’est en fait sa femme qui lui a apporté les vignes qui font sa fortune. Car, si tout tourne publiquement autour des hommes, les femmes sont toujours à la manœuvre en coulisses. Tel est le délice de ce roman du terroir saturé d’humour français, d’une tendresse rabelaisienne pour la bonne chère, le bon vin et les bonnes femmes. C’est avec truculence que l’auteur s’aventure dignement dans la gaudriole. Car l’urinoir va déchaîner les passions rentrées et mettre au jour les clans politiques qui grimpent aux rideaux à propos de cet édifice nouveau – dont l’idée date pourtant des Romains.
La pissotière est édifiée place de l’Église, à l’entrée de l’impasse du Moine, où se morfond une vieille fille laide et destinée à le rester, la Justine Putet dont la vertu manque cruellement d’infortunes. De voir défiler tous ces gaillards qui se tâtent et se rajustent là où, justement, elle aurait aimer porter au moins une fois la main, raidissent la Putet, au point de la pousser aux extrémités. D’autant que l’Adèle de l’auberge et la Judith des Galeries en face, rivalisent d’amants au su de tous. La vieille fille va se plaindre au maire, qui demande une pétition ; elle va se plaindre au curé, le bon pas futé Ponosse, qui préfère rester en paix ; elle va se plaindre à la baronne Alphonsine de Courtebiche, qui y voit une offense à la vertu et un mauvais exemple pour ses enfants de Marie de 14 à 18 ans. L’une d’elle, d’ailleurs, la Rose Bivaque, vient de tomber enceinte d’un gars du pays en permission de service militaire, le Claudius Brodequin. Il a trouvé chaussure consentante à son pied viril. Le village, les parents, la baronne, vont les pousser à se marier.
Dès lors, tout va s’enclencher, le climat se mettant de la partie, grillant les cervelles sous un soleil de plomb avant de déclencher des orages mémorables aux meilleurs moments du récit. Le cafetier Toumignon, porté à boire par ses copains et défié de contrer le curé qui va tonner (mezzo voce) en chaire contre l’édifice impudique et provocateur en face du lieu saint, ose proférer après le sermon cette apostrophe : « Il n’a pas défendu de pisser, votre bon Dieu ! » – maxime qui ne fait que dire la réalité, mais qui déclenche un scandale de vertu. Nicolas le suisse en belle culotte moulante, s’approche avec sa hallebarde vermoulue pour bouter dehors ce Satan qui ose profaner la messe. Lequel résiste, la hallebarde du suisse se brise en entraînant la chute de la statue de saint Roch, qui se casse. Je ne résiste pas à citer ce paragraphe grandiose et lyrique qui clôture la scène :
« Un long gémissement d’horreur part du groupe consterné des pieuses femmes. Elles se signent peureusement devant les prémices d’Apocalypse qui se déroulent dans le bas de l’église, où gronde maintenant sans arrêt les abominables maléfices du Maudit, incarné en la personne blafarde et malsaine de Toumignon, qu’on savait ivrogne, cocu, débauché, et qui vient de plus de se révéler farouche iconoclaste, capable de tout piétiner, de défier ciel et terre. Les croyantes, saisies d’une crainte sacrée, attendent le suprême fracas des astres s’entrechoquant et croulant en pluie de cendres sur Clochemerle, nouvelle Gomorrhe, désignée à l’attention des puissances vengeresses par l’usage éhonté que Judith la Rousse fait de ses appâts, vraie litière à pourceaux, où Toumignon et bien d’autres ont commercé avec les démons ignobles qui grouillent comme nœud de vipère dans les entrailles de l’impure. Instants de terreur indicible, qui rend bêlantes les pieuses femmes, lesquelles pressent fébrilement sur leur poitrine sans prestige des scapulaires racornis par les sueurs, et transforme les enfants de Marie en vierges défaillantes qui se croient assaillies par des hordes infernales, monstrueusement pourvues, dont elles sentent sur la frissonnante chair de leurs corps intacts les sillages obscènes et brûlants. Un grand souffle de fin du monde, à relents de mort et d’érotisme, balaie l’église de Clochemerle » p.199.
Après le scandale dans l’église, l’affaire de la pissotière va remonter à l’archevêque, qui va tenter de susurrer au ministre que l’Église pourrait appuyer sa candidature à l’Académie française s’il faisait quelque chose, tandis que le député montant Focart s’emploie à dénoncer les suppôts de la réaction. Prudemment, le ministre s’en remet à son chef de cabinet, qui s’empresse de remettre le dossier au premier secrétaire, lequel le dédaigne au profit du second secrétaire, qui a d’autres chattes à fouetter en maison et l’envoie au troisième secrétaire, qui finit par le confier à un sous-chef disponible. Les instructions au préfet partent donc d’un sous-fifre aigri sans aucune responsabilité. La politique comme l’Administration en prennent pour leur grade.
C’est ensuite au tour de l’Armée, car le préfet, dont l’épouse avisée est absente et ne peut le conseiller, décide d’envoyer la troupe en manœuvre plutôt que la gendarmerie enquêter. Les badernes se renvoient la balle hiérarchiquement, comme dans l’Administration, et le général confie l’ordre au colonel, lequel mandate un commandant qui se défile sur un capitaine. Ce dernier est de la Coloniale, sorti du rang durant 14-18, faute de combattants. Un vieux de la vieille qui ne recule devant rien et ne connaît rien à la politique. Il faut sévir, il va sévir. L’auteur, qui a écrit La Peur, un beau livre de guerre sur son expérience à 20 ans, ne porte pas les militaires dans son cœur, encore moins les galonnés !
Le village investi, les pissotières surveillées, le café d’en face pris d’assaut, les passions vont s’exacerber. Tant de jeunes gars bien bâtis pour toutes ces femmes qui se lassent des mêmes maris et voisins en vase clos, quelle aubaine ! Le capitaine va lutiner la plantureuse aubergiste, dont une âme « vertueuse » va dénoncer les agissements érotiques, et cela va se terminer en bagarre générale devant les pissotières, avec deux coups de feu tirés, faisant un mort, l’idiot du village qui passait par là, et une blessée, la femme de l’aubergiste touchée là où elle avait péché. C’est le scandale. Tant de bruit pour si peu. La honte de la vertu face aux conséquences. La réaction est écrasée, le progrès exige la tolérance.
Quand à dame Putet, tous ces physiques à jamais hors de sa portée, ces passions à jamais flétries pour elle, cela la rend folle ; littéralement. Elle sort à poil – et ce n’est pas beau à voir – et va éructer dans l’église son fiel. Comme quoi la vertu toute nue n’a rien d’attirant. Le maire deviendra sénateur, la baronne le considérera d’un autre œil, il favorisera l’élection comme député de son falot de gendre.
Gabriel Chevallier, décédé en 1969, livre à partir d’un microcosme français toute une humanité d’époque dans son jus, avec des portraits hauts en couleur et des émotions éternellement humaines. Des villages comme celui-ci, on en trouve un peu partout en France avec leurs passions, leurs humeurs, leurs appels aux politiques et leurs votes extrémistes. Ils sont toujours actuels.
Un roman drôle, qui fait réfléchir avec humour sur les travers des positions théâtrales, des petites magouilles politiques entre ennemis, des désirs qui s’assouvissent d’autant plus brutalement qu’ils ont été trop longtemps frustrés – la vie qui va, se génère et se transmet.
Gabriel Chevallier, Clochemerle, 1934, Livre de poche 1974, €8,70
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

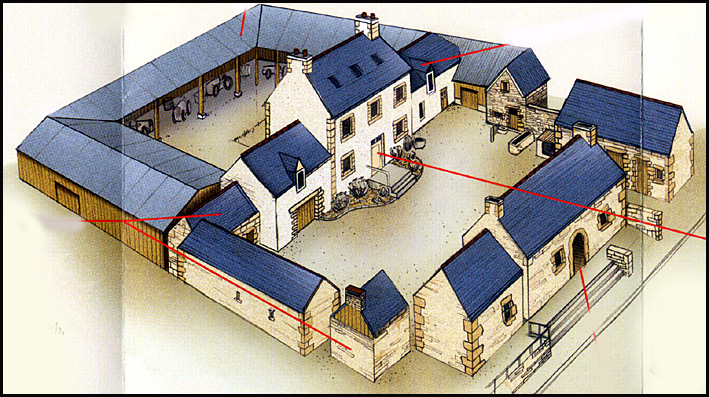













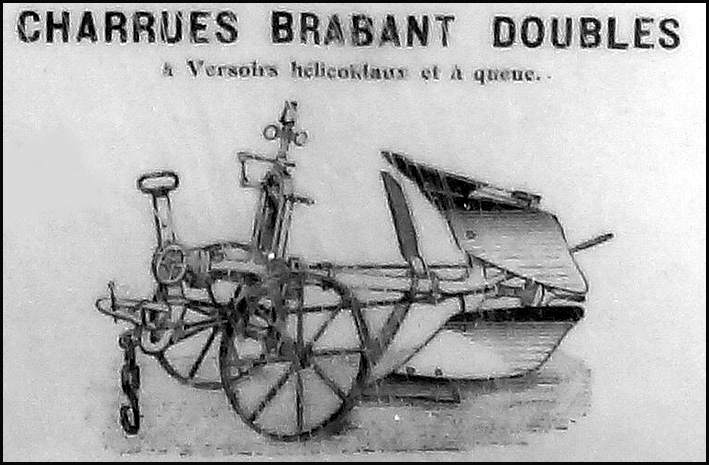
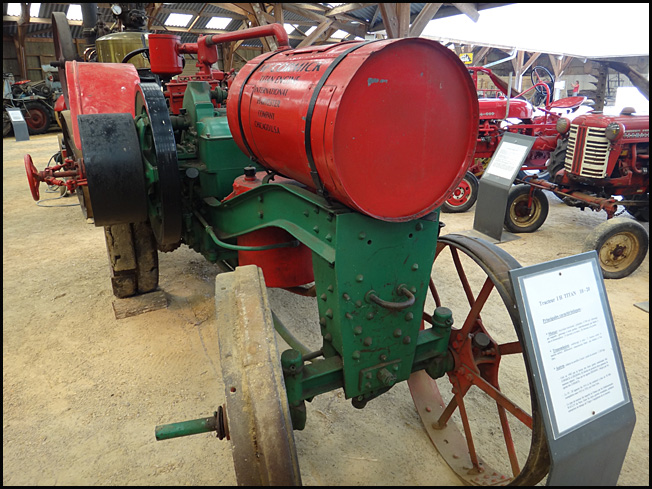






Commentaires récents