Un historien spécialiste de l’Espagne médiévale et professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne fait le point sur ce que nous apprennent les sources en ce qui concerne les relations entre la Gaule chrétienne et l’Espagne musulmane aux VIIIe et IXe siècles, l’époque de la victoire de Poitiers et de la défaite de Roncevaux. Il cite les textes francs, musulmans, juifs et espagnols, jonglant avec les langues médiévales. Mais prend aussi en compte les apports de l’archéologie et de la numismatique. De quoi relativiser bien des fantasmes contemporains…
Par exemple que le monde musulman ait été un apport essentiel à l’Occident chrétien. Mais aussi, à l’inverse, qu’une guerre de civilisation a surgi à cette époque. Ce n’est ni l’un, ni l’autre mais, plus prosaïquement, une suite de guerres, de raids, de diplomatie et de quelques échanges commerciaux.
Les premiers contacts entre chrétiens et musulmans se font dès 711 par la conquête, le viol et le pillage. Ce choc initial va bien sûr orienter les chroniques et donner une image barbare de l’adversaire. C’est de bonne guerre mais pas de bonne histoire – car « les musulmans n’auraient pas pu triompher sans l’appui de populations indigènes, et l’accord passé entre le duc d’Aquitaine et le chef berbère Munuza montre que le clivage religieux, ou culturel, n’interdisait pas l’entente contre un ennemi commun » p.65. Narbonne fut soumise en 719 et occupée jusqu’en 752. Toulouse fut assiégée en 721 mais l’armée musulmane fut vaincue ; en 725, une armée remonte la vallée du Rhône et razzie Autun. Il s’agit de raids de pillards, pas d’une invasion avec femmes et enfants. La seule « occupation » durable de Narbonne et de sa région n’a duré que 33 ans ; l’apport « ethnique » est donc très faible à cette époque.
C’est le samedi 25 octobre 732 que le maire du palais Charles, appelé Martel par sa propension guerrière, vainquit les troupes d’Abd al-Rahman près de Poitiers, vraisemblablement à quelques kilomètres au sud, aux environs du village de Moussais-la-bataille. Les raids musulmans se poursuivent, ce qui incite Charles à les repousser au sud des Pyrénées et à reprendre Narbonne en 737. La ville fut reperdue, puis reprise par Pépin le Bref en 752. Charlemagne prendra Barcelone en 801, après la défaite de l’arrière-garde à Roncevaux due aux Basques et pas aux musulmans. Après quelques opérations en 812 dans la basse vallée de l’Ebre, commence une trêve entre Francs et Arabo-berbères.
Vient alors le règne de la diplomatie, celle-ci étant compliquée par les relations avec Byzance. Carolingiens et Abbassides s’allient contre les Omeyyades et les Byzantins. Occupés ailleurs, à l’est et en Italie, les rois de France se désintéressent de la péninsule ibérique et délèguent les relations aux comtes locaux. Des raids de piraterie subsisteront jusque vers 870.
Durant cette période, le commerce est très faible, allant surtout du nord vers le sud, notamment via des marchands juifs qui parlent les langues et servent d’intermédiaires. Ils exportent de Gaule en Espagne surtout des fourrures et des esclaves slaves châtrés par eux-mêmes vers Almeria (p.236). Les monnaies arabes découvertes dans la vallée du Rhône et en Loire-Atlantique ne sont pas, pour l’auteur, le signe d’échanges commerciaux mais plutôt une « soif de métal précieux » alimentée par les raids vikings et musulmans. Le commerce ne prendra vie qu’un siècle plus tard, en même temps que se développe le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Donc à la fin du IXe siècle, bien avant saint Bernard et son prêche de croisade.
Dans ce livre dense, clair et fort documenté, le lecteur peut remettre en cause nombre d’idées reçues, tordues par les idéologies, qu’elles soient ethniques ou multiculturelles. La science historique se moque des croyances et se fonde sur les faits. « L’enseignement majeur de cette histoire, écrit Philippe Sénac, à savoir que les différences politiques et religieuses n’excluaient pas des tractations entre les régimes et les hommes, voire même des ententes. Quels que soient les mots employés pour les désigner (Agarènes, Ismaélites, Maures ou Sarrasins), la lutte menée contre ces ennemis ne fut jamais en ce temps un conflit dirigé contre l’islam (…) tant l’information et les croyances de l’autre demeurait indigente, à peine réservée à quelques hommes d’Eglise » p.271.
A noter que les chroniques franques font la distinction entre Maures – qui sont Berbères – et Sarrasins – qui sont basanés, donc Arabes. Mais tous deux sont également ennemis. A qui il faut ajouter les Juifs, ni chrétiens, ni musulmans, dont les Annales de Saint-Bertin rapportent qu’en 852 « les Maures prirent Barcelone parce que les Juifs la trahirent pour eux. Ils tuèrent presque tous les chrétiens, ravagèrent la ville et repartirent sans être inquiétés » p.222. Au fond, chacun ne poursuit lors que son intérêt matériel – et la religion comme l’enracinement ne sont pas des préoccupations du temps.
Philippe Sénac, Charlemagne et Mahomet en Espagne VIIIe-IXe siècles, 2015 Folio histoire inédit, 437 pages dont 165 pages d’annexes, bibliographie, notes et index, €9.20
e-book format Kindle, €8.99

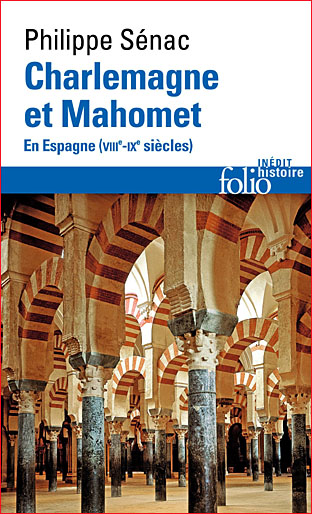



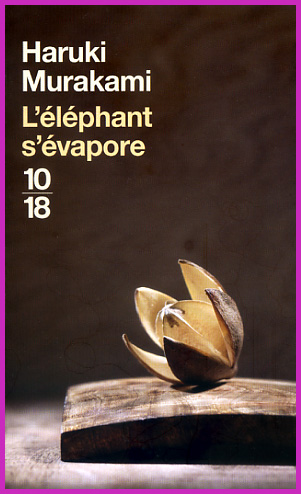
Commentaires récents