C’est un roman aimable et séduisant qui raconte avec une profonde tendresse et un humour constant les querelles de village, au début du siècle XXe. Il s’élargit aux types humains.
Le combat est sans merci entre laïques et cléricaux, mais les opinions politiques ne sont que les masques de haines plus vivaces. La différence des familles et des traditions familiales, surtout dans le domaine sexuel, la différence d’apparence et de comportement, voire d’attitude devant la vie, forment la trame des griefs échangés. Il y a les hypocrites, les puritains, les scrupuleux ; il y a ceux qui aiment la pénombre et les détours du langage. Et puis il y a des francs, les viveurs, les généreux ; ceux qui aiment le grand soleil et le verbe droit. Les Maloret et les Haudouin.
D’un côté les prudents qui ne s’engagent jamais ; les incestueux qui assouvissent leurs désirs en famille, persiennes tirées ; les cléricaux qui suivent la messe et craignent que leurs péchés ne compromettent leur récolte. De l’autre les insouciants, les spontanés, capables de laisser en plan une fille pour admirer le jeu du soleil au-dehors ; les laïques aimant vivre au rythme puissant de la terre et pour qui la République est une belle femme aux seins gonflés qu’il faut défendre contre les barbares.
Dès lors, la césure des opinions se fait non par choix librement déterminé, mais bien plutôt par complexion. Honoré est large, bon, fougueux, aimant la vie ; il sera laïc. Zèphe est rusé, prudent, hypocrite et un peu lâche ; il sera clérical. La différence des tempéraments induit l’écart politique ; en quelque sorte une différenciation ethnique. « La famille Haudouin mesurait un mètre soixante-dix, elle avait les cheveux châtain foncé, les yeux gris, les traits du visage très accusés, les membres secs, mais musclés, le pied cambré. (…) La famille Maloret chaussait 42, elle était trapue, de visage pâle et de cheveux noirs » (XV).
Cette césure peut exister à l’intérieur d’une famille : ainsi Ferdinand et Honoré. Mais survient alors un autre critère, celui du lieu d’habitation. Ferdinand, bourgeois installé en ville, assoiffé de respect, est dans le fond un clérical bien qu’il défende la République. Honoré, paysan insouciant et volontiers anarchiste aime la liberté de mouvement, de travail, d’opinion et de comportement. Tout ce qui représente un frein, une tentative de brimade est rejeté instinctivement : le resserrement des rues en ville, les horaires fixes, l’opinion villageoise, les commandements de l’Église.
Il en est ainsi pour l’éducation des enfants ou pour l’amour des femmes. Honoré laisse les gosses libres de jouer aux jeux érotiques de leur âge, bien qu’il les reprenne avec fermeté (mais tendresse) lorsqu’ils s’égarent. Malgré des tentations, il reste fidèle à sa femme qui lui a donné des gamins et partage sa vie. Sa fidélité est instinctive et affective. Dans sa famille, l’union règne par-delà les disputes occasionnelles. L’entente est à un niveau profond : celui de l’amour de la vie et de la passion pour la liberté. Il est de très belles pages sur l’amour paternel (V) et sur l’unisson familial (IX). « Dans la maison d’Honoré, l’amour était comme le vin d’un clos familial ; on le buvait chacun dans son verre, mais il procurait une ivresse que le frère pouvait reconnaître chez son frère, le père chez son fils, et qui se répandait en chansons du silence » (IX).
Ferdinand, au contraire, s’érige en censeur de ses enfants et de sa femme. Il est obsédé et sans cesse soupçonneux, torturé par la vision du péché, par des scrupules de conscience, par la peur du qu’en-dira-t-on et par la crainte de Dieu. L’atmosphère familiale est étouffante, les enfants s’éloignent des parents le plus qu’ils peuvent, s’asseyent par exemple aux coins opposés d’un compartiment de chemin de fer.
Le récit, très « païen » au sens étymologique de ‘paganus’, le paysan, confronte deux types d’hommes éternels : celui qui aime la vie et qui est porté spontanément à la joie ; celui qui sans cesse craint l’opinion, Dieu, et qui oublie de vivre.
Marcel Aymé, La jument verte, 1933, Folio 1972, 256 pages, €6.50
DVD La jument verte de Claude Autant-Lara, 1959, avec Bourvil, Francis Blanche, Gaumont 2011, €19.71
En savoir plus sur argoul
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

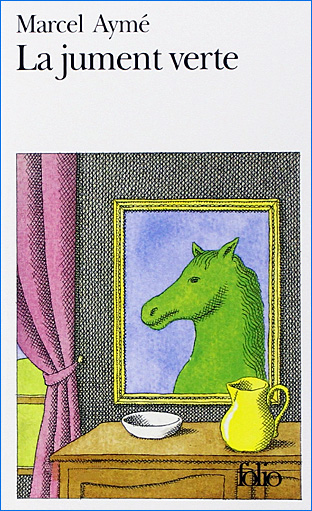
Commentaires récents