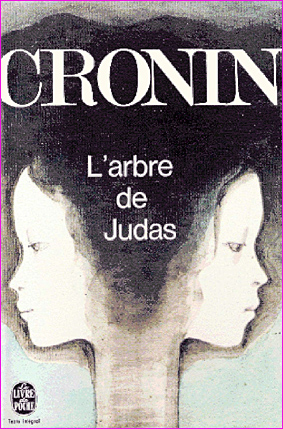
L’arbre de Judas est le nom anglo-saxon de notre arbre « de Judée » ou gainier silicastre – mais la mention de l’apôtre qui a trahi Jésus donne le sens moral du roman. Les feuilles de l’arbre ressemblent à des monnaies, les 30 deniers du traître. Avec Cronin, médecin athée né en Écosse, on ne cesse d’arpenter les méandres de l’esprit humain. L’aventure est toujours au coin des relations avec l’autre sexe. Le mode est conventionnel et un peu vieillot, mais l’auteur réussit des variations originales sur les contraintes de son époque d’avant et d’après-guerre, dans son milieu interclasses.
David Moray est un jeune homme assidu qui poursuit des études de médecine au point de les rattraper avec brio. En panne de moto dans la lande, il rencontre une jeune serveuse de guichet de gare et en tombe amoureux. Mary devait se marier avec un gars du coin, fils de famille pontifiant qui lui assurerait la sécurité dans le mariage – thème convenu. Mais David la séduit, tout comme il séduit le petit frère Willie d’une douzaine d’années qui adore parler avec lui de l’Afrique et des explorateurs. Ils décident de se fiancer : n’a-t-il pas trouvé un poste de médecin bien payé dans un hôpital de campagne où un pavillon séparé leur sera réservé ?
Sauf que le destin s’en mêle. David attrape un refroidissement lors d’un pique-nique en moto où il se met brusquement à pleuvoir – phénomène pourtant très courent en Écosse – et alors qu’ils n’ont prévu aucun Macintosh pour se protéger. Le médecin ressent un point au côté, c’est une pleurésie. Son docteur ex-professeur lui conseille, pour se rétablir, d’aller plusieurs mois dans un climat sec et ensoleillé. David en a gros sur le cœur, mais doit se décider. Un poste de médecin de bord lui est proposé sur un bateau qui va aux Indes et il embarque. Mary et lui s’échangent des lettres, qui le suivent d’escale en escale.
Là, autre coup du destin, le jeune homme est repéré par une famille d’industriels anglais qui va rejoindre le fils aîné aux Indes afin de visiter la filiale pharmaceutique établie là-bas. La fille du couple, enfant gâtée qui ne supporte pas la frustration et se révélera borderline, lui met aussitôt le grappin dessus. Bien que David résiste toute la traversée à ses avances explicites, cela ne fait qu’exacerber le désir sexuel de Doris. Ses parents se font complices, elle aurait tout intérêt à trouver un mari qui la calme et la stabilise. Le père va jusqu’à proposer à David, jeune médecin, d’entrer dans son affaire comme spécialiste et caution scientifique pour ouvrir une nouvelle filiale de fabrication de médicaments, vitamines et cosmétiques aux États-Unis. Il gagnerait trois fois ce qui lui est proposé à l’hôpital écossais et serait intéressé à l’affaire à terme en tant qu’associé. Il lui faut pour cela simplement épouser Doris, qui ne demande que ça. David, loin de Mary, finit par donner son consentement, par lâcheté autant que par souci de confort. Mary, sa chère Mary, l’oubliera, elle est jeune et refera sa vie.
Trente ans passent et David, à la mort du beau-père suivie de la mort de sa femme Doris internée plusieurs années, décide de prendre sa retraite en Suisse, fortune faite. Il s’installe dans une villa proche d’un lac et se fait un cercle d’amis, s’entourant de belles choses, de meubles et de tableaux. Il a tout son confort et une amie très proche en la personne d’une baronne veuve, mais sa vie lui paraît terne. Il décide de faire un pèlerinage en Écosse pour revoir les lieux de sa jeunesse.
Il y rencontre par hasard Kathy, qui se révèle la fille de Mary, mariée à un pasteur après sa déception. Mary est morte et Willie est devenu missionnaire aux confins du Congo. La jeune fille, d’une vingtaine d’années, ressemble si fort à son ancien amour que David l’adopte aussitôt en pensées et s’occupe de la séduire. Il a en vue d’être pour elle un substitut de père mais découvre qu’il veut plutôt en faire sa femme. D’ailleurs, la jeune fille s’ouvre à ses avances et, tout comme sa mère jadis, consent. Le lecteur aurait pu penser que Kathy était sa fille puis qu’il a défloré Mary, mais il n’en est rien. C’est nécessaire à la suite de l’histoire.
Car elle va se répéter, David retombant à chaque fois dans son ornière, incapable de volonté. Cet être en apparence fort et sérieux n’est au fond ni l’un, ni l’autre, à la grande déception du lecteur captivé par ses aventures. Kathy sait ce qu’elle veut : elle a promis à sa mère Mary décédée comme à son révérend frère Willie de rejoindre la mission en Afrique pour aider les plus démunis. Dans ces contrées sauvages, l’animisme et le machisme noir sont rois, tout comme les maladies les plus horribles : lèpre, peste, variole, malaria, diphtérie, vers filaires, etc. Malgré le luxe et la vie confortable que David lui promet en Suisse, elle n’en démord pas. Elle l’incite au contraire à l’accompagner pour œuvrer comme médecin dans un hôpital qu’ils veulent créer. Willie lève des fonds de charité pour cela et, invité par David quelques jours, réussit à le convaincre. David veut tout quitter pour se marier avec Kathy et la suivre, malgré la différence d’âge et l’écart abyssal de confort entre sa vie présente et l’existence projetée. Elle a su trouver les mots pour remuer son âme au fond généreuse : « Il y a le contentement, la tranquillité de l’esprit, une sensation d’achèvement, qu’on ne connaîtra jamais en ne pensant qu’à soi-même, en courant sans cesse après les plaisirs sans vouloir prendre conscience de l’agonie des autres. Et ce sont autant de choses qui ne peuvent s’acheter… » p.318. Morale contre matérialisme, l’âme contre les instincts, vieux dilemme chrétien.
Dommage que Kathy s’éloigne pour suivre quelques jours en Angleterre son frère afin de régler des affaires, elle aurait gardé David auprès d’elle pour toujours. Mais, comme après avoir pris la fleur de Mary, David s’est laissé circonvenir par une autre femme : il a pris la fleur de Kathy et se laisse aller à ses états d’âme auprès de la baronne Frida von Altishofer, qui le materne. Elle le convainc que tout cela est folie et qu’il devrait se ressaisir auprès d’une femme de son âge et de sa classe. Un tour de rein en descendant des livres, puis les journaux qui annoncent des massacres au Congo et au Kenya après le retrait des Belges, en plus d’une lettre sans aucun sentiment de la part de Kathy, préoccupée avant tout de petits problèmes pratiques et de la santé de son frère, achèvent de persuader David que sa promesse est une erreur.
Il s’en délie sans rien dire ; il ne partira pas ; il trahira de nouveau. Kathy ne s’en remettra pas, lui non plus. Seule la baronne, en goule tournée vers le pouvoir, aura gagné au matériel. Égoïste malgré sa charité quand cela ne lui coûte rien, centré sur lui-même malgré sa séduction des femmes qui l’attirent, tourné vers le profit pour lui-même de tout ce qu’il entreprend – David est un imposteur. La fin sera inattendue, immorale, elle justifiera le titre du roman.
Archibald Joseph Cronin, L’arbre de Judas (The Judas Tree), 1962, Livre de poche 1969, 445 pages, occasion rare €15,00 (liens sponsorisés Amazon partenaire)
Cronin déjà chroniqué sur ce blog



Commentaires récents