Montaigne devient bavard en sa vieillesse, faute d’autres activités à sa portée. Le chapitre V du Livre III des Essais comprend 44 pages bien serrées de l’édition Arléa, soit quasi 5 % de l’ensemble des Essais ! Il veut parler de sexe et prend mille précautions pour s’en justifier avant d’en arriver enfin au vif du sujet qui est le désir, les femmes, le mariage, la continence, la jalousie et toutes ces sortes de choses – habituellement tues.
La vertu est belle et bonne, dit Montaigne, mais avec modération. Si elle est utile à la jeunesse, pour la réfréner en ses appétits, elle nuit à la vieillesse, la rendant sévère et prude. Est-ce parce que nos sociétés occidentales vieillissent qu’elles deviennent plus frigides et choquées ? L’élan de jeunesse du baby-boom, fleurissant en les années soixante du siècle dernier, avait jeté les frocs aux orties, avec les soutifs et les slips ; le rassis de vieillesse qui racornit nos sociétés soixante ans plus tard tend à rajouter des pantalons aux shorts et des sweats à capuche aux tee-shirts afin de masquer par pruderie les formes. Abaya et burkini ne sont que l’exacerbation de cette tendance chrétienne réactionnaire à rétrécir l’âme en dissimulant la vue. Montaigne réagit à cette pente qui est sienne avec les ans. « Je ne suis désormais que trop rassis, trop pesant et trop mûr. Les ans me font leçon, tous les jours, de froideur et de tempérance. Ce corps fuit le dérèglement et le craint. Il est à son tour de guider l’esprit vers la réformation. Il régente à son tour, et plus rudement et impérieusement. (…) Je me défends de la tempérance comme j’ai fait autrefois de la volupté. Elle me tire trop arrière, et jusqu’à la stupidité. Or je veux être maître de moi, à tout sens. La sagesse a ses excès et n’a pas moins besoin de modération que la folie » Puisse nos sociétés entendre ce juste milieu !

« Platon ordonne aux vieillards d’assister aux exercices, danses et jeux de la jeunesse, pour se réjouir en autrui de la souplesse et beauté du corps qui n’est plus en eux, et rappeler en leur souvenance la grâce et faveur de cet âge fleurissant. » Voilà comment la vertu se nourrit des contraires. Point trop de morosité en l’âge, mais la mémoire de la vigueur et de la santé qui sont la vie, digne d’être célébrée. « La vertu est qualité plaisante et gaie. »
Du reste, je me suis ordonné de tout dire, explique Montaigne, « d’oser dire tout ce que j’ose faire, et me déplais des pensées mêmes impubliables. » Rousseau avait cette intention même en ses Confessions, tout comme le fit saint Augustin. Car il vaut mieux mettre des mots sur ses actes que les taire et les dénier en pensée. Vertu de la confession catholique, remplacée par le Journal chez le protestant Gide et l’orthodoxe Matzneff. Encore que ces journaux aient été « arrangés » pour la publication, Gide ayant coupé une part (restituée récemment) et Matzneff se voyant contraint au silence par la Springora. Mais c’est hypocrisie, dit Montaigne : « Ils envoient leur conscience au bordel et tiennent leur contenance en règle. Jusqu’aux traîtres et assassins, ils épousent les lois de la cérémonie et attachent là leur devoir ». Le politiquement correct masque les actes répréhensibles et se repentir de ses errements de prime jeunesse (comme la Springora qui baisait fort allègrement à 14 ans) sert d’excuse pour se valoriser médiatiquement. Triste monde. « C’est dommage qu’un méchant homme ne soit encore qu’un sot et que la décence pallie son vice. »
Après ces pages de préambule pour apaiser le lecteur, Montaigne passe enfin aux « dames ». « Qu’à fait l’action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire et si juste, pour n’en oser parler sans vergogne et pour l’exclure des propos sérieux et réglés ? » Puis de citer les fameux vers de Virgile sur Vénus dans l’Enéide (VIII 387-404) où la déesse étreint Énée, l’enflammant de désir pour son épouse. Montaigne trouve cela un peu gros : le mariage, pour lui, est contrat d’intérêts, pas de passion hormonale. Au contraire, les hormones passent alors que l’affection reste ; elle se bonifie avec le temps. « Aussi est-ce une espèce d’inceste d’aller employer à ce parentage vénérable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse », écrit-il. Au contraire, « Je ne vois point de mariage qui faille plus tôt et se trouble que ceux qui s’acheminent par la beauté et désirs amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus constants, et y marcher avec précaution ; cette bouillante allégresse n’y vaut rien ». Un bon mariage suscite l’amitié, pas la passion amoureuse ; il se fait sur les caractères, pas sur les apparences de la beauté éphémère. « C’est une douce société de vie, pleine de constance, de fiance et d’un nombre infini d’utiles et solides offices et obligations mutuelles. » Une épouse n’est pas une maîtresse à son mari. Montaigne se dit considéré comme licencieux mais, dit-il, « j’ai en vérité plus sévèrement observé les lois de mariage que je n’avais promis, ni espéré. »
« Le mariage a pour sa part l’utilité, la justice, l’honneur et la constance : un plaisir plat, mais plus universel. L’amour se fonde au seul plaisir, et l’a de vrai plus chatouillant, plus vif et plus aigu ; un plaisir attisé par la difficulté. » Nous traitons les femmes sans considération, avoue Montaigne : « Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde d’autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elle. » Il l’explique comme en son temps, au vu des écrits classiques, parce que les femmes « sont, sans comparaison, plus capables et ardentes aux effets de l’amour que nous ». En témoignent Tirésias qui fut homme et femme, et Messaline qui baisa vingt-cinq mâles en une nuit comparée à Procule qui ne dépucela que dix vierges. Pas facile de contenir le désir des femmes et de les vouloir mariées et fidèles en même temps, expose Montaigne. Nous les voulons « chaudes et froides : car le mariage, que nous disons avoir charge de les empêcher de brûler, leur apporte peu de rafraîchissement, selon nos mœurs. » Or « nous les dressons dès l’enfance aux entremises de l’amour », observe le philosophe sociologue, « leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regardent qu’à ce but. » Et de citer sa propre fille, déjà pubère mais « molle », qui fut arrêtée par sa gouvernante parce qu’elle lisait en français ce mot de fouteau (qui est un hêtre mais que l’on peut confondre avec foutre). Rien que de hérisser la vertu contre ce seul mot n’a pu qu’inciter la jeune fille à le trouver curieux, et à désirer en savoir plus sur la fouterie. Belle éducation que de cacher les choses de la vie !
Car « tout le mouvement du monde se résout et se rend à cet accouplage », dit Montaigne. « Cinquante déités étaient, au temps passé, asservies à cet office ; et s’est trouvé nation où, pour endormir la concupiscence de ceux qui venaient à la dévotion, on tenait aux églises des garces et des garçons à jouir, et était acte de cérémonie de s’en servir avant de venir à l’office. » L’incendie s’éteint par le feu, cite en latin Montaigne. « Les plus sages matrones, à Rome, étaient honorées d’offrir des fleurs et des couronnes au dieu Priape ; et sur ses parties moins honnêtes faisait-on asseoir les vierges au temps de leurs noces. » A quoi sert l’hypocrite pudeur sociale, sinon de masquer d’autres vices plus profonds sous l’apparence de la rigide vertu ? Nous sommes des êtres de nature et la nature nous a ainsi faits que nous sommes sexués. Pourquoi le nier ? « Les dieux, dit Platon, nous ont fourni d’un membre désobéissant et tyrannique qui, comme un animal furieux, entreprend, par la violence de son appétit, soumettre tout à soi . De même aux femmes, un animal glouton et avide, auquel s’y on refuse aliments en sa saison, il forcène [de forcener, rendre fou furieux], impatient de délai, et soufflant sa rage en leur corps, empêche les conduits, arrête la respiration, causant mille sortes de maux, jusqu’à ce qu’ayant humé le fruit de la soif commune, il en ait largement arrosé et ensemencé le fond de leur matrice. » Plus direct et lucide que Montaigne il est peu.
Il est « plus chaste et plus fructueux » de faire connaître de bonne heure aux enfants la réalité, que de leur laisser deviner selon leur fantaisie – ou selon les infox des réseaux sociaux et des vidéos pornos, ajouterait-on aujourd’hui. Car l’illusion, l’imagination, le film, gauchissent et grossissent le naturel. « Et tel de ma connaissance s’est perdu pour avoir fait la découverte des siennes en lieu où il n’était encore au propre de les mettre en possession de leur plus sérieux usage », dit Montaigne. Autrement dit le garçon s’est effrayé d’imaginer l’acte sexuel alors qu’il était encore impubère. Au contraire, se montrer nus les uns aux autres comme les Grecs, les Africains et d’autres peuples, montre la réalité des corps et n’incite pas à la lascivité, par l’habitude de les voir. Pas de voyeur là où tous s’exposent. Nos camps de nudistes ne sont pas des bordel, qu’on sache.

« Cette nôtre exaspération immodérée et illégitime contre ce vice naît de la plus vaine et tempétueuse maladie qui afflige les âmes humaines qui est la jalousie », explique notre philosophe. Cette passion rend extrémiste, enragé, encourage les haines intestines dans la famille, les complots dans la société et les conjurations politiques. Voyez les harems de l’islam et la lutte des princes en Arabie. Or la chasteté est sainte, mais difficile. « C’est donc folie d’essayer à brider aux femmes un désir qui leur est si cuisant et si naturel », dit Montaigne. Qu’est-ce d’ailleurs que la chasteté ? Telle se prostitue pour sauver son mari, ou pour se nourrir avec ses enfants comme le reconnaissait Solon, le législateur grec. Mieux vaut faire comme si et prévenir sa femme avant de rentrer de voyage pour être « honnête cocu, honnêtement et peu indécemment », concède Montaigne. La part des choses.
Quant au langage sur le sexe, le romain est direct et vigoureux, le renaissant plein d’afféteries mièvres que Montaigne abhorre. « Mon page fait l’amour et l’entend, dit-il. Lisez-lui Léon Hébreu et Ficin : on parle de lui, de ses pensées, de ses actions, et pourtant il n’y entend rien. » Léon Hébreu était médecin néoplatonicien, juif portugais de la Renaissance ; il a écrit les Dialogues d’amour publiés vers 1503 et traduits en français en 1551. Marsile Ficin était philosophe poète renaissant de Florence, traducteur notamment de Platon, et auteur d’un De l’amour publié en 1469. Montaigne parle ici de ses contemporains érudits qui masquent sous le « beau » langage les réalités du sexe.
Au contraire, lui se veut direct : « Tout le monde me reconnaît en mon livre, et mon livre en moi. » Il n’en est pas moins influencé, par les poètes qu’il lit, par les gens qu’il rencontre. Il les imite par empathie, mais qu’ils partent et il oublie. Toute une page est consacrée à lui et à sa manière. « Mon âme me déplaît de ce qu’elle produit ordinairement ses plus profondes rêveries, plus folles et qui me plaisent le mieux, à l’improviste et lorsque je les cherche le moins ; lesquelles s’évanouissent soudain, n’ayant sur le champ où les attacher ; à cheval, à table, au lit, mais plus à cheval, où sont mes plus larges entretiens. » Mais point de mémoire, seulement une impression, une image.
Revenant à l’amour, ce « n’est autre chose que la soif en cette jouissance en un sujet désiré, ni Vénus autre chose que le plaisir à décharger ses vases, qui devient vicieux ou par immodération, ou indiscrétion. » Pourquoi dès lors appeler « honteuse » cette appétence ? « Nous estimons à vice notre être », constate amèrement Montaigne. Mieux vaut la faire désirer, « une œillade, une inclination, une parole, un signe » – plus il y a de difficultés et d’obstacles, meilleure est la victoire. « Nous y arrêterions et nous aimerions plus longtemps ; sans espérance et sans désir, nous n’allons plus qui vaille. » Et de résumer gaillardement, en écologiste de notre époque : « la cherté donne goût à la viande ». Lui parle des femmes, et pas pour les mépriser. En cela il est moderne. « Je dis pareillement qu’on aime un corps sans âme et sans sentiment quand on aime un corps sans son consentement et sans son désir. » Car il y a viol.
Pour ce qui est de lui, Montaigne aime le sexe. Mais avec tempérance. « Je hais à quasi pareille mesure une oisiveté croupie et endormie, comme un embesognement épineux et pénible. L’un me pince, l’autre m’assoupit. (…) J’ai trouvé en ce marché, quand j’y étais plus propre, une juste modération entre ces deux extrémités. L’amour est une agitation éveillée, vive et gaie ; je n’en étais ni troublé ni affligé, mais j’en étais échauffé et encore altéré : il s’en faut arrêter là ; elle n’est nuisible qu’aux fous. » C’est la nature, et la nature veut qu’on en use puisqu’elle nous a faits ainsi. « La philosophie ne lutte point contre les voluptés naturelles, pourvu que la mesure y soit jointe, et en prêche la modération, non la fuite. (…) Elle dit que les appétits du corps ne doivent pas être augmentés par l’esprit. » Montaigne n’est pas un anachorète ni un saint, mais un homme sain.
L’âge l’empêche, mais il lui est doux d’observer encore l’amour à l’œuvre autour de lui, sans désirer prendre son plaisir avec une jeunette, comme il le voit faire. « Je trouve plus de volupté à seulement voir le juste et doux mélange de deux jeunes beautés ou à le seulement considérer par fantaisie, qu’à faire moi-même le second d’un mélange triste et informe. » Il n’aurait pas été Matzneff ; il est d’ailleurs moins narcissique. De préciser d’ailleurs : « l’amour ne me semble proprement et naturellement en sa saison qu’en l’âge voisin de l’enfance. » Juste avant la barbe, semble-t-il dire.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog

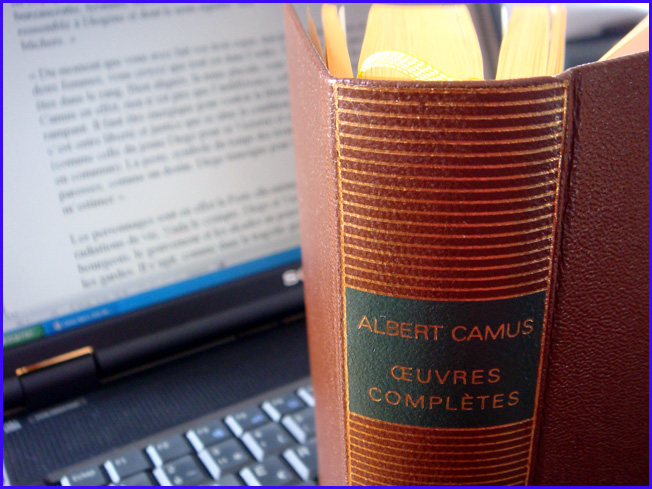
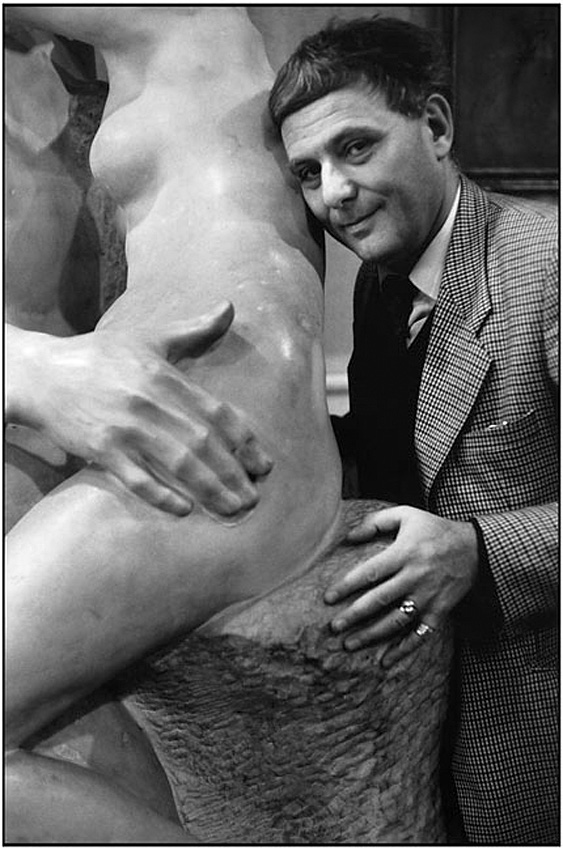
Commentaires récents