
Un western « spaghetti » des années 60 qui expose trois solitaires sans aucune morale. Alors qu’autour d’eux se joue une guerre de civilisation entre « esclavagistes » du sud et industriels Yankees du nord, ils ne poursuivent qu’un seul but : le fric. Il s’agit de retrouver un magot de 200 000 $ caché dans une tombe d’un cimetière situé quelque part. Un malfrat a piqué la somme à ses complices, avant de fuir. Il s’agit de le retrouver. Il a changé de nom ? Il s’agit de faire parler qui le sait – et de descendre les témoins.


Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, le Truand (Eli Wallach), est un criminel. Blondin le Bon (Clint Eastwood, 35 ans à l’époque) le délivre des chasseurs de prime et noue un contrat avec lui. Il va livrer Tuco aux autorités, encaisser la prime et couper d’une balle de fusil la corde qui le pend pour qu’il puisse s’enfuir. De quoi se partager les dollars et recommencer ailleurs. La belle vie – qui dépend quand même de l’adresse de Blondin. Par ailleurs, la Brute Sentenza (Lee Van Cleef), tueur sans remords, a été payé comme mercenaire par Baker (Livio Lorenzon) soldat confédéré qui a piqué l’or avec Stevens et Carson. Il paye Sentenza 500 $ pour savoir où est son complice parti avec le magot. Il devra l’assassiner. Sentenza apprend de Stevens que le dernier se fait appeler désormais Bill Carson. Il tue Stevens pour honorer son contrat – ainsi qu’un de ses fils qui a surgi avec une arme. Mais Stevens vient de le payer 1000 $ pour tuer Stevens, ce qu’il fera sans état d’âme : « j’honore toujours mes contrats ». Il va ensuite traquer le Bill, dans son régiment en fuite devant les Yankees.
Lassé, Blondin rompt son contrat avec Tuco, garde la dernière prime sans partager et l’abandonne dans le désert. Quelques 120 km avant le premier village. Mais Tuco est un dur et s’en sort. Il se refait une arme avec plusieurs revolvers de l’armurerie bancale du vieux du coin, pique un chapeau, et part sans payer. Il traque Blondin pour se venger. Alors qu’il va réussir, Blondin déjà la corde autour du cou dans une chambre d’hôtel où il l’a surpris par la fenêtre après qu’il ait massacré de trois balles les trois complices recrutés par Tuco pour faire diversion, une canonnade yankee fait s’écrouler la façade – et Tuco se retrouve un étage plus bas, dans les décombres. Blondin en profite pour filer. Tuco va cependant le retrouver et inverser les rôles : c’est Blondin qui doit marcher dans le désert, sans chapeau et sans eau, en suivant le cheval où Tuco se pavane, gourde bien remplie et parasol rose de pute pour le protéger du soleil.


C’est presque la fin pour Blondin, ravagé par la soif et brûlé par les rayons, lorsqu’un véhicule confédéré tiré par six chevaux surgit sur la piste. Tuco l’arrête et trouve des Confédérés morts, sauf un caporal qui s’appelle Bill Carson. Il révèle l’emplacement du magot, le nom du village, le lieu du cimetière, mais réclame de l’eau avant de donner le nom sur la tombe. Tuco part chercher sa gourde mais, le temps qu’il revienne, Carson est mort. Blondin, qui avait rampé jusque là, a recueilli le nom de la bouche du mourant. Info ou intox ? Tuco le con le croit, et Blondin lui devient alors un ami précieux qu’il faut sauver pour qu’il se rétablisse. Bien joué ! Il conduit le déshydraté vers une mission franciscaine où son frère Pablo (Luigi Pistilli) est père supérieur. Blondin est soigné, Tuco sermonné. Il a toujours été fils de pute, et a abandonné sa mère qui est morte sans le revoir.
Reprenant le véhicule, et déguisés en soldats confédérés, ils croisent une troupe qui s’avance. De loin, les uniformes sont gris et le con Tuco hurle alors « vive la Confédération ! ». Dommage… ce n’tait que la poussière du chemin sur des uniformes bleus de Yankees. Les voilà prisonniers en camp – où Sentenza joue le sergent. Il escroque les prisonniers et fait vendre leurs effets par ses complices, dont le caporal Wallace (Mario Brega), gros tas sadique qui adore tabasser les prisonniers sudistes récalcitrants, tandis qu’un orchestre imposé joue de la musique pour masquer les cris. Tuco se fait mettre une raclée par le gros Wallace pour qu’il avoue le nom de la tombe au magot dans le cimetière, mais c’est Blondin qui le sait, pas lui. Sentenza change alors de tactique. Blondin ne parlera pas, autant feindre de s’allier avec lui pour aller chercher l’argent. Non sans recruter six hommes de main dans le régiment pour contrer Blondin. Tuco, lui, est emmené par Wallace en train pour être fusillé plus loin. Il ne tarde pas à tomber volontairement du convoi sous prétexte de pisser, entraînant le gros Wallace qui s’assomme sur une pierre et que Tuco achève sans remord. Sauf qu’il reste menotté à lui et qu’il doit trouver comment couper la chaîne. Un autre train fera l’affaire, les roues vont la couper.


Blondin se méfie de Sentenza et de sa bande. Il descend le premier un petit matin en feignant d’être surpris par sa survenue subreptice ; il descend le second dans un village dévasté parce qu’il le suit sur ordres de Sentenza et que le moment est propice. Tuco, parvenu au même endroit, prend un bain moussant dans un claque et descend un troisième qui le braque, sans savoir que le revolver de Tuco est caché sous la mousse. Ce qui nous vaut une sentence bien frappée, comme souvent dans le film : « quand on doit tirer, on tire, on ne raconte pas sa vie ». Blondin reconnaît le son du revolver de Tuco et le rejoint pour s’associer contre Sentenza, qui garde encore quatre sbires. A deux, ils vont les descendre car ils tirent plus vite. Sentenza se terre.
Les voilà partis pour le village, que seul Tuco connaît. Ils suivent la carte et doivent traverser un pont. Ce sont encore les soldats qui les en empêchent, les Yankees de leur côté qui les font prisonniers, les Confédérés sur l’autre rive. On se canonne, on s’étripe rituellement chaque jour, on ramasse ses blessés. Tout ça pour rien, pour un pont que chacun veut garder intact comme « point stratégique ». Le capitaine yankee en a marre de cette guerre absurde et de ce pont qui tue. Son rêve, il le dit aux deux lascars, serait de le faire sauter et qu’on n’en parle plus. Mais il a des ordres. Tuco a clamé qu’ils étaient là parce qu’ils voulaient s’engager. Le capitaine les prend sous son aile pour leur montrer que c’est idiot. Lors d’une attaque traditionnelle à mi-journée, Tuco et Blondin avisent des explosifs dans une caisse. Ils profitent de la trêve destinée à ramasser les blessés pour mettre la caisse sur une civière et aller piéger le pont. Le capitaine est blessé, mourant, mais veut survivre jusqu’à entendre l’explosion du pont. Il est vite soulagé.


Une fois le pont ruiné, les troupes vont s’amuser ailleurs et les deux compères peuvent traverser à gué sans problème. Ils trouvent le village, l’église détruite, et le cimetière. Blondin, humain, assiste aux derniers instants d’un jeune Confédéré en lui faisant fumer l’un de ses cigares, dont il semble avoir une provision sans jamais se réapprovisionner ; pendant ce temps, Tuco l’avide enfourche le cheval et galope pour être le premier. Blondin, avisant un canon, y applique le bout incandescent de son cigare et tire. Tuco tombe. Il court à pied jusqu’au cimetière. Mais, avec la guerre, il est devenu immense et Tuco le con erre en courant entre les tombes, ayant le tournis (ainsi que le spectateur à cause de la caméra). C’est qu’en piégeant le pont, menacés de sauter avec lui en cas de fausse manœuvre, chacun a livré à l’autre sa bribe d’information sur le magot : le cimetière s’appelle Sad Hill (la colline de la tristesse) et sur la tombe est marqué Arch Stenton. Blondin avait donc dit vrai, il n’a pas menti pour que Tuco le sauve de la soif.
Tuco trouve enfin la tombe d’Arch Stenton. Il creuse avec une planche de cercueil mais Blondin, qui l’a rejoint tranquillement, lui jette une pelle et énonce une nouvelle sentence définitive : « il y a deux sortes de gens : ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent. Tu creuses » Une seconde après, une nouvelle pelle est jetée. C’est Sentenza qui les a suivis. Sauf que le magot n’est pas dans la tombe, le cercueil ne recèle qu’un squelette ancien. Blondin n’a pas tout dit mais sait où il est. ll va s’écarter d’eux, inscrire le nom sur une pierre, et que le meilleur tireur gagne. Longs moments de caméra sur les visages, les mains, l’attente. Avec une musique lancinante. Pas difficile : Blondin est le meilleur. Il abat Sentenza, tandis que Tuco cherche frénétiquement à tirer mais son revolver est vide. Blondin en a ôté les balles pendant qu’il dormait. Il le fait donc creuser là où il faut et Tuco sort six sacs de pièces d’or très lourds. Blondin reprend alors le contrat initial : part à deux.



Mais il fait monter Tuco sur une croix branlante et se passer la corde autour du cou, mains attachées dans le dos : les dollars, ça se mérite. Il s’éloigne à cheval, laissant le complice méditer sur sa fin dernière. A distance, misant sur son habileté mais aussi sur la chance (une sur deux), il tire pour couper la corde. Dieu le veut, il réussit. Tuco a sa part, lui la sienne (mais pas de cheval pour la porter), stridulations de coyote de la musique de Morricone, fin de l’épisode – qui a duré près de trois heures.
On ne s’est pas ennuyé. A chaque scène qui tourne mal, un retournement de situation intervient, souvent comique. L’action rebondit, toujours dans le même sens : le magot, le seul sens de la vie pour un Yankee d’origine. Il aurait pu n’y avoir qu’un seul gagnant, le plus habile, le plus intelligent, le plus complet. Mais il y en a deux, l’autre est un pauvre gars qui mérite aussi de vivre.
Celui qui se dit le Bon est anarchiste et perso, un sans nom comme la tombe du magot, fils de pute comme les deux autres, en plus humain ; le Truand est un bâtard à l’humanité blessée ; il n’y a que la Brute qui soit un robot sans âme, un pro à l’américaine sans rien d’humain. Et pourtant, on aimerait y croire : le Bon serait l’Europe idéaliste, la Brute l’ordure Poutine, le Truand le foutu Tromp. Mais ce n’est pas si simple. De leur point de vue, chacun a partiellement raison ; leur tort est de se croire missionnés pour gagner seul, sans aucun égard pour les autres. Or nous voulons croire que la Force ne crée pas le Droit et que l’entraide est un bien mutuel… Toute l’Evolution d’Homo Sapiens. Le miracle de Sergio Leone est donc cet équilibre ; il ne prend position ni pour l’un, ni pour l’autre, mais les laisse vivre leur vie, s’affronter, et voir ce qu’il en reste.
DVD 2025 03 16 Le Bon, la Brute et le Truand (Il buono, il brutto, il cattivo), Sergio Leone, 1966, avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè, Mario Brega, MGM 2006,doublé Allemand, Français, Anglais, 2h51, €10,00, Blu-ray MGM 2020, anglais, français, €14,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
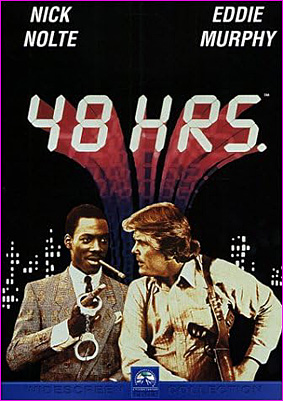




















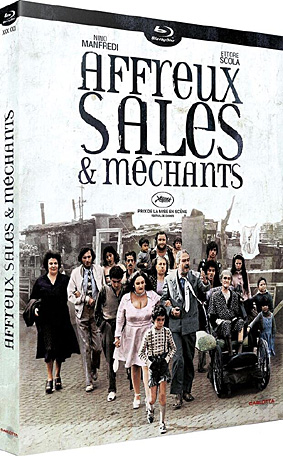







Commentaires récents