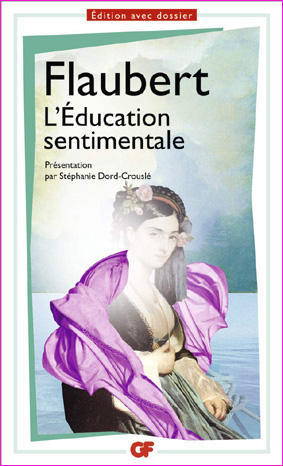
L’argent, c’est du pouvoir. Les Français affectent de mépriser l’argent mais ils aiment le pouvoir. Flaubert, observateur aigu de ses contemporains, ne s’y est pas trompé. « C’est qu’à son insu il avait ce bel aplomb de l’homme qui paie et qui est convaincu qu’on l’estime. Cet aplomb-là n’a pas son pareil dans le monde ; rien ne le vaut et rien n’en approche. »
Mais Flaubert n’est pas Zola, il ne se sent pas investi d’une mission post-chrétienne à éclairer le monde par l’exemple misérabiliste. Il n’est pas dupe des bons sentiments. L’argent, ce vil argent, est un moyen : le moyen du pouvoir. « De deux hommes qui dînent ensemble au restaurant, c’est celui qui paie qui s’assoit le plus lourdement sur sa chaise, qui en fait craquer le dossier, qui appelle le garçon de sa voix la plus haute et s’emporte à cause du canard trop cuit et de la friture manquée. Dans un débit de tabac, c’est celui qui paie qui choisit le plus longuement le cigare convenable et qui repousse la boite avec le plus de violence en se plaignant amèrement du monopole ; l’ami qu’on régale se contente de rire et allume ce qu’on lui a donné. »
Le Français affecte de mépriser l’argent, docile en cela aux leçons de l’Église (qui a ramassé tout pour elle jusqu’à la nationalisation révolutionnaire). Mais il se couche devant le pouvoir et adore manifester le sien auprès du sexe « faible » (c’est ainsi qu’on disait). « Chez une femme de mœurs faciles, c’est encore celui qui paie qui essuie ses bottes sur les coussins du sofa, qui lâche ses bretelles et déboutonne son gilet pour être plus à l’aise, qui prend la taille de la femme de chambre devant la maîtresse de maison, mâchant son cure-dents, riant à ses propres bons mots et débitant des ordures. »
Mais le pouvoir, qu’est-il sinon le consentement des autres ? Ni la grosseur de la bite, ni l’épaisseur de la liasse, ni le prestige de la fonction ne font l’homme. C’est la révérence de cour qui fait que les puissants sont puissants et les riches arrogants. Flaubert se moque des moralistes culs serrés qui affectent de mépriser ce qu’ils ne peuvent atteindre. « Vive l’homme qui paie ! Son insolence est justifiée par la vénalité de ce qu’on achète, et sa confiance en lui-même par l’empressement qu’on met à lui tout vendre. Honneur à lui ! gloire à lui ! Chapeau bas, messieurs, c’est notre maître à tous. »
D’ailleurs, dès que l’on donne un peu de pouvoir, d’argent ou d’accès au sexe au quidam, il s’empresse de retourner sa veste ! Il joue les petits chefs (comme ces flics qui vous contrôlent ou ces employés des guichets publics qui se sentent l’Administration à eux tout seuls), il prend des mœurs de nouveau riche (comme certains politiciens des trois sexes+), il foule au pied toute morale sexuelle en maniant des filles faciles du tiers-monde et jusqu’à des enfants (tel ces artistes qui se sentent au-dessus des lois). Le quidam est un mauvais en puissance : il suffit qu’on lui assure l’impunité.
Flaubert a bien raison : ce n’est pas l’argent qui est méprisable, mais bel et bien celui qui s’en sert pour flatter son ego et exercer son pouvoir. Car « le pouvoir », voilà le grand mot !
Toutes les citations sont tirées de la première Éducation sentimentale, 1845, chap. XV,
Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, 1869, Flammarion 2013, 624 pages, €5.20
Gustave Flaubert, Œuvres de jeunesse, Pléiade Gallimard 2001, 1667 pages (p.919), €59.00


Commentaires récents