Etait-on sage en juillet 1907 ? Alain en doute, tant la passion amoureuse, fouettée de pulsions hormonales, tient au ventre des jeunes gens, embrase leur cœur et submerge leur esprit. « Don Juan était devenu à peu près fou de l’amour qu’il témoignait pour la belle Elvire. »
Mais celle-ci est sage femme, une Minerve, nom romain d’Athéna, qui règne avec Jupiter et Junon dans l’Olympe. Elvire n’exclut pas la passion, mais elle la juge à sa juste mesure, selon l’humeur antique portée à la tempérance, et qui se garde avant tout de l’hubris. Ce vertige d’orgueil et de pouvoir qui transgresse toutes les normes, piétine toutes les lois, n’affirme que soi et sa démesure. Don Juan serait bien de ceux-là…
« Elle, en des discours sensés, rappelait des vérités trop connues, analysait les causes et les effets des passions, se transportait dans le temps à venir, expliquait d’avance l’ingratitude et l’injustice des amants, les tristesses qui suivent les joies, comme aussi les sévères jugements du monde, et terminait par un magnifique éloge de la sérénité, de l’amitié, de la paix et de la raison ». Quoi, pas d’enthousiasme chez cette Elvire, pas de transports, pas de possession par la passion ? Don Juan n’est qu’un spectacle pour elle, une curiosité à analyser. Et « que peut faire la force, dès qu’on cherche consentement ? », demande malicieusement Alain.

Don Juan se sent comme un démon sans puissance, son énergie soufflée par cette belle santé sensée. Il part se pendre. Mais, au dernier moment, il aperçoit par la fenêtre une autre belle jeune femme qui lui envoie des baisers. Il délaisse aussitôt le nœud coulant et s’empresse auprès d’elle, la séduit et la possède. « Elle se donne à lui en gémissant de bonheur ». Cette fois, il a réussi, et la belle consent avec jubilation. Don Juan est-il comblé ?
Non point, tant le désir est insatiable, tant le feu consume tout, tant ce qui est pris n’a plus de goût. « Il s’aperçoit bientôt, à n’en pas douter, que cette femme est véritablement une folle, que sa famille tient enfermée par ce qu’elle pense et agit tout le long du jour comme elle vient de faire tout à l’heure ». Alors Don Juan comprend en un éclair que la frénésie sexuelle n’est pas l’amour, que lui est fou comme elle, la nymphomane guidée par son vagin, c’est-à-dire inadapté à ce monde humain de raison sociale et de passion domptée. Cette fois, il se pend.
L’amour, comme toute passion, doit être contenue, maîtrisée, domptée, suggère Alain. Certes, c’est plus facile à énoncer qu’à accomplir, mais telle est la sagesse – il en montre la voie. Cela ne veut pas dire abstenez-vous, comme les pères de l’Église, aimez, mais ne faites pas n’importe quoi : l’autre existe lui aussi, il ressent comme vous, il ne faut pas le blesser. Votre passion ne doit pas le dévorer, mais l’envelopper, le réchauffer, l’entraîner. Séduire n’est pas violer ; aimer n’est pas butiner de fleur en fleur en les prenant toutes avant de les jeter pour une autre plus jeune, plus belle, plus désirable.
Cela s’applique aux deux sexes, bien entendu ; les garçons n’ont pas le monopole du désir sexuel hors limites. Le satyriasis et la nymphomanie sont des pathologies du sexe, des obsessions qui n’ont rien à voir avec « l’amour ».
Alain, Propos tome 1, Gallimard Pléiade 1956, 1370 pages, €70,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

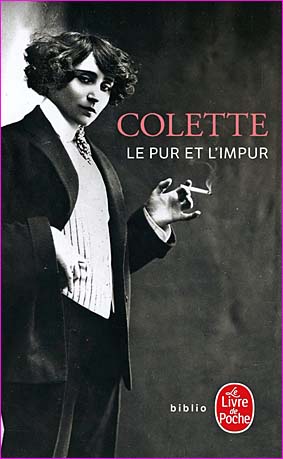
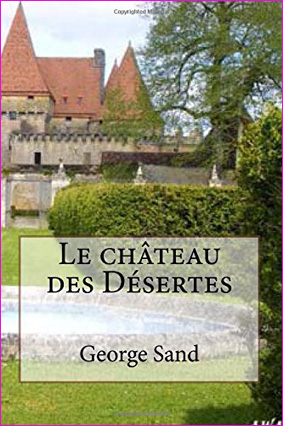
Commentaires récents