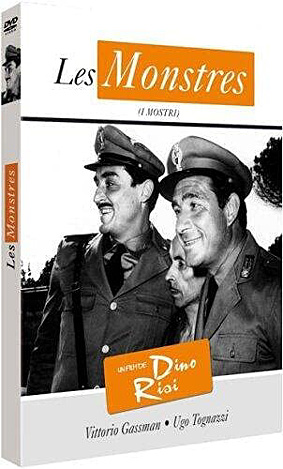
Une série de sketches sur les malversations, les escroqueries, les malveillances des hommes. En tout 19 qui font dans la caricature, non sans humour noir. Le cynisme en noir et blanc se porte bien.
Le père dit à son gamin de frapper le premier plutôt que de défendre ou de se laisser faire ; de ne croire personne ; de profiter de toutes les occasions pour resquiller, arnaquer, voler. Ainsi mange-t-il cinq gâteaux à la pâtisserie et n’en déclare que deux ; ou se fait passer pour un invalide de guerre amputé d’une main et boiteux, pour ne pas faire la queue comme tout le monde. Le fils tuera son père lorsqu’il sera adulte.

Un pauvre de famille nombreuse se lamente de ne pouvoir faire soigner son enfant, payer le docteur, les médicaments ; puis il file à mobylette non pas pour trouver du travail mais pour… assister à un match de foot. Deux orphelins mendient à la sortie d’une église, le plus jeune, un adolescent, joue de la guitare et chante. Il est aveugle. Un médecin spécialiste passe et propose de le soigner gratuitement. Mais le filon est trop juteux et l’aîné s‘empresse de filer avec son aveugle pour garder sa poule aux œufs d’or. Tant pis pour le gamin.

Un président de chambre au Parlement vit à Rome dans un monastère lorsqu’il doit siéger. Loin de sa femme et de ses chiards, il se fait servir par de jeunes moines aux petits soins, soigneusement dressés. Un collègue vient l’enjoindre de faire cesser une enquête d’un fonctionnaire intègre qui a constaté une survalorisation des terrains vendus à l’État pour construire des HLM. Il élude. Lorsque son secrétaire le prévient qu’un général veut le voir sur le même sujet, il le reçoit dans son bureau mais se fait aussitôt appeler pour affaire urgente ; d’obligations en obligations, il sera absent toute la journée et lorsqu’il reviendra tard le soir, le général est encore là. Mais il est trop tard pour invalider le contrat. Pas trop tard au contraire pour que le vieux militaire ait un malaise et parte à l’hôpital. Le parlementaire ne voulait pas prendre partie ; sa vertu n’était que des mots, laisser faire sa règle. Tant pis pour les hommes. Il met le vieux à la retraite d’office.

Même chose pour ce couple de spectateurs, l’homme et la femme, qui regardent un film sur la guerre au cinéma. Lorsque des nazis abattent froidement des civils italiens, dont un enfant qui pleure, l’homme se penche vers son épouse pour lui dire : « tu vois ce petit mur surmonté de tuiles, ce serait bien pour notre maison, tu ne trouves pas ? » L’indifférence à ce qui n’est pas soi, l’oubli, le monde qui commence ici et maintenant.
Tout fier de s’être enfin payé sa Fiat 500 neuve, un père de famille téléphone à sa femme qu’ils l’attendent avec les enfants pour voir la merveille. Il mettra bien une heure. C’est qu’entre temps, il va parader sur les boulevards avec une jeune pute à ses côtés, qu’il paye cher juste pour la frime. Un autre, marié, rompt avec sa maîtresse, une jeune femme amoureuse de lui qui ne réclame rien. Il se fait victime, dit que c’est pour elle, que lui souffre, avec des trémolos dans la voix. Reparti, il arrive dans un appartement où l’attend une compagne. Mais elle n’est pas sa femme, à qui il téléphone qu’il a dû rester tard au bureau ; il s’agit d’une autre maîtresse…

Égoïste, menteur, queutard, vaniteux : tel est le mâle italien des années 60 vu par Dino Risi. Une vision juste qui ne va pas sans ironie. Tel cet homme qui se fait maquiller, coiffer, manucurer avec soin – alors qu’il va lire à la télé un texte de saint François, le pauvre d’Assise, empli de vanité mais avec des fleurs dans la voix. Tels aussi ces deux plagistes caressant la même jeune femme entre eux sur le sable. Elle se lève, va se baigner, les mains des hommes couchés poursuivent leurs caressent – puis se rejoignent. Au fond, ce n’est pas la femme qui leur importe, mais leur désir. Dans « l’opium du peuple », qui concerne la télé, une jeune femme invite ses amants chez elle pour baiser, alors que son mari est présent. Mais il est tellement absorbé par le programme télé qu’il ne voit rien, n’entend rien, drogué par l’écran, entièrement plongé dans le virtuel. Le jeune amant peut aller derrière lui pieds nus et torse nu chercher un whisky – avec glaçons qui tintent – sans que le mari ne tressaille. Tout au plus dit-il « chut ! » lorsqu’un glaçon tombe à terre. Le désir encore, que cherche à susciter « la muse », une grand snob des lettres qui assure un prix à son poulain, qu’elle voudrait bien baiser mais qui s’avère pédé, un écrivaillon qui écrit comme il cause avec force fautes de grammaire et d’orthographe (pourtant l’italien est simple à écrire !). Au fond, le désir est partout, ni homme ni femme n’en ont le monopole.

Mais le désir de gagner de l’argent est plus fort chez les hommes. Un quadrille en grosse Chrysler noire enlève une petite vieille qui sort de l’église : ils ont besoin d’une vieille pour la jeter dans la piscine pour une scène du film qu’ils tournent ; la petite vieille devra refaire le plan plusieurs fois. Un soldat vient à Rome pour enterrer sa sœur, assassinée. Il a découvert son journal, où elle notait tous ses rendez-vous et « des numéros de téléphone » : 35 000, 25 000… Il se présente dans un grand journal pour dire sa découverte et qu’ils en fassent ce qu’il faut… mais pas sans contrepartie en lires. Sa sœur, il s’en fout, elle était pute et il ne s’en aperçoit pas, elle est morte ; son journal vaut de l’or, il le veut. Désir égoïste encore pour cet ancien boxeur de revenir sur la scène, via un ancien collègue champion qui se la coule douce désormais dans une guinguette de plage avec sa femme. Il l’incite à remonter sur le ring pour un tournoi afin de remporter un gros lot. S’il ne ne couche pas à la première reprise, il permettra à son ami de gagner de l’argent. Le vieux sera tout bonnement démoli par un jeune teigneux et terminera en chaise roulante, mais l’argent est gagné.

Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi se déchaînent, jouant tous les rôles, parfois même féminins. Un égoïsme féroce qui explique combien le vote citoyen mobilise peu en Italie aujourd’hui. Individualisme d’abord, la débrouille, la resquille. Car l’homme qui veut témoigner qu’il a bien vu l’accusé dans un train se voit démonter par l’avocat : il énumère tous ses petits arrangements avec la coiffeuse, la différence de prix entre la classe de première et celle de seconde, et ainsi de suite. Le témoin, citoyen modèle, en est presque accusé de mentir à sa femme, à son employeur, de voler. Quant au père qui initiait son fils à truander, il se lamentait sur les parlementaires véreux et corrompus… Chaque pays a les dirigeants qu’il mérite !
DVD Les Monstres (I Mostri), Dino Risi, 1963, avec Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Michèle Mercier, Marino Masé, Lando Buzzanca, Marisa Merlini, Opening 2009, 1h27, €9,71 blu-ray €14,99

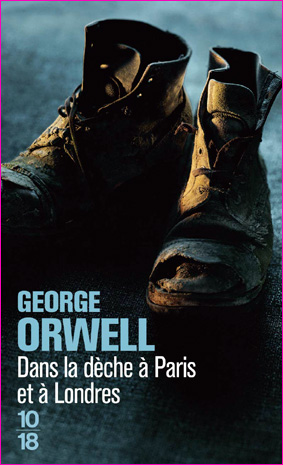










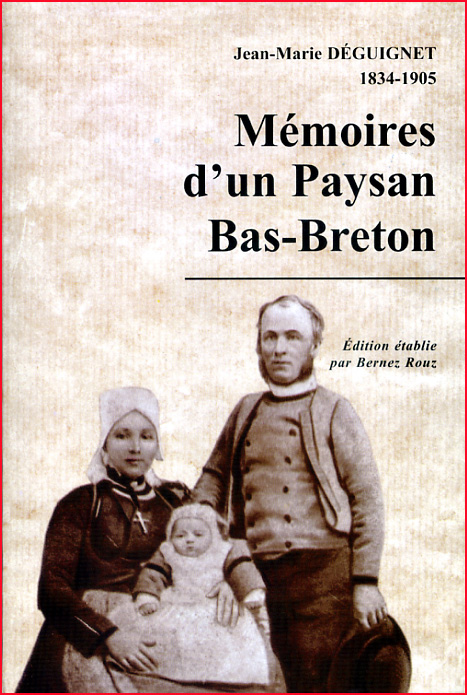
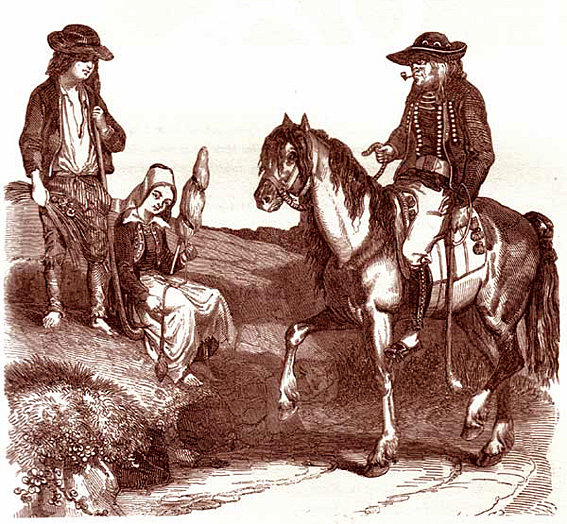
Commentaires récents