J’ai publié sur ce blog il y a quelque temps une note raillant le « c’était mieux avant » entonné par tous les nostalgiques d’un âge d’or qui n’a jamais existé. Il était le temps de leur jeunesse, l’époque qu’ils comprennent enfin trente ans plus tard et dont ils ne retiennent que le côté positif, un monde en apparence plus stable, aux mœurs engluées encore dans « la tradition » (qu’ils ne cessaient de secouer). Mais le monde évolue sans cesse, probablement pas plus le nôtre que celui d’avant. Le désir d’arrêter le temps, de stopper le mouvement des choses, est aussi vain que ridicule, Bouddha l’avait déjà montré il y a 3000 ans.
Ce désir d’éternel ici-bas manifeste une peur panique de ne plus être dans le courant, plus à la hauteur, perdu dans ce qui arrive, de quitter la jeunesse pleine de santé et de désirs neufs. Cet état d’esprit « réactionnaire », au sens premier de réaction à ce qui arrive, pourrait être une tempérance de la raison qui examine les changements pour choisir lesquels suivre et lesquels mesurer. Mais c’est pire : un refus pur et simple d’accepter que le monde bouge, que l’histoire aille son chemin, que les mœurs évoluent – un refus pur et simple de s’adapter, voire de grandir…
On en voit tant de faux ados de 35 ans, de faux révolutionnaires de 60 ans, des vieux-jeunes habillés comme à 16 ans qui roulent des épaules ou se maquillent comme à l’âge bête. Ils veulent figer la vie, tout comme certains écolos veulent revenir avant le néolithique, cette période où l’homme a cultivé la nature plutôt que d’y prélever. Tout comme les syndicalistes veulent « garder leur emploi » et leurs zacquis, tant pis si les Chinois, les Brésiliens ou les Allemands produisent plus vite, de meilleure qualité et moins cher et si leur entreprise fait faillite faute de se remettre en cause. Tout comme les moral-socialistes veulent imposer un monde des idées sans aucune idée des forces réelles ni des conséquences infernales de leurs « bonnes intentions ». Tout comme les intégristes de toutes religions (la juive, la chrétienne, la musulmane, la communiste, l’écologique) veulent revenir au monde d’hier, figé, intact, créé une fois pour toutes par Jéhovah, Dieu, Allah, l’Histoire « scientifique », ou Gaia la Mère.
Que la femme aspire à être traitée en égale de l’homme, quelle horreur pour ces croisés du retour où les mâles étaient les maîtres et mesuraient leurs richesses à leur horde de femelles et à leurs troupeaux de bêtes et d’enfants ! Mais quel est ce monde merveilleux « d’avant » auquel ils aspirent ? Pour les islamistes, rien de plus simple : tout est écrit dans le Coran. Même si le Coran n’a jamais été « écrit » par Mahomet – qui ne savait ni lire ni écrire – mais issu de multiples disciples qui prenaient note des prêches du Prophète inspiré par l’archange Djibril, des docteurs de la foi ultérieurs qui ont simplifié, raccordé, corrigé, mis en forme, des politiquement correct de chaque époque où s’est composé le Livre définitif. Mais pour les chrétiens intégristes ? Pour les catholiques de Civitas inspirés des protestants évangéliques américains ? Est-ce au monde la Bible auquel ils aspirent ? A celui du Christ en son exemple vécu ? A celui revu et corrigé par le misogyne Paul de Tarse ? Ou simplement au monde bourgeois leurs grands-parents ?
Justement, ce monde des grands-parents est évoqué par un écrivain autrichien né en 1881 et mort volontairement en 1942. Stefan Zweig avait 19 ans en 1900, il décrit les mœurs de l’empire austro-hongrois aux trois-quarts catholique :
« Qu’un homme eût des pulsions et qu’on lui permît de les ressentir était quelque chose que la convention était bien obligée d’accepter en silence. Mais qu’une femme pût être soumise à des pulsions identiques, que la Création, pour ses desseins éternels, eût aussi besoin d’un pôle féminin, l’admettre sincèrement eût été une entorse à la notion de ‘sainteté de la femme’. A cette époque préfreudienne, on se mit donc d’accord pour imposer cet axiome qu’une créature de sexe féminin n’éprouve aucune sorte de désir physique autre que celui éveillé par l’homme, ce qui, bien entendu, ne pouvait être officiellement autorisé que dans le mariage. Mais comme même à cette époque morale l’air était saturé d’agents érotiques infectieux, fort dangereux, spécialement à Vienne, une jeune fille de bonne famille, de la naissance jusqu’au jour où elle quittait l’autel au bras de son époux, était tenue de vivre dans une atmosphère absolument stérile. Pour mettre les jeunes filles à l’abri, on ne les laissait pas une minute seules. On leur donnait une gouvernante chargée de faire en sorte que pour rien au monde elles ne fissent un pas hors de leur maison sans être surveillées, on les accompagnait à l’école, à leur cours de danse, à leur cours de musique, et on revenait les chercher. On contrôlait tout livre qu’elles lisaient, et surtout on occupait les jeunes filles pour les distraire de toute pensée potentiellement dangereuse. Elles devaient pratiquer le piano, apprendre le chant, et le dessin, et des langues étrangères, et l’histoire de l’art, et l’histoire de la littérature : on les cultivait et on les surcultivait. Mais tandis qu’on s’efforçait de leur donner la meilleure culture et la meilleure éducation mondaine qu’on pût imaginer, en même temps, on veillait soucieusement à les maintenir dans une ignorance de toutes les choses naturelles qui est aujourd’hui [1941] inconcevable pour nous. Une jeune fille de bonne famille ne devait pas avoir la moindre idée de l’anatomie d’un corps masculin, ni savoir comment les enfants viennent au monde, puisque l’ange devait évidemment entrer dans le mariage le corps immaculé, mais également l’âme absolument ‘pure’. Chez la jeune fille, être ‘bien éduquée’ revenait purement et simplement à ‘s’aliéner la vie’, et cette aliénation a été souvent celle d’une vie entière pour les femmes de cette époque » p.929.
Que tous les réactionnaires, ceux qui se réfugient dans la religion à la lettre pour ne surtout plus décider de rien, les tentés par le vote extrémiste à droite, voire les simples conservateurs, méditent ces lignes. Le monde d’hier était un monde étouffant, contraignant, aliénant. Ce n’est pas parce que vous avez peur de la liberté – peur de ne pas être à la hauteur des choix à faire – que vous devez vous réfugier dans la tyrannie d’une caste de prêtres, d’imams ou de politiciens qui promettent tous l’au-delà ou le lendemain, mais jamais ce qui compte : l’ici et le maintenant.
Stefan Zweig, Le monde d’hier – souvenirs d’un Européen, 1942, traduction Dominique Tassel, Romans, nouvelles et récits tome 2, Gallimard Pléiade 2013, €61.75



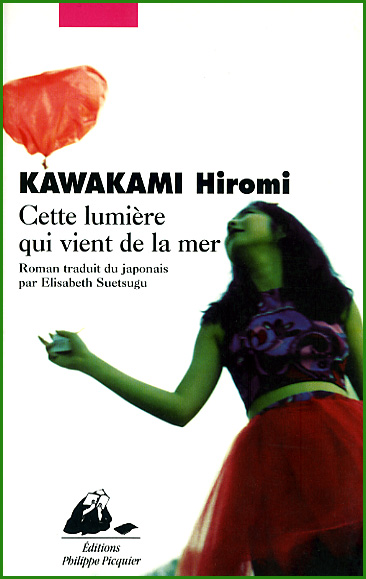

Commentaires récents