
Les Yankees savent penser leur histoire, même si elle n’a qu’un peu plus de deux siècles. La chemise de métal plein est celle de la balle blindée, symbole de la technique avancée des soldats des États-Unis. Pour le Vietnam, les Marines s’entraînent, conditionnés psychologiquement selon les meilleurs techniques des docteurs fous à la Orange mécanique – ce fantasme du pouvoir sur le cerveau des années soixante. Puis ils sont envoyés au casse-pipe, dans une jungle qu’il n’ont jamais connue, avec de petits hommes verts qu’ils n’ont jamais compris. Évidemment, tout se passe mal, c’est Le Merdier, titre français du roman de Gustav Hasford The Short Timers – les minuteries. Les soldats doivent en effet être formatés pour être de parfaites horloges, qu’il suffit de remonter.

C’est l’objet de la première partie du film qui est un constant aboiement du sergent instructeur Hartman (R. Lee Ermey), un formateur raide et viriliste qui insulte et donne des surnoms ridicules pour avilir les hommes. Il y a Guignol parce qu’il répond original en voulant être le premier de son immeuble à inscrire un mort au palmarès (Matthew Modine), Blanche-Neige parce qu’il est noir (Peter Edmund), Cow-boy parce qu’il frime (Arliss Howard), Baleine parce qu’il est gros (Vincent D’Onofrio). Tous les gars sont pour lui des gonzesses, signe d’homosexualité refoulée et de dédain des femmes, et il les appelle Mademoiselle – tant qu’ils ne sont pas Marines, ils ne sont pas des hommes.

Le drill consiste à les faire renaître dans leur nouveau statut, avec leur nouveau nom, comme des born again de la foi. Mais la foi des Marines est de tuer. Ils « assistent Dieu », pas moins, à ce que hurle l’instructeur. Bien-sûr, certains vont résister : ils seront sous-officiers ; d’autres vont craquer : Baleine finira mal et révèlera son temprament de brimé, frustré, donc psychopathe. Pourtant il était bon tireur, comme tous les plus cons car ils ne réfléchissent pas. Je me souviens de mon capitaine, au service militaire, qui nous faisait courir cinq cents mètres avec un sac chargé à 20 kg sur le dos, avant de nous faire aligner couchés pour tirer : nos scores étaient bien meilleurs qu’à froid parce que nous ne pensions pas. Nous saisissions le fusil, alignions la mire avec la cible et effleurions la détente. Plutôt que de trop réfléchir à la position, au souffle, à la mire, donc de trembler, de perdre le fil de l’objectif.

Une fois Marines, les garçons sont affectés. Guignol au service de communication des armées parce qu’il a fait un peu de journalisme au collège ; les autres en unité au front. Direction Da Nang, la grande base américaine. Et c’est là que commencent les choses sérieuses.
Le Vietcong profite de la fête du Têt pour lancer sa grande offensive, prenant tout le monde de cours, les renseignements américains en premier (une fois de plus…), ancrés dans leurs certitudes que tout sera comme d’habitude. Le fameux calcul des probabilités – qui ne va pas dans le sens désiré une fois sur deux ! C’est la bataille ; il faut reprendre le terrain, notamment dans les villes envahies comme Hué.
Le combat de rues, même en apparence désertes, est un traquenard possible où ceux qui avancent sont vulnérables à ceux qui sont remparés et les attendent. Ils suffit d’un seul tireur pour tenir en échec toute une compagnie. C’est le moment le plus fort du film. Le sous-officier s’est laissé égarer de cinq cents mètres du plan, il veut couper pour rattraper. Il envoie le mitrailleur en éclaireur – et il se fait tirer dessus. Non pour le tuer net mais pour le blesser à la cuisse afin qu’il hurle et que ses copains cherchent à le sauver : cela fera des cibles en plus. Trois seront descendus par ce piège diabolique. Le tireur en immeuble s’avérera une tireuse (Ngoc Le) : pas besoin d’avoir subi le drill Marines pour aligner les cibles !

Le spectateur est captivé par ce dilemme constant : faut-il aller au secours du copain ou réfléchir pour assurer les autres ? La pression est trop forte et fait craquer les meilleurs comme les plus brutes. L’Américain est tout action, il déteste penser ; l’opinion commune lui suffit. Il fonce donc et se fait ramasser. Quand le sous-chef reprend la main, il est trop tard, trois hommes au tapis – tous morts, lentement, balle après balle pour les faire brailler et accentuer la pression sur les autres.
Car c’est cela la guerre, la vraie guerre : pas l’entraînement Marines, encore qu’il soit physiquement utile et prépare mentalement à obéir par réflexes aux ordres dans l’action – mais la duperie des apparences et le chantage émotionnel, la mort sans état d’âme que l’on donne comme on distribue des bonbons, femmes et enfants compris car ils sont tous ennemis, donc dangereux. La guerre, c’est la barbarie, l’inhumanité. Seule une horloge peut fonctionner sans penser, mais « les Marines ne sont pas des robots », dit un protagoniste. Ils sont nés pour tuer, born again en tueurs, instruments de l’armée pour la patrie américaine.
Film « interdit aux moins de 12 ans » – on le comprend – mais film réaliste et prenant sur la guerre et les guerriers. Pas de romantisme à la Apocalypse Now, mais des faits.
DVD Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987, avec Modine, Matthew, Baldwin, Adam, D’Onofrio, Warner 2009, 1h56, €14,99 Blu-ray €13,98

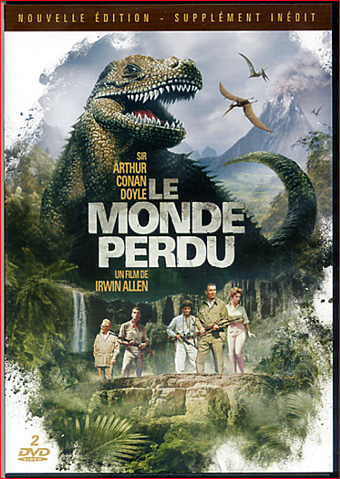





Commentaires récents