Nous sommes devant un cadeau de Noël offert pour le millénaire par la mise en film d’un roman de Stephen King. Un condamné à mort noir et gigantesque est accusé du viol et du meurtre de deux fillettes de Louisiane. Mais il est incapable de tuer, plutôt doté d’une trop forte sensibilité aux malheurs du monde. Il ressent, comme un medium ; il guérit en absorbant le mal, comme un chamane. Tout le film est donc une tragédie dont on connait la fin – mais qui doit se dérouler implacablement.
Paul est un vieillard de 108 ans en maison de retraite (Dabbs Greer, en réalité 82 ans). Il pleure lorsque l’on passe un vieux film de Fred Astaire parce qu’il fut le seul film qu’ait vu un condamné à mort qui n’avait jamais été au cinéma. Devant son amie de plus de 85 ans qui pourrait être sa fille (Eve Brent, en réalité 70 ans), il se souvient des moments qu’il a passé comme chef du bloc E des condamnés à mort au pénitencier de l’Etat Cold Mountain. C’était en 1935, à l’époque il avait 44 ans (Tom Hanks). Atteint d’une infection urinaire, il souffrait le martyre à chaque fois qu’il allait pisser – ce qui aide aux souvenirs. Ce jour-là, un camion pénitentiaire roulant sur l’essieu livre un condamné : John Coffey (Michael Clarke Duncan) – 1m96.
Ce John (« comme le café, mais ça ne s’éc’it pas pa’eil ») paraît doux et simple d’esprit, mais doté de pouvoirs qui semblent surnaturels comme de compatir au point d’éprouver et de prévoir le mal qui va se produire – mais trop tard. Il annonce que cela va difficilement se passer avec le condamné à mort William Wharton, dont l’épaule est tatouée du nom de Billy the Kid, meurtrier de trois personnes et demi (une femme enceinte) dans un braquage. Celui-ci est le mal incarné, pervers infantile obsédé de sexe et qui ne supporte aucune frustration. Le symbole du mal en lui sont ses dents pourries. On sait l’obsession américaine pour la blancheur et l’alignement de cette seule partie du squelette qui soit visible – une sorte de vérité intérieure révélatrice. Simulant le camé (par une belle performance d’acteur, mais aussi parce que le diable est celui qui prend toutes les formes), il attaque les gardiens qui le mènent en cellule et ce n’est que par l’intervention de « Brutal », surnom d’un maton costaud, qu’il parvient à être maîtrisé.
Cette scène révèle combien Percy, gardien stagiaire et neveu de l’épouse du gouverneur de l’Etat, est une fiotte lâche qui ne déverse ses instincts sadiques que lorsque l’impunité lui est assurée. Lors de l’attaque de Wharton, bien que dans l’équipe d’accompagnement, il se garde bien d’intervenir ; lorsque le pédéraste violeur Delacroix se moque de lui, il lui brise trois doigts d’un coup de matraque sur les barreaux de sa cellule ; il écrasera d’un coup de talon la souris qu’a apprivoisé Delacroix, Mister Jingles ; lorsque Wharton le saisit au travers des barreaux et menace de le violer, il en pisse dans son pantalon de trouille devant tout le monde. Percy n’a qu’un rêve : faire griller lui-même un condamné et le voir souffrir atrocement. Lorsque Paul lui offre ce plaisir – pour s’en débarrasser, étant entendu qu’il postulera immédiatement ailleurs – Percy « oublie » volontairement de mouiller l’éponge qui, sur la tête du condamné, assure une transmission immédiate du courant au cerveau. Delacroix va grésiller interminablement, chassant de dégoût les parents vengeurs venus assister au spectacle et réduisant Percy à ce qu’il est : un minable de la pire espèce. La société de 1935 a produit en série ce genre de névrosé pervers qui se rallieront au nazisme, au stalinisme, au pétainisme comme plus tard au maccarthysme sans aucun état d’âme. Dans cette histoire, il sera muté à l’asile psychiatrique où il voulait postuler – mais en qualité de patient taré, pas de gardien.
Son opposé est John, mini-Christ dont la croix depuis tout petit a été de porter tous les péchés du monde. Mais un Christ vengeur – ce qui est plus Ancien testament que Nouveau, tout à fait dans la tradition yankee, moins chrétienne que biblique. Car John va ressusciter la souris de Delacroix, va révéler l’ampleur des crimes de Wharton (dont celui des deux fillettes pour lequel John est injustement accusé), guérir Paul de son infection urinaire puis la femme du directeur du pénitencier atteinte injustement d’une tumeur au cerveau « de la taille d’un citron » ; il va « inoculer » par la bouche en Percy tout le mal qu’il a « aspiré » de ladite femme, ce qui fera Percy tuer Wharton à coups de revolver, bouclant ainsi la vengeance.
Ce simplisme du talion, plus juif que chrétien, est diablement efficace au cinéma. D’autant que les caractères sont eux aussi bien tranchés et que le spectateur ne peut hésiter un seul instant entre le Bien et le Mal : tout est balisé. Comme le directeur (James Cromwell), Paul est un chef plein d’humanité qui considère que la condamnation à mort suffit à la société et qu’il n’est pas besoin d’en rajouter. Il suffirait d’un rien d’ailleurs pour embraser le bloc, les morts en sursis n’ayant plus rien à perdre. Son commandement déteint sur toute l’équipe qu’il appelle « les garçons », même si certains sont plus âgés ou plus grands et plus forts que lui. Ainsi, « Brutal » (David Morse) n’est en rien brutal, mettant sa force au service du bien commun. A l’inverse, Percy révèle tout ce que le métier de gardien de prison peut produire de pire comme tortionnaire et petit chef vaniteux.
L’histoire est longue mais l’on ne s’y ennuie jamais ; j’ai vu trois fois ce film en étant pris à chaque fois. Certes, le « miracle » un peu naïf est pour les esprits crédules, mais ceux qui gardent les pieds sur terre apprécient la force des caractères, bien plus puissante. La proximité sans cesse de la mort élève l’âme – ou révèle l’emprise du mal en soi. Certes, la peine de mort n’est guère mise en cause puisque « personne ne peut rien faire » contre un jury populaire qui condamne à être électrocuté. Mais y aurait-il tragédie si le destin n’avait pas décidé ?
La puissance du film tient dans les relations humaines, durant cette vie. Car il ne suffit pas à Paul et à ses collègues de « faire bien leur travail », comme des apparatchiks nazis ou communistes ; il faut que ce travail pour la collectivité leur paraisse juste. Ce pourquoi Paul et Brutal demanderont leur mutation dans un centre de jeunes délinquants après l’exécution injustifiée de John Coffey.
DVD La ligne verte (The Green Mali) de Frank Darabont, 1999, avec Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan, Harry Dean Stanton, Warner Bros 2000, 3h01 mn, €7.25
Catégorie « Cinéma » sur ce blog




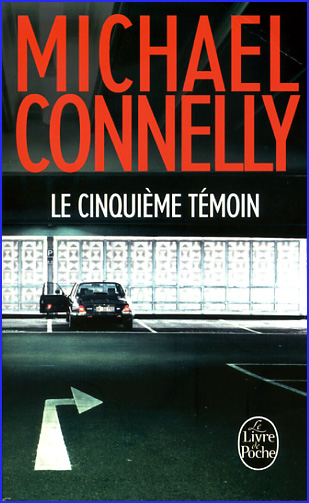
Commentaires récents