Pour réagir contre les stéréotypes, notamment celui qui associe Japonais et samouraï véhiculé par Ruth Benedict, l’auteur veut cerner la part de mémoire qui façonne la modernité japonaise.
L’ère Meiji a figé la mémoire sociale en tradition officielle pour forger une conscience nationale. Ce monument à la gloire de la classe samouraï, au moment où elle disparaissait, servait l’expansion du capitalisme. Le sens du sacrifice, purifié et laïcisé, devenait une éthique du travail rigoureux ; les sentiments d’allégeance se transformaient en règles de conformisme social et en dynamique de groupe adaptée à l’industrialisation. Or, « les racines intellectuelles et culturelles du Japon moderne se trouvent en réalité dans les XVIIe et XVIIIe siècles, époque où règnent les shoguns Tokugawa. C’est au cours de cette période, avant l’impact occidental direct, que le Japon est progressivement entré dans les temps modernes : ce fut en quelque sorte la période d’incubation de la modernité japonaise » p.17.
Le formalisme de la sociabilité permet aux Japonais d’adopter des comportements qui leurs sont étrangers sans provoquer de résistance. D’où le caractère cosmopolite très moderne de la mentalité japonaise. « Nous entendons par cosmopolite non pas l’expression d’une utopique société fraternelle composée de citoyens du monde, mais une mobilité culturelle, une expérience d’affranchissement et de transgression des identités dans un métissage de leurs signes (…) Il n’y a pas pour autant chez les Japonais de renoncement ou de dénégation de leur appartenance culturelle : il s’agit simplement d’un enrichissement du système symbolique. Ce jeu confère à la modernité japonaise une fluidité, une mobilité et, par conséquent, une capacité d’innovation qui font défaut à l’Occident » p.18.
La culture populaire fut l’expression d’une volonté d’indépendance culturelle par rapport à l’aristocratie. Le monde des marchands et des artisans a créé le kabuki et les quartiers de plaisir où naquirent les arts et les modes. Cette culture n’a jamais été entravée par des interdits religieux mais véhicule un pragmatisme où les interdits ne furent jamais d’essence morale mais pour raison d’ordre public. A l’époque Tokugawa, la culture populaire se nourrit d’incessants va et vient entre la ville et la campagne, et les villes vont chercher à s’intégrer au paysage, à intégrer des éléments du paysage : à Edo, certaines rues ont pour perspective le mont Fuji. La ville se voudra une médiation entre l’homme et la nature. Elle se voudra aussi éphémère, changeante, évolutive. Pas de mystique de la ruine, pas de monuments pour l’avenir.
Les calamités naturelles (séismes, incendies, raz de marée, ouragans) ont rendu les Japonais réceptifs au bouddhisme et à sa conception de l’impermanence. L’histoire apparaît comme un mouvement des choses sur lesquelles l’être humain n’a pas de prise. Dans les villes, le temps est esquivé. Dans la société, on privilégie le groupe, pas l’individu, l’empereur n’étant qu’un symbole social. Dans l’existence quotidienne, cela conduit à l’hédonisme, au goût du présent, à la jouissance du moment. La littérature est de mœurs, le théâtre est une catharsis de la vie courante – un instant suspendue -, l’art est au quotidien dans les objets de tous les jours, l’éthique, comme l’art, sont formalistes (kabuki, art du thé, étiquette, rituels, cérémonies). D’où l’importance insigne du symbole, qui en vient à remplacer le réel : « La liaison qu’établissent les Japonais entre l’aspect visuel de la chose et la substance de celle-ci engendre un phénomène d’adhésion symbolique particulièrement poussé. Ainsi, celui qui entend pratiquer un sport commencer-t-il par être suréquipé » p.148. La maîtrise de la forme ouvre la voie à l’acquisition de la substance, telle est la notion de kata en karaté-dô.
« Kata se traduit par forme, moule, type. Le mot désigne la forme codifiée d’une pratique et, d’une manière plus générale, d’un comportement. Un kata peut s’apparenter jusqu’à un certain point à ce qu’Elias Caneti définit comme la figure : un « aboutissement de la métamorphose ». L’acquisition d’un kata n’est pas une pure opération d’imitation, c’est-à-dire la reproduction d’un mouvement, d’un geste, sans que celui qui l’exécute soit pour autant transformé par cette opération » p.149. Très important dans la voie du karaté, le kata a une portée universelle dans la transmission du savoir au Japon. « Ce qui prédomine dans le kata, c’est l’acte, sa transmission s’opérant avant tout non-verbale. L’acquisition d’un kata relève d’une tentative de réalisation de la voie (dô). Celui qui enseigne le kata est un relai, non le détenteur du savoir. Il s’agit au demeurant de tendre vers une perfection technique en intériorisant un savoir accumulé. Le kata est bien, en cela, l’expression d ‘une sensibilité collective » p.150.
Il est attendu de tout individu qu’il adopte le comportement correspondant à son statut, qu’il assume un rôle. D’où le narcissisme du rôle, dont le suicide peut être l’acte final lorsqu’on faillit. « On pourrait à l’extrême et par analogie, voir dans cette objectivation imaginaire que réalise le kata une sorte d’événement comparable à ce que Jacques Lacan définit comme le stade du miroir chez l’enfant : une identification, c’est-à-dire la transformation produite chez le sujet lorsqu’il assume une image ». Cela peut aboutir à un affaiblissement de l’ego, au respect des formes pour elles-mêmes et non pour leurs vertus spirituelles. C’est l’envers de la médaille : le mimétisme, le somnambulisme social compensé par la prise en charge de l’individu par le groupe ou la société.
Mais parce qu’elle est formalisée et normée à outrance, la société japonaise laisse aussi des espaces vierges, non balisés. Car dans la conception immanentiste qui prévaut au Japon, aucun œil de Caïn n’y poursuit quiconque. Dans ces espaces se déploie alors l’esprit du plaisir : frondeur, sceptique, cynique et réaliste, le comique bon vivant, la joie de l’instant.
Philippe Pons, D’Edo à Tokyo – mémoires et modernités, 1988, Gallimard bibliothèque des sciences humaines, 464 pages, €32.00

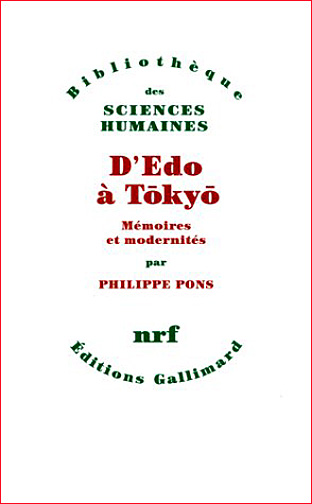
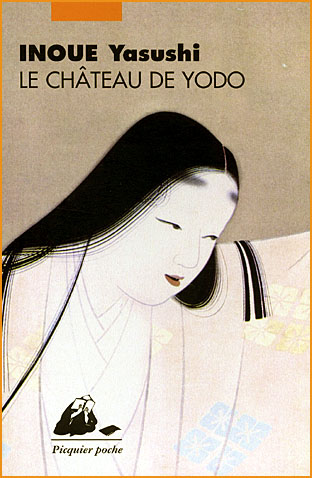

Commentaires récents