
En 1926, une canonnière américaine évolue sur le fleuve Yang-Tsé Kiang pour protéger les intérêts américains, et notamment les missionnaires. Ceux-ci sont idéalistes et aveugles ; ils croient que les relations personnelles pourront les protéger des seigneurs de la guerre comme de la guerre civile entre nationalistes de Tchang Kaï-chek et communistes de Mao Tsé Toung. L’histoire est arrangée pour la gloire yankee, l’histoire réelle est celle des Britanniques contre un seigneur de la guerre du Sichuan dans la région des Trois Gorges cette même année, restée sous le nom d’incident de Wanhsien. S’y colle une histoire d’amour entre un matelot et une sino-américaine, devenue pute par nécessité dans un bordel fréquenté par les marins européens.





Avec le recul, on reconnaît bien là l’impérialisme yankee, sous des dehors de liberté démocratique. Les Chinois sont des coolies, embauchés pour quelques « grattes » afin de faire tout le sale travail du bateau : la cuisine, pelleter le charbon, huiler les machines, le ménage et la lessive. Les Yankees sont les maîtres qui ordonnent et surveillent – pas besoin de faire la guerre de Sécession pour régresser jusque là. Le trublion est le maître de première classe Jake Holman (Steve McQueen), transféré sur le San Pablo (prononcé sand peebles ou galets de sable, d’où le titre américain du film). Lui n’a pas cette habitude d’être servi et entend faire bien son métier en surveillant la machine. Les coolies sont des exécutants, des « singes » qui imitent ce qu’ils ont vu faire, pas des mécaniciens qui comprennent le fonctionnement. Ce pourquoi il va examiner les fonds, puis détecte un jeu dans une bielle qui pourrait mettre en danger la marche du bateau. Le coolie chef nommé Chien (ce qui fait drôle en français…) en perd la face ; il veut se rattraper en réparant et meurt écrasé. Jake, cumulant la réprobation des flemmards esclavagistes blancs et des coolies chinois, est réputé porter malheur.
Le capitaine (Richard Crenna) lui ordonne de former un nouveau coolie chef et Holman choisit Po-Han qui a l’air plus vif que les autres (Mako, d’origine japonaise, d’où sa musculature). Mais sa familiarité avec le Chinois indispose le Yankee de base, en la personne du gros brutasse macho « plouc des collines » Stawski (Simon Oakland). Tous font des paris sur qui pourrait l’emporter du coolie ou du marin. Malgré une boxe ridicule de Po-Han, celui-ci est encouragé par Holman et finit par frapper fort où il faut : dans le bide gras. Le racisme yankee n’en est que plus fort, et englobe Jake qui a soutenu son poulain. Le chef des chefs coolie, car la Chine est très hiérarchique, veut se faire bien voir de l’équipage et envoie Po-Han à terre lors d’une escale où les nationalistes sont virulents. Ils l’attrapent et, sous les yeux de l’équipage tout entier, le soumettent à la torture des Cents morceaux ou lingchi, ce qui consiste à couper des tranches de muscles sur la poitrine jusqu’à ce que mort s’ensuive. Malgré les ordres du capitaine de ne surtout pas tirer pour éviter l’incident diplomatique, Holman désobéit et achève d’une balle de miséricorde son ami qui hurle qu’on l’achève.





L’impéritie du capitaine fait que le San Pablo reste ancré sur la rivière Xiang à Changsha, parce que le niveau de l’eau est trop faible pendant l’hiver. Une foule hostile l’entoure dans de petites jonques mais laisse aller à terre le canot qui porte les dépêches au consulat. Comprenne qui pourra. C’est alors que débute une histoire d’amour entre le marin Frenchy (Richard Attenborough) et une métisse sino-américaine qui parle bien le yankee. Maily (Marayat Andriane, alias Emmanuelle Arsan, autrice immortelle du film porno chic Emmanuelle) est une belle prostituée que tous les Blancs réclament car elle fait moins chinoise que les autres. Elle a des dettes que Frenchy veut rembourser pour la sauver. Mais de gros porcs trafiquants, évidemment yankees, surenchérissent pour la foutre à poil devant tous. Une bagarre éclate, durant laquelle Frenchy, aidé de Jake, enlève la belle pour la mettre en lieu sûr. Il quitte régulièrement le bateau à la nage pour la voir et l’épouser, car les permissions sont interdites, mais le capitaine ferme les yeux. Comme c’est l’hiver, Frenchy attrape une pneumonie et finit par mourir dans le lit de Maily. Les Chinois, qui n’attendaient que cela pour provoquer un incident, cassent la gueule à Holman, tuent la métisse enceinte d’un bâtard blanc, puis accusent le marin de l’avoir tuée. Un procédé typiquement stalinien que Poutine reprend aujourd’hui sans vergogne. Le capitaine refuse de le livrer, malgré l’équipage qui l’exige.
Le capitaine est un officier faible, pris entre des ordres contradictoires. Les États-Unis doivent rester neutres dans la guerre civile, mais défendre les ressortissants américains. Ils ne doivent pas tirer, sauf pour défendre un citoyen américain et, bien-sûr, il y en a partout : des diplomates et leur famille, des commerçants et trafiquants, des missionnaires. Il doit évacuer tous les ressortissants en cas de danger immédiat, ce qui implique les évangélisateurs, même s’ils sont assez naïfs et stupides pour « croire » qu’ils ne risquent rien. D’où les errements du commandement, les ordres non exécutés sans aucune suite disciplinaire, l’indulgence coupable de l’officier envers l’équipage en rébellion. Le capitaine croira se racheter en se sacrifiant in fine pour défendre deux imbéciles qui refusaient sa protection, mais il ne fera que s’enfoncer dans une conception absurde de « l’honneur », complètement inefficace. S’exposer en pleine nuit en uniforme blanc n’est en effet pas très militaire ; s’exposer à découvert avec un fusil face aux murs où se dissimulent les tireurs non plus ; abandonner son navire au nom de l’honneur encore moins.





Jake, Frenchy, le capitaine, les marins, désobéissent aux ordres, en égoïstes typiquement yankees qui font passer leur intérêt personnel avant celui du bateau, de la mission, du pays. Aussi leur respect du « drapeau » apparaît-il grotesque. Est-ce une réaction à la guerre du Vietnam qui fait rage en 1966, lors du tournage du film ? Est-ce plutôt par déni de la réalité et la croyance ancrée en leur « mission », sans aucun souci des conséquences ? Trompe est aujourd’hui la caricature de ce comportement tellement yankee. Maily et Frenchy sont morts, le capitaine est tué, le missionnaire est tué (Larry Gates), l’ami milicien des missionnaires est tué avec tout un tas de Chinois, Jake Holman est tué – se demandant ce qu’il est venu foutre dans cette galère : beau bilan de la mission !
Un film très long, avec un début entièrement noir durant plusieurs minutes et un « intermission » (interlude) au milieu – ce qui est assez ridicule en DVD, convenons-en. Heureusement, Steve McQueen est un personnage de héros tranquille, qui suit son chemin sans en dévier dans le marigot des bourrins yankees, des intrigues à la chinoise et de la faiblesse du commandement. Les paysages, tournés à Taïwan (sur la rivière Keelung) et à Hong Kong (alors indépendant), sont de toute beauté, et le grouillement demi-nu de la foule chinoise bien rendu.
DVD La canonnière du Yang-Tsé (The Sand Pebbles), Robert Wise, 1966, avec Richard Attenborough, Richard Crenna, Candice Bergen, Emmanuelle Arsan, Steve McQueen, 20th Century Studios 2002,doublé français, anglais, italien, 2h55, €2,33, Blu-ray 2008, €16,71
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)




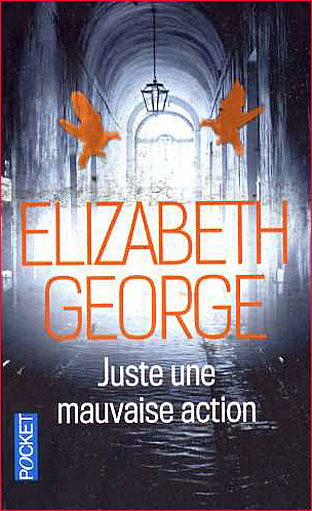

Commentaires récents