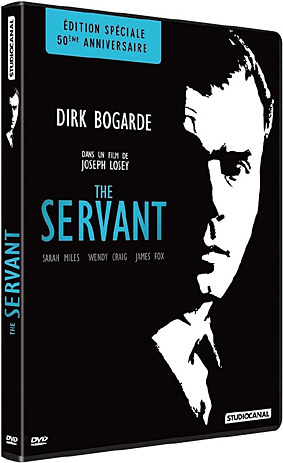
En anglais, le « servant » est un serviteur, mais moins un domestique que quelqu’un qui se met « au service ». Ainsi appelle-t-on les clercs de Dieu ou les fonctionnaires du Civil Service, ainsi conclut-on les lettres guindées par « your obedient servant ». Quand le vocabulaire est celui des Normands, le mot a un sens noble. C’est pourquoi le personnage principal du film, Hugo Barrett (Dirk Bogarde), est plus qu’un boy ou un valet de chambre, mais apparaît plutôt comme un gouvernant (comme on dit gouvernante).


Le beau jeune blond aristocrate anglais jusqu’au bout des ongles Tony (James Fox), est un brin idéaliste et au fond paresseux. Rentré d’Afrique (du sud), il emménage à Londres le temps de proposer ses services d’architecte à un projet mirifique de bâtir des villes dans la jungle en Amérique du sud. Ainsi Brasília est-elle devenue la nouvelle capitale du Brésil, sortie de rien à l’intérieur des terres en 1960. Le projet, comme tant d’autres de Tony, n’aboutira pas. Pas plus que ses fiançailles interminables avec la jeune blonde haute-bourgeoise anglaise jusqu’au bout des ongles Susan (Wendy Craig). Mais le spectateur ne le sait pas encore.
Tony, pour se libérer des contingences matérielles, engage un domestique qui sera aussi cuisinier et gouverneur de sa maison. Hugo Barrett lui convient mieux que les deux autres qu’il a déjà vu (du moins le déclare-t-il – les a-t-il vus ? rien n’est moins sûr). L’homme est organisé, froid, il a servi dans l’aristocratie après avoir fait l’armée. Il surveille les travaux de rénovation, tient le ménage, concocte des plats savoureux. En bref une perle. Si ce n’est qu’il est omniprésent et que Susan, la fiancée, en prend ombrage, un brin jalouse. Elle veut son homme pour elle toute seule et le domestique le couve trop, comme s’il en était le tuteur ou, pire, l’aspirant amant. Il y a de la fascination homosexuelle (thème très anglais) car le brun Hugo admire la classe tout en prenant de l’emprise sur le blond Tony.


Mieux, il fait inviter sa « sœur » Vera (Sarah Miles) pour servir de bonne. Celle-ci est une fille vulgaire et délurée, qui porte les jupes courtes et dévoile sans vergogne ses jambes sexy. Elle réveille Tony qui dort torse nu dans son lit et s’en émeut ouvertement, Tony qui s’en aperçoit remontera son drap sur sa poitrine. Elle finira par le séduire alors que Barrett joue à ne pas être là, et il la baisera sur le fauteuil. Le spectateur ne verra que ses jambes nues qui s’agitent dans les soubresauts de la passion.
Tony est dès lors doublement accroché : par Hugo qui le materne et tient sa maison, par Vera qui l’excite et assouvit ses besoins sexuels. Susan est reléguée, à son grand dam. Le maître devient servant, tandis que le serviteur domine. Les bruns ont soumis les blonds, comme une revanche des esclaves saxons sur les Normands envahisseurs. Il y a de la lutte des races dans cette lutte des classes, mais aussi une lutte des sexes, le mâle dominant prenant l’ascendant pour manipuler tous les autres. L’escalier est le point central de la maison, un ascenseur social en même temps qu’un lieu de passage où tout se joue, la surveillance, la relégation et même le jeu gamin.


Tony est un faible. Né dans la soie, il n’a pas été confronté à la brutalité de l’existence ; il préfère se laisser faire, en oisif content de le rester. A noter que l’assistance de plus en plus grande des machines en nos vies, y compris « l’intelligence » artificielle, nous conduira peut-être, nous aussi, à une sorte de démission à terme. Il est doux de se laisser dominer, en échange de protection et de réconfort. Ainsi agissaient les féodaux, ainsi agissent les dictateurs, même les mafieux comme Poutine. Les Russes n’ont, comme tous les peuples, que les dirigeants qu’ils méritent ; et les Chinois sont fiers de leur réussite économique, en contrepartie de leur soumission intégrale au Parti. C’est ce que l’ami de Montaigne, La Boétie, appelait si justement la servitude volontaire. Au début des années soixante au Royaume-Uni, c’était ainsi que Losey voyait la décadence. Exilé parce que soupçonné de sympathies communistes, il avait lu Marx et Trotski et pensait que « le capitalisme » produirait la corde pour le pendre (comme si un système de production économique était un être vivant !).


Le cinéaste enrichit son huis-clos par les relations du quatuor : la domination de volonté de Barrett sur Tony, la domination sexuelle de Vera sur Tony, avant celle de Barret au final sur Susan, les tentatives de Susan de faire réagir son fiancé, puis sa soumission à sa déchéance dans une scène finale outrée, qui passe mal aujourd’hui tant elle est caricaturale. Le renversement progressif des rôles de chacun est fascinant, on sent la chute vers l’abîme et l’absence d’énergie pour y remédier.


L’amour conventionnel qu’exige la société, représenté par la froide Susan (une vraie tête à claques), dénie toute chaleur humaine à l’union, présentée comme un contrat d’affaires entre gens de la haute. Le seul instant de fièvre, par terre sur le tapis, est volontairement interrompu par Barret qui vient porter un seau à glace pour les cocktails. Tout l’inverse est la spontanéité de Vera, qui affiche ouvertement son désir de sexe et affiche sa grande bouche de déesse 19 et ses jambes érotiques à faire tourner la tête. Tout est ostentatoire dans la façon de filmer, malgré le noir et blanc frigide. Le légendaire flegme britannique est remis à sa place : celle du caractère des individus. Tony n’a pas la vigueur pour faire autrement que de le jouer ; au fond de lui, il reste un enfant qui n’a pas grandi et cède à ses abandons. Barrett le détruira.
DVD The Servant, Joseph Losey, 1963, avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, Wendy Craig, James Fox, Catherine Lacey, StudioCanal 2015 VO sous-titres français, 1h51, €9,49, Blu-ray €14,25
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

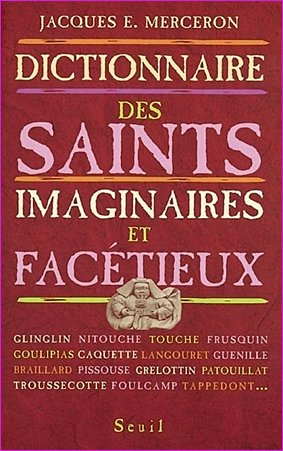












Commentaires récents