Dans la suite de « l’immaculée connaissance » du chapitre précédent de Zarathoustra, Nietzsche poursuit les savants. Il s’attaque aux personnes cette fois, plus qu’au concept de connaissance soi-disant neutre et objective. Il fait des savants des « spectateurs », « assis au frais, à l’ombre fraîche », « ils se gardent bien de s’asseoir où le soleil brûle les marches ». En fait, ils ne s’engagent pas.
La figure de l’intellectuel engagé sera celle des années cinquante et soixante, qui revalorisera Nietzsche et tous les penseurs du soupçon. Dans le XIXe siècle de Nietzsche, les savants et intellectuels restaient en marge. « Pareils à ceux qui stationnent dans la rue et qui, bouche bée, regardent les passants ils attendent et regardent, bouche bée, les pensées imaginées par d’autres. » Ils sont petits, bas et mesquins, ces intellos. « Lorsqu’il se croient sages, je suis horripilé de leurs petites sentences et de leurs vérités : leur sagesse a souvent une odeur de marécage. »

Ils cachent le vide de leur pensée sous des oripeaux chatoyants et l’absence d’idée créatrice sous des sophismes de langage. « Ils sont adroits, leurs doigts sont agiles : que vaut ma simplicité auprès de leur complexité ! Leurs doigts s’entendent à tout ce qui consiste à enfiler, à nouer et à tisser ; ils tricotent les bas de l’esprit ! Ce sont de bons mouvement de pendules : pourvu que l’on ait soin de bien les remonter ! Alors elles indiquent l’heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste tic-tac. Ils travaillent, semblables à des moulins et à des pilons : qu’on leur jette seulement du grain ! – ils s’entendent à moudre le blé et à le transformer en une poussière blanche. » Ce sont des rouages professoraux, pas des chercheurs de vérités. Ils actionnent la logique et la dialectique, et tout ce qui fait tic. Ils emmêlent, comparent et embrouillent, ils sont doués pour ça – ce qui leur évite de créer. Mais du grain ils font de la poussière…
Leur principale mission est de se surveiller les uns et les autres, et de critiquer celui qui sort du lot, jaloux. « Ils savent aussi jouer avec des dés pipés ». Ce pourquoi Nietzsche/Zarathoustra, qui a été un des leurs lorsqu’il enseignait la philologie à l’université de Bâle, leur est devenu étranger. « Leurs vertus me déplaisent encore plus que leur fausseté et leurs dés pipés. »
Le philosophe n’est donc plus « un savant » pour « les brebis », ces êtres qui suivent toujours le troupeau. « Je suis encore un savant pour les enfants et aussi pour les chardons et les pavots rouges. Ils sont innocents, même dans leur méchanceté. Mais je ne suis plus un savant pour les brebis. Tel est mon lot – qu’il soit béni ! » Car ruminer dans le troupeau des savants qui ne savent pas qu’ils ne savent au fond rien, ce n’est ni être savant, ni être chercheur, ni être créateur. Pour ce faire, il faut s’élever au-dessus d’eux tous, ce qu’ils « ne veulent pas entendre », par envie, orgueil et esprit de troupeau. Et les brebis, béent, béates, et bêlent leur assentiment.
Avoir des connaissances étendues, c’est être savant – mais que fait-on de ces connaissances ? Une bonne encyclopédie (aujourd’hui en ligne d’un simple clic) en sait plus que tous les savants du monde. Dès lors, à quoi cela sert-il d’être savant si l’on ne fait rien de la connaissance ?
Arrive alors le second sens du mot savant : celui du chien. Il est dressé pour exécuter certains exercices, le chien savant – mais est-il pour cela savant comme on le dit des savants chez les hommes ? Le savoir-faire et l’habileté qu’évoque Nietzsche ne remplace pas la réflexion et ne fait pas une création.
C’est toute la différence entre la science et le technique. La seconde ne fait qu’appliquer avec savoir-faire et habileté les découvertes de la première – mais elle ne « trouve » rien, elle adapte. L’astuce n’est pas le génie – et trop souvent les « savants » ne sont qu’astucieux, pas créateurs ; ils bidouillent des réponses avec ce qu’ils ont, ils ne posent pas les questions qui importent.
« Le savant n’est pas l’homme qui fournit les vraies réponses ; c’est celui qui pose les vraies questions », dit Claude Lévi-Strauss dans Le Cru et le cuit. Il rejoint directement Nietzsche.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

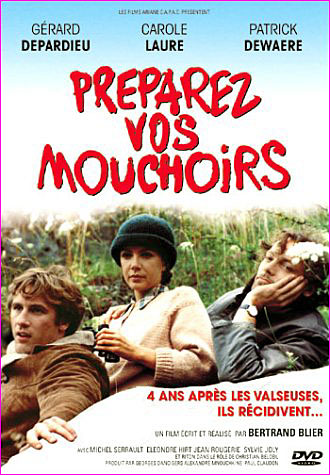















Commentaires récents