Je ne sais quel temps il faisait, ce 29 janvier 1909 quand le philosophe Alain écrivit son Propos, mais il dissertait sur l’ennui. « Quand un homme n’a plus rien à construire ou à détruire, il est très malheureux ». A son époque, ce n’était pas le cas des femmes, toujours occupées à quelque couture, cuisine ou soin aux enfants ; c’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Mais le propos est « vivre avec soi et méditer sur soi, cela ne vaut rien ».
Ceux qui ne font rien pensent, et la pensée diverge aussitôt du présent pour s’orienter sur le futur et sur l’avant. Que vais-je devenir ? Ah, comme c’était mieux « avant » ! Goethe imagine dans Wilhelm Meister, une Société de Renoncement. Ses membres ne doivent jamais penser à l’avenir, ni au passé. « Cette règle, autant qu’on peut la suivre, est très bonne, dit Alain. Mais pour qu’on puisse la suivre, il faut que les mains et les yeux soient occupés. Percevoir et agir, voilà les vraies remèdes. Au contraire, si l’on tourne ses pouces, on tombera bientôt dans la crainte et dans le regret. La pensée est une espèce de jeu qui n’est pas toujours très sain. Communément on tourne sans avancer ». S’occuper empêche de tourner en rond, de se faire des idées, donc de se morfondre ; d’imaginer on ne sait quoi, donc de craindre ou d’espérer sans fondement.

Un métier à faire, c’est très bon, analyse le philosophe. Rester oisif, ou chômeur, n’est pas bon pour le moral car cela fait ruminer, devenir hypocondriaque, se « croire » ceci ou cela, atteint d’on ne sait quel défaut ou maladie. « Ce qui nous manque, ce sont de petits métiers qui nous reposent de l’autre. » Les femmes font du tricot à son époque, mais les hommes ? Ils ne font rien ; à l’époque, ils ne bricolent même pas car le bricolage est leur métier courant dans les campagnes où il y a toujours quelque chose à réparer ; ils boivent au café et discutent, s’engueulent et se battent. Ils « bourdonnent comme des mouches dans une bouteille », dit Alain. Il leur faudrait une bonne guerre ! éructaient les vieux de 14-18 lorsque j’étais enfant et qu’ils récriminaient contre la jeunesse. Je trouvais cette remarque indécente, mais elle avait un fond de vérité qu’Alain met en lumière : rester à ne rien faire au lieu d’agir, c’est mauvais pour tout le monde.
L’être humain est conditionné par ses millions d’années d’évolution à être nomade, curieux, sans cesse à l’affût de la nouveauté. « Il leur faut des actions nouvelles et des perceptions nouvelles. Ils veulent vivre dans le monde, et non en eux mêmes. Comme les grands mastodontes broutaient des forêts, ils broutent le monde par les yeux. » Lorsque la société n’offre pas ces dérivatifs, la guerre en est un. « La crainte de mourir est une pensée d’oisif, aussitôt effacée par une action pressante, si dangereuse qu’elle soit. Une bataille est sans doute une des circonstances où l’on pense le moins à la mort. D’où ce paradoxe : mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. »
Il existe quand même d’autres façons de s’occuper le corps, le cœur et l’esprit que la guerre. Lire un livre, voyager, s’occuper des autres, des enfants, créer une entreprise, inventer, écrire ou peindre, agir dans une association, organiser une fête… Rester en soi, ou entre soi, ferme l’esprit et le cœur, débilite le corps. Agir, fait mieux penser, mieux aimer, mieux être. Nous sommes fait pour cela.
Alain, Propos tome 1, Gallimard Pléiade 1956, 1370 pages, €70,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Alain le philosophe, déjà chroniqué sur ce blog

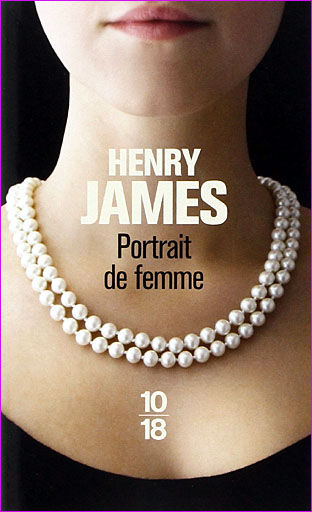

Commentaires récents