Zarathoustra voit se lever la lune et se dit qu’elle se prend pour le soleil. Mais elle est trop pâle et timide : elle ment avec sa pseudo-grossesse. Elle se contente d’effleurer la terre plutôt que de l’engrosser comme le soleil le fait. Par cette parabole, Nietzsche se moque des la religiosité de ceux qui croient à « l’immaculée connaissance », en référence à l’immaculée conception de la Vierge Marie. Comment peut-on engendrer la chair à partir de rien ? Seuls les gogos se soumettent à cette fausse vérité qui est – chez les chrétiens – le signe même de la foi. Il s’agit d’abolir sa raison et sa volonté pour adhérer de tout son cœur, d’obéir au Père sans discuter, ni réfléchir, ni vouloir.

Mais l’être humain n’est pas que de foi ni de raison : il est en trois étages intimement mêlés, comme Nietzsche n’a cessé de le répéter depuis toujours, dans la lignée des Antiques : les instincts qui induisent les passions qui meuvent l’esprit. La « volonté vers la puissance » est ce mouvement même du bas vers le haut et qui revient du haut en bas pour faire agir. L’esprit neutre, objectif, la « connaissance immaculée », ne sont que de vastes blagues, des infox d’intellos qui se prennent pour des clercs de religion.
« Vous aussi aimez la terre et tout ce qui est terrestre : je vous ai bien devinés ! – mais il y a dans votre amour de la honte et de la mauvaise conscience – vous ressemblez à la lune. On a persuadé à votre esprit de mépriser tout ce qui est terrestre, mais on n’a pas persuadé vos entrailles : or ne sont elles pas ce qu’il y a de plus fort en vous ? » L’esprit a honte de dépendre des entrailles qui lui paraissent vulgaires, trop charnelles, matérielles, lui qui se voudrait éthéré et proche de « Dieu ». Mais l’être humain est fait de chair, et donc à trois étages, pas à un seul. C’est un fait : il a été créé ainsi. Avoir « honte » de cela est une ineptie, cela devrait l’être même aux croyants.
Car la morale d’église trompe et égare en corrompant la foi pour une question de pouvoir sur les âmes, donc sur les corps. « Ce serait pour moi la chose la plus haute – ainsi se parle à lui même votre esprit mensonger – de regarder la vie sans convoitise et non pas comme un chien, la langue pendante. Être heureux dans la contemplation, avec la volonté morte, sans rapacité et sans désir égoïste – froid et couleur de cendres sur tout le corps, mais les yeux enivrés de lune. (…) Ainsi s’égare celui qui a été égaré. (…) Et voici ce que j’appelle l’immaculée connaissance de toutes choses : ne rien demander aux choses que de pouvoir s’étendre devant elles, comme un miroir aux yeux innombrables. » L’université laïque réagit comme une église lorsqu’elle prône la connaissance « pure », détachée de tout, neutre en méthode. Tout est préjugé, chacun parle depuis quelque part, avec une langue particulière, selon un point de vue. C’est l’objet de la méthode scientifique que de chercher à minimiser ces préjugés et déterminants du chercheur, ce pourquoi la connaissance avance avec essais et erreurs, comparaisons et validations croisées, « falsification » dit Karl Popper. « Ne rien demander aux choses », ce n’est pas faire de la recherche mais rester coi, béat devant la Création, sans volonté ni désirs. Une larve prête à obéir à tout et à passer sa vie inutile à ne rien faire.
Au contraire, le désir est innocent. Il vient des entrailles et entraîne la volonté – et cela est bénéfique aux vivants : c’est ainsi qu’ils survivent et étendent leur pouvoir sur les choses pour durer. Les immaculés connaissant ne connaissent rien de ce qui est vivant, de ce qui fait la vie même. Ils n’aiment « pas la terre comme des créateurs, comme des générateurs, joyeux de créer ! » Ils préfèrent les objets – chosifiés, indifférents – aux êtres vivants et qui passionnent. D’où les dérives scientistes du calcul qui négligent l’humain et le méprisent, des délires de la finance spéculative aux drones à intelligence artificielle qui cherchent à tuer leurs opérateurs parce qu’il mettent des bâtons dans les roues de la mission définie.
« Où y a-t il de l’innocence ? Là où il y a la volonté d’engendrer. Et celui qui veut créer ce qui le dépasse, celui là possède à mes yeux la volonté la plus pure. Où y a-t-il de la beauté ? Là où il faut que je veuille de toute ma volonté : où je veux aimer et disparaître, pour qu’une image ne reste pas qu’une simple image. Aimer et disparaître : ceci s’accorde depuis des éternités. Vouloir aimer, c’est aussi être prêt à la mort. » Il faut oser croire en soi-même pour créer, que ce soit un enfant, un objet ou une œuvre d’art. Croire en soi n’est pas croire en un « dieu » qui meut, mais en les trois étages qui composent l’humain, chair, cœur et cerveau, tous unis par la volonté d’agir, de faire pour vivre.
« Vous avez mis devant vous le masque d’un dieu, vous, les purs : votre affreux ver rampant s’est caché sous le masque d’un dieu. » Vous prétendez, vous faites croire, vous façonnez une image de vous-mêmes – ô hypocrites ! Vous n’existez pas, vous n’êtes que fumée, illusion, esbroufe. Il en est tant et tant de ces « auteurs », « chercheurs », « philosophes » et missionnaires de toutes causes qui ne sont rien que le masque qu’ils se sont créés pour se faire regarder en miroir – pas pour engendrer des choses nouvelles.
Là, Zarathoustra/Nietzsche se fait sensuel, car la connaissance est désir, pas seul esprit froid :
« Car déjà l’aurore monte, ardente – son amour pour la terre approche ! Tout amour de soleil est innocence et désir de créateur.
Regardez donc comme l’aurore passe, impatiente, sur la mer ! Ne sentez-vous pas la soif et la chaude haleine de son amour ?
Elle veut aspirer la mer et boire ses profondeurs : et le désir de la mer s’élève avec ses mille mamelles.
Car la mer veut être baisée et aspirée par le soleil altéré ; elle veut devenir air et hauteur et sentier de lumière, et lumière elle même !
En vérité, pareil au soleil, j’aime la vie et toutes les mers profondes.
Et ceci est pour moi la connaissance : tout ce qui est profond doit monter à ma hauteur.
Ainsi parlait Zarathoustra. »
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog

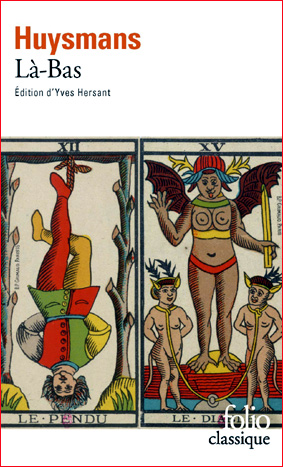



Commentaires récents