Toute foi confrontée au réel se rationalise. Confrontée aux oppositions elle se justifie et se fige. Dès 1981, et sur les promesses illusoires de la gauche marxiste au pouvoir, la presse française constate la faillite de l’application de l’idéologie soviétique. Les Français, toujours en retard d’une guerre, y croient encore…
La foi, qui est élan, ne laisse pas place au doute mais cette absence résulte du mouvement de l’esprit, non de la contrainte. Lorsque l’enthousiasme diminue, le groupe militant élève des barrières contre les interrogations. Alors survient le règne du dogme et l’inquisition. Des procès de Moscou à la Hongrie, à la Tchécoslovaquie, aux purges du PCF, la certitude communiste ne survit que d’interdire droit de cité à la plus infime interrogation, elle n’existe que de traquer partout la question, de la tuer dans l’œuf. Le Monde du 24 décembre 1981 décrit « les bases théoriques et structurelles des pays communistes : le dogmatisme de l’idéologie et le monolithisme du parti, trouvent l’un et l’autre leur source dans le léninisme. » Lénine était encore à l’âge de la foi, même si son pragmatisme foncier lui a fait prendre les tournants nécessaires à la réalisation du But qu’il avait en l’esprit. Il laissait sa place au doute – non sur la Fin dernière – mais sur les voies et moyens pour y parvenir. Il reconnaissait parfois se tromper. Sous la gauche, le parti ne se trompe plus. Et l’on invoque Lénine comme une Sainte Ecriture.
Le socialisme reste-t-il réponse à une réalité mouvante, comme l’affirme Georges Marchais au XXIVe Congrès du PCF ? La presse 1981-82 constate la fin d’une génération qui s’accroche au pouvoir, sans qu’aucun mécanisme ne vienne rationaliser le clientélisme, l’Afghanistan « sauvé » de ces féodaux qui refuse de se plier volontairement aux avancées de l’Armée soviétique, les récoltes de céréales comme toujours catastrophiques. Pour le Quotidien de Paris du 6 février 1982, « traduit en terme politique [le marxisme est aussi] un cadre d’organisation des sociétés dans lequel la fin – inévitable parce qu’inscrite dans l’histoire – justifie des moyens. » Ce qui faisait le génie de Lénine était de ne pas prendre Marx à la lettre, mais seulement comme référence et étendard. Staline vint, matois, terre à terre, dogmatique, il accentua les exagérations fanatiques de Lénine. Pouvait-il en être autrement ? Staline fut non seulement un fils légitime de Lénine ; il fut aussi son fils unique.
Santiago Carrillo, secrétaire général du Parti Communiste espagnol, note en 1982 que « L’URSS est un pays qui a dépassé le capitalisme et qui a supprimé la propriété privée des grands moyens de production. Cela ne veut pas dire qu’il existe en Union soviétique une société socialiste développée, comme ils disent là-bas. » Dans la vision qu’avait Karl Marx de l’Histoire, où la société se développe suivant un schéma social faisant se succéder les régimes en fonction de la propriété des moyens de production, on peut dire que la collectivisation est une « étape supérieure » au capitalisme, dans le sens où elle viendrait « après ». Mais dans l’histoire réalisée, le capitalisme apparaît plus efficace et plus souple pour répondre aux besoins de la société.
Alors que, dans les pays en voie de développement, le marxisme permet d’y espérer le changement sans que l’on ait à se changer soi-même. Il suffit de supprimer les causes extérieures des problèmes que l’on doit affronter. Alibi pour les dirigeants en place, souvent plus préoccupés de leurs intérêts personnels que des peuples dont ils se disent en charge, le marxisme fournit le bouc émissaire idéal : cet Occident « blanc, chrétien et capitaliste ». Quel est le pays sous-développé ayant choisi le marxisme qui ait réussi ? La Chine n’a pu émerger qu’en revenant sur le dogmatisme de Mao, en ouvrant une zone franche et en permettant aux entreprises étrangères de s’implanter. « Un peu de capitalisme ne peut pas faire de mal à la Chine », dit-on là-bas. Et le succès est venu…
Le socialisme reste un espoir, que Georges Marchais exprime au XXIVe Congrès du PCF : « c’est à la fois une socialisation des grands moyens de production et d’échange, un pouvoir représentatif du peuple travailleur au sein duquel la classe ouvrière exerce un rôle politique dirigeant, la satisfaction progressive des moyens matériels et culturels sans cesse croissants de tous les membres de la société, un effort fondamental pour modifier les rapports sociaux. » Mélenchon reprend presque mot pour mot aujourd’hui ce mantra communiste. La réalité est moins rose et Marchais l’avoue : « dans l’histoire, nous le savons bien, aucune transformation sociale n’a été facile, aucune n’a échappé aux revers et aux contradictions (…). C’est précisément pourquoi il n’y a pas, il ne peut pas y avoir, scientifiquement parlant, de « modèle » passe-partout, prêt-à-porter de socialisme. Le socialisme n’est pas un objet d’importation, car il ne peut résulter que du mouvement réel de la société, du mûrissement des contradictions au sein de celle-ci. »
Des décennies de socialisme « en expérience » dans plusieurs pays du monde ne sont pas faits pour encourager. Le Monde du 24 décembre 1981 écrit que le marxisme est « une idéologie qui sert de base au système coupable des pires atrocités, y compris le génocide, commises au cours de ce siècle, en Europe. » Et Le Matin du 29 décembre 1981 : « l’expansionnisme soviétique s’avance en effet masqué derrière l’idée généreuse du socialisme (…) Que l’idée du socialisme s’évanouisse, et l’empire apparaîtra pour ce qu’il est en réalité, c’est-à-dire comme une force, une force nue, une force brute. » Souslov était passé maître en l’art de trouver les justifications idéologiques à tous les mauvais coups perpétrés par l’URSS.
Annie Kriegel, dans le Figaro du 16 décembre 1981 : « le parti socialiste et le parti communiste français (…) (sont concernés) tout particulièrement parce qu’ils sont comptables, chacun à leur manière, de la faillite historique de l’utopie socialiste ». Libération va plus loin le même jour et parle de « la faillite interne totale du communisme, la mort de l’idéologie communiste, le fait que ces partis communistes sont des cadavres vivants qui ne remuent que faiblement. »
La presse se fait l’écho des dissonances enregistrées parmi les communistes eux-mêmes. A Madrid, Santiago Carillo, secrétaire général du PC espagnol, a affirmé que l’instauration d’un gouvernement militaire en Pologne est « en contradiction avec les bases du socialisme, du marxisme et du léninisme ». C’est un régime militaire « antipopulaire, autoritaire, et donc antisocialiste » qui a ainsi été instauré. Et Libération cite les Brigades Rouges, dans un document de décembre 1981, pour qui « le soi-disant camp socialiste » n’est socialiste « qu’en paroles » et le mode de production en URSS est « depuis des années le capitalisme d’Etat ». Alexandre Zinoviev confirme dans Libération du 27 janvier 1982 que « l’idéologie soviétique est devenue un mécanisme formel gigantesque. Ce mécanisme fonctionne assez bien. Pour les changements on a besoin d’époques entières. » Le révélateur est venu de Pologne. Le coup de force a étalé au grand jour la réalité de l’ordre rouge. Elle se résume en quatre points : une puissance militaire formidable au service d’une idéologie périmée, une machine à écraser la liberté, un système incapable de faire vivre dans des conditions décentes les peuples qu’il domine, un instrument dont la finalité cynique est de broyer l’homme. La faillite atteint même les journalistes communistes, puisque Guy Barbier écrit dans Le Monde du 29 décembre 1981 sur « cette paradoxale conception de la lutte des classes qui aboutit à approuver l’écrasement militaire de ce qui est indiscutablement toute une classe ouvrière, ou au moins à s’y résigner au nom des intérêts supérieurs du « socialisme ». »
Si Marx formule des hypothèses scientifiques sur fond de philosophie, le « marxisme » comme système est moins vivant. Quant au léninisme, il se veut une science appliquée. Staline a fait de Lénine « l’homme devenu mausolée » et de sa pensée un bunker théorique dans lequel on peut se retrancher à tout moment. En témoigne ce monument de Leningrad (redevenue Saint-Pétersbourg) ou Lénine, debout devant la gare de Finlande, harangue la foule debout sur la tourelle d’un blindé coulée dans les douilles de bronze des obus de la guerre.
Hélène Carrère d’Encausse note « l’extrémisme de la pensée politique russe » qui « est une constante qui se perpétue des populistes aux bolcheviks » (Lénine, la révolution et le pouvoir, 1979). L’explication tient en ce que « l’illégalité, le débat en milieu clos ont coupé les idées du réel, et les intellectuels discutant dans un cadre abstrait ont été conduits à poser les problèmes en termes extrêmes (…) Coupée du monde extérieur, sans prise sur lui, l’intelligentsia se défend en affirmant son originalité, en considérant qu’elle seule détient la vérité. » Coupée du monde et vivant dans le ciel des idées… Notre intelligentsia socialiste, et notamment Badiou qui inspire tant d’extrêmes-idéalistes, est bien de ce moule-là.
Lénine, mis en minorité, nie la signification du vote et sort de l’Iskra peu après le Congrès de Bruxelles. Puisque les Bolcheviks y sont minoritaires, le journal ne représente plus la majorité « réelle » et Lénine transporte le centre du parti hors de l’Iskra (Mélenchon fait de même en se plaçant hors du parti Socialiste). Il fera de même lors de la prise du pouvoir en dissolvant l’Assemblée constituante. Mélenchon, élu député, refuse la cravate, le drapeau européen, la légitimité de l’Assemblée même : pour lui, « le peuple » est le groupe que lui décide être « le peuple », et pas un autre, notamment les prolétaires qui votent Front national ou Macron. En 1917, Lénine espère le miracle de la Révolution mondiale dans trois semaines ou trois mois. Staline attend des miracles de la collectivisation des terres et de l’industrialisation forcée. Pour Khrouchtchev, le miracle doit venir de l’exploitation des terres vierges. Brejnev croit aux miracles engendrés « scientifiquement » par l’introduction de la chimie dans l’agriculture. Mélenchon attend un miracle du citoyen en armes constamment mobilisé et donnant de la voix. Mais les prophéties ne se réalisant pas, il faut sauver du doute la doctrine et le système. Le responsable, c’est l’ennemi, qu’il faut détruire.
La coercition commence avec Lénine, qui a écrit de sa main l’essentiel des articles du premier Code pénal soviétique. Staline n’a rien amélioré : « Sincère et convaincu, mais fanatique et borné » selon Boris Souvarine en 1937, Staline est un pur produit du léninisme. Les gloses pour partager les responsabilités et chercher à quel moment le socialisme a « dérapé », n’ont pas de sens : la foi est totalitaire parce que les affidés sont certains d’avoir raison ; le parti n’a pu survivre que parce qu’il s’est montré impitoyable aux errements et aux compromis ; l’idéologie n’a pu s’adapter que parce que le marxisme est aussi une théorie de l’action et pour l’action. Pour Gorbatchev, on a oublié en URSS le « facteur humain ».
L’idéologie est un sentiment d’appartenance à « une cohorte cooptée de privilégiés à haut risque », selon l’expression d’Annie Kriegel. A l’origine, les révolutionnaires étaient poussés par la foi, puis obligés par les circonstances à ne pas se déjuger. La révolution une fois consolidée, l’enthousiasme n’était plus adapté, on préférait les conformistes aux activistes. Une société assurée de durer a le temps devant elle. Pourquoi brusquer les choses ? Georges Lavau dans la revue Pouvoirs n°21 de 1982 dénombre cinq « lois d’utilisation » de l’idéologie par les Etats communistes : source de croyance, instrument d’analyse du réel, justification, ressource de pouvoir contre les USA (le socialisme champion du tiers-monde), ciment du système communiste mondial. Tout pouvoir a besoin de légitimité, et la légitimité a besoin d’utopie. On ne peut gouverner sans faire rêver.
Dans cette critique de la « rationalisation », on perçoit ce regret « de gauche » que l’utopie ne soit pas mieux servie. On charge Staline pour conserver une image pure des origines de la Révolution et de la pensée de Lénine. Les ressources de la dialectique remplacent l’élan. L’évolution historique étant un processus qui avance en surmontant les contradictions, il est toujours aisé de faire du moment présent un moment charnière d' »intensification » des contradictions, qui oblige à une vigilance accrue. A droite, on croit qu’il est plus difficile de se défendre contre l’idéologie soviétique, parce qu’il faut la discuter pas à pas, alors qu’une foi se rejette d’un bloc. D’où les tentatives de ramener le socialisme soviétique à l’ideal-type d’une foi qui se serait dévoyée.
Retourner à 1981, la gauche au pouvoir et l’URSS encore toute-puissante, permet de comprendre les ressorts de l’illusion et du mensonge. Ils sont à l’œuvre aujourd’hui, sur les mêmes bases.


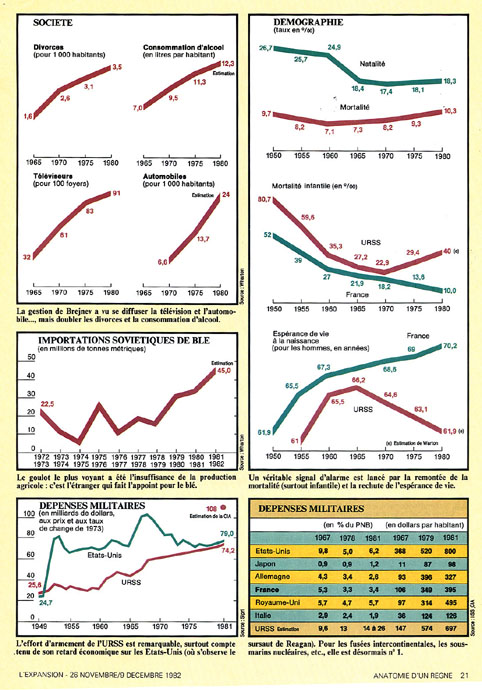



Commentaires récents