L’homme sans qualités existe, l’auteur l’a rencontré. Il nous décrit son insignifiance, son existence sans aspérités. Il pourrait s’appeler Lambda car on ne lui connait pas de nom. Sauf que son faciès le fait surnommer « Bougnoul », même si la page 86 nous laisse penser que « sa lignée était d’ici depuis toujours, mais qu’importait, son allure physique était trompeuse. Il demeurait le Bougnoul du voisin et ne contestait pas ce rôle ».
Monsieur le « Bougnoul », tenancier d’une petite boutique d’épicerie-bazar de quartier ouverte de 6 à 23h, est un beau jour arrêté par la police, gyrophares scintillant et sirènes à plein tube. Il ne sait pas pourquoi, mais la police le sait, inversant la charge de la preuve. Il a été « dénoncé », par qui ? pour quoi ? il ne sait pas, mais se retrouve en prison.
Où il mène une vie simple et tranquille, anonyme. Au point qu’un jour il va regarder dans la camionnette de la buanderie… qui démarre. Et le voilà libre. Pour quoi faire ? retrouver qui ? il ne sait pas mais découvre une cabane au fond des bois où il passerait bien le reste de ses jours. Repéré, pisté, il est repris et se retrouve en prison sans plus savoir pourquoi.
Il s’adapte, postule pour tenir la bibliothèque où les détenus ne vont que pour avoir conversation, pas pour lire. Lui-même ne lit pas, faisant le minimum. Il se fait oublier après avoir briqué l’endroit, en détenu modèle. Au point qu’une visite d’une commission d’intellos le fait s’évader en les suivant simplement : personne ne l’a jamais remarqué.
Mais cette fois il va toquer à la porte d’une ancienne voisine infirmière, aux deux petits enfants, qui vit seule et lui a jeté un regard intéressé. Il fait la cuisine, le ménage, aide aux devoirs les enfants. Il se fait oublier. Il est un anonyme dans une case, il remplit un rôle convenu, sans histoire.
Jusqu’à ce que l’usure détériore ses relations avec sa compagne. Il est trop lisse, comme un robot pensant. Il profite d’une soirée de carnaval pour quitter l’appartement et se retrouver dans la rue, masqué comme les autres – sans visage. Il suit les sans-abris et réussit à manger sans papiers. Nul ne fait attention…
Ce pourquoi il terminera sous un réverbère, après un casse foireux d’un compagnon de la dèche. Les flics venus emmener l’illettré qui ne savait pas qu’il existait un signal d’alarme ne s’intéresse pas à celui qui fait le guet sans intention, sous le réverbère.
D’un style qui rappelle Le Clézio des années soixante, ce roman de l’anonymat régénère l’absurde du Système. Chacun est réduit au numéro d’identité, à une fonction, à un rôle. Nul être ne peut plus exister par lui-même. « Il était là depuis si longtemps qu’il avait fini par ressembler aux autres habitants des lieux », dit la première phrase. Tout le roman en est le développement.
L’auteur est romancier, poète, essayiste, homme de théâtre, photographe, écrivain pour la jeunesse – après avoir été ouvrier d’imprimerie, bibliothécaire, libraire, éditeur. Il est du peuple, élevé à La Courneuve et ayant publié l’Histoire de la littérature libertaire en France et le Dictionnaire des auteurs prolétariens. Il a l’analyse au scalpel et le regard pessimiste des gens du nord, ayant écrit aussi le Dictionnaire du roman policier nordique et Les Vikings contre Hitler. Il touche à tout, par petites touches. Il dit vrai, sans insister. Cette légèreté même fait le poids de ce conte.
Thierry Maricourt, L’homme sous le réverbère, 2016, éditions Les soleils bleus, 130 pages, €14.00
Attachée de presse Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 balustradecommunication@yahoo.com

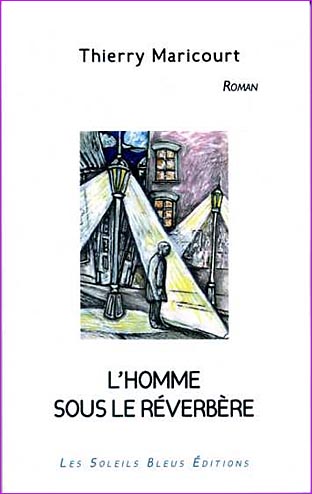










Commentaires récents