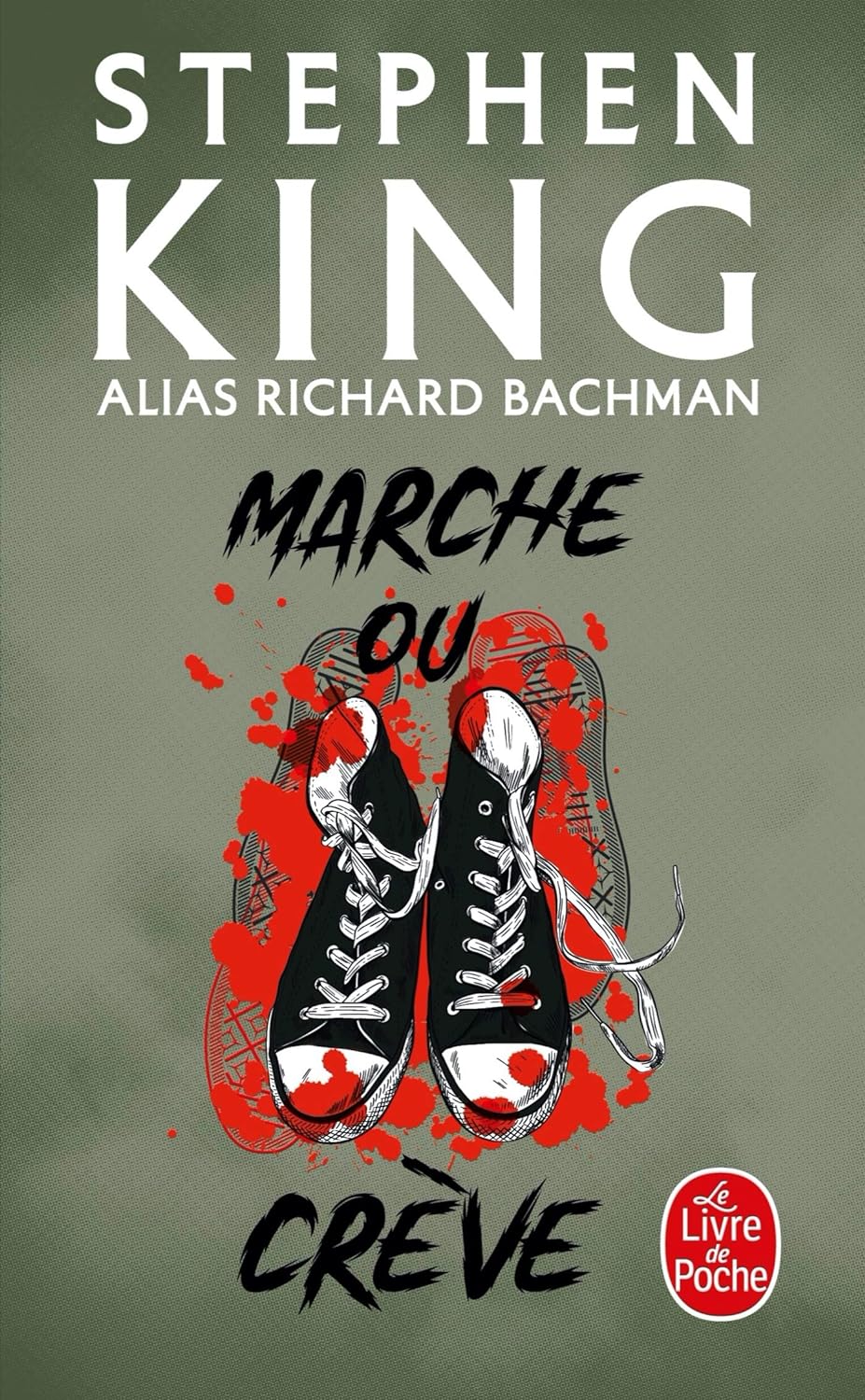
Cent garçons concurrents entre 12 et 18 ans au départ, une longue marche, un seul à l’arrivée – pour les autres une balle dans la tête. Nous ne sommes pas dans le roman policier ni vraiment dans la « science » fiction, mais plutôt dans la sociologie fiction : celle d’une société américaine qui pousse jusqu’au bout son tropisme à la compétition. Chacun est Pionnier, libertarien à mort, jusqu’à vouloir gagner aux dépends des autres. Même si l’auteur situe l’histoire dans un univers parallèle où par exemple un soldat « a pris d’assaut une base nucléaire allemande » – qui ne saurait avoir existé en 1979.
Ray Garraty a 16 ans et a décidé de participer à la Longue marche annuelle du 1er mai. Pourquoi ? C’est assez mystérieux, il ne le sait pas vraiment lui-même, et la Marche révélera peut-être un désir inconscient de mort. « C’était un grand garçon bien charpenté », le champion du Maine encore au lycée. Les adolescents sont tirés au sort et doivent postuler, sachant qu’il ont une chance sur cent d’en sortir vivants… Tout le sel du roman est dans cette contradiction qui fascine et répugne à la fois, le modèle de la société totalitaire à l’américaine que les émissions de télé-réalité à la Boccolini (Le maillon faible) vont populariser en France dans les années 2000 avec comme slogan : « vous êtes viré ! ». Les garçons candidats sont soumis à des épreuves physiques et mentales par le Commandant, « un sociopathe entretenu par la société », avant de se voir attribuer un numéro, et ont jusqu’à une certaine date pour, s’ils sont choisis, renoncer.
Mais comment renoncer ? Tout est mis en œuvre pour que la pression sociale les force à aller jusqu’au bout. C’est moins le Prix au vainqueur, la toute-puissance offerte par la société américaine devenue totalitaire, que l’orgueil mâle ; les mamans en larmes n’y peuvent rien. Celle de Percy, un peu moins de 14 ans, en deviendra hystérique mais le gamin sera « ticketé » (tué après trois avertissements). Ils sont adolescents, donc épris d’absolu, en quête d’identité, avides de se prouver qu’ils sont des hommes. Le Commandant, qui dirige la Marche, est pour eux un modèle. Avec ses lunettes miroir, il n’est rien, il ne fait que renvoyer leur image à ceux qui le regardent. Ils se voient sous son uniforme, avec sa prestance et ses galons. Il est le Pouvoir, ils veulent devenir comme lui.
Quelques trois cents cinquante pages, quatre jours et quatre nuits, cinq cents kilomètres plus tard, le numéro 47 Ray Garraty reste le seul. Non sans douleur, mais la souffrance est formatrice (masochisme très chrétien) ; non sans avoir perdu tous les amis qu’il s’est fait durant ces longues heures passée à mettre un pied devant l’autre à au moins 6,5 km/h (contrôlé au radar par les soldats armés qui les suivent), soumis aux avertissements dès qu’il ralentit plus de 30 secondes (par exemple pour chier) ou sort de la route (lorsqu’il dort debout) – le troisième avertissement étant le dernier avant la balle fatale : il n’y a pas de quatrième avertissement. Mais tout avertissement est effacé au bout d’une heure de bonne tenue. Il faut donc flirter avec la mort pour tenir malgré ampoules, crampes, diarrhée, insolation, pneumonie, chute, perte de connaissance, panique… Le claquement des fusils qui éliminent un à un ceux qui flanchent rythme les heures.
Le pire ? C’est la Foule. Compacte, vociférante, hystérique, malsaine. La foule acclame les marcheurs mais adore voir tuer un faible, sa cervelle éclatée sur la route, son jeune corps ensanglanté, ses vêtements déchirés. La foule est inhumaine, cruelle, elle est la Société dans son égoïsme passionné – l’essence des États-Unis pionniers et libertariens. A l’inverse, les concurrents deviennent pour certains des amis, des êtres que l’effort en commun vers le même but rapprochent. McVries est le plus proche de Ray, ils se sauvent mutuellement de l’élimination. Il est même sensuellement attiré par lui car les garçons s’observent entre eux, se mesurent, leur désir est mimétique comme dirait René Girard. La sexualité, en cette fin des années soixante-dix, s’est libérée des conventions et préjugés, elle se fait naïve, directe. Scramm, l’un des concurrents, 15 ans, est marié et sa femme attend un petit – il mourra, victime de pneumonie et « tué » d’une balle après sa mort. Ray a une petite amie, Jan, qui ne voulait pas qu’il fasse la Marche et a même proposé de coucher tout de suite avec lui s’il renonçait. Mais ce serait renoncer à sa virilité sociale, et Ray n’a pas voulu. Il reste puceau, comme McVries, qui ne le désire qu’en paroles.
La sexualité est le désir de vie, la négation du désir de mort qui a saisi les adolescents au moment de leur inscription. C’est probablement ainsi qu’il faut comprendre la dernière scène où Garraty se retrouve seul avec un concurrent, Stebbins, jusqu’ici marcheur automatique car fils naturel du Commandant, mais qui s’est épuisé. « Stebbins se retourna et le regarda avec des yeux immenses, noyés, qui ne virent d’bord rien. Mais au bout d’un moment il le reconnut et tendit la main pour ouvrir, puis arracher la chemise de Garraty. La foule protesta à grands cris mais seul Garatty était assez près pour voir l’horreur dans les yeux de Stebbins, l’horreur, les ténèbres ; et seul Garatty savait que le geste de Stebbins était un dernier appel au secours. » Désir sexuel de voir sa poitrine nue, désir de vie. Stebbins tombe, il meurt. Garraty a gagné mais il délire, il croit être encore en lice avec une ombre, il poursuit…
Un grand premier roman écrit en 1966 d’un auteur de 19 ans qui allait s’imposer comme un grand de l’anticipation dystopique. Refusé une première fois, le roman est publié en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman.
Stephen King (Richard Bachman), Marche ou crève (The Long Walk), 1979, Livre de poche 2004, 384 pages, €8,90, e-book Kindle €7,49 (mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Stephen King déjà chroniqué sur ce blog

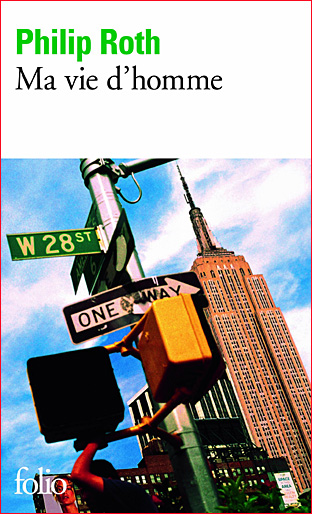

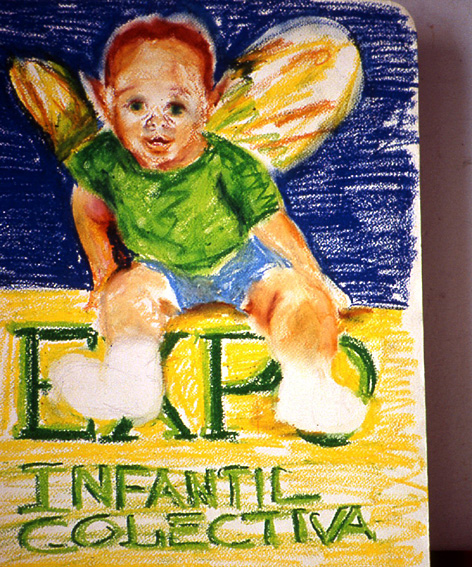


Commentaires récents