Le gallois auteur de thrillers Ken Follett se lance dans une vaste fresque historique sur « Le siècle » (le XXe) et il est passionnant. Evidemment, il faut aimer les pavés (celui-ci fait plus de mille pages) et l’entrecroisement à la manière des suspenses cinéma de plusieurs personnages avec chacun leur histoire… qui finissent par converger dans les hasards de l’Histoire. Car le siècle est saisi en 1911 par l’entrée d’un adolescent de 13 ans, Billy, à la mine au pays de Galles, comme son père et son grand-père, et se termine en 1924 par l’entrée au Parlement de Westminster d’Ethel, sœur aînée de Billy.
C’est dire si le siècle a bouleversé les statuts et les idées ! La guerre de 14-18 a été la plus grosse connerie des élites établies, déstabilisées par la boucherie due à leur incompétence, à la technique qui broie les hommes et à l’égalité hommes-femmes, ouvriers et aristos, forcée par l’ampleur des événements. Plus jamais rien ne sera comme avant. L’aristocratie russe archaïque derrière le tsar mou a été exilée ou fusillée, l’empire austro-hongrois éclaté, la caste militaire pleine de morgue derrière le kaiser a été balayée par la social-démocratie et les prémisses du populisme nazi, les lords anglais très conservateurs ont été obligés de composer avec leurs mineurs appelés au front et leurs servantes appelées en usine ou en politique, le parti travailliste a balayé libéraux et conservateurs tandis que le pouvoir de la Chambre des lords a été rogné. Même les bourgeois affairistes des Etats-Unis ne sortent pas indemnes d’une guerre qu’ils n’ont pas voulue mais dont ils ont bien profité : le moralisme, contrecoup de la boucherie, instaure la Prohibition.
Le lecteur peut suivre au pays de Galles (région d’origine de l’auteur) la famille ouvrière Williams, Dai le père syndicaliste et prédicateur, Billy son fils qui descend à la mine à 13 ans et s’engage à l’armée à 17 ans, Ethel sa fille féministe et futée, femme de chambre chez le comte qui l’engrosse, salariée du syndicat à Londres puis élue députée après-guerre. Le comte Fitzherbert est bel homme, riche héritier et très conservateur ; il a épousé Bea, une princesse russe qui vit difficilement l’exil et qui va perdre avec son frère Andreï resté en Russie le domaine familial partagé par les bolcheviks. Elle finira par donner deux héritiers au comte qui se désespérait, lui qui multipliait les bâtards un peu partout dont Lloyd, le fils d’Ethel. Maud est la sœur du comte, dépendante de la fortune de son frère mais féministe et progressiste ; elle a créé un dispensaire pour mères seules à Londres et milite pour le droit de vote des femmes. Elle tombe amoureuse de Walter Von Ulrich, jeune diplomate allemand et l’épouse en secret à la veille de la guerre ; ils seront séparés quatre ans, Walter blessé, mais se retrouveront et feront deux garçons dans un Berlin soumis aux restrictions. Le cousin autrichien de Walter, Robert, est homosexuel et dissimule ses penchants avant-guerre jusqu’à ce que la défaite lui permette de s’afficher au grand jour dans le Berlin des années 1920. Gus Dewar est Américain conseiller du président Wilson, idéaliste féru des 14 points et de la création d’une Société des Nations – que le sénat américain refusera par isolationnisme, ne voulant se lier par aucun traité tout comme aujourd’hui. En Russie Grigori Peshkov, ouvrier à Petrograd, a vu tuer sa mère sous ses yeux en 1905 et a dû élever seul son petit frère Lev, devenu séducteur et voyou. Il désire émigrer en Amérique, terre promise de liberté et d’opulence loin de la violence et de l’archaïsme du régime tsariste mais c’est son frère, recherché par la police du tsar pour avoir tué un homme, qui va profiter du voyage et faire sa fortune en Amérique tandis que Grigori fait la révolution et devient commissaire politique proche de Lénine.
Tous ces personnages sont fictifs ; ils se croisent et se mêlent, tissant une trame plausible avec l’histoire véritable. L’auteur répond dans une postface aux critiques rapides de ceux qui ne l’ont pas lu jusqu’au bout : tous les personnages réels ont réellement tenu les propos qui sont dans le livre et ont réellement été en tel lieu à telle date, « et si je trouve une raison quelconque pour laquelle cette scène n’aurait pas pu avoir lieu en réalité ou pour laquelle ces mots n’auraient pas pu être prononcés (…) j’y renonce » (p.1049).
Si autant d’élites de divers pays se rencontrent, c’est que « le siècle » connaissait sa première mondialisation : celle des puissants. Le comte Fitzherbert, lord de droit à la Chambre et féru d’affaires étrangères, invite avant 1914 dans son manoir du pays de Galles des diplomates allemands, américains, français et son beau-frère russe, rencontrés lors des événements mondains de la Season de Londres. Ce ne sera plus possible après-guerre. Car les peuples, gavés de propagande nationaliste par les canards déchaînés, font haïr « les Boches ». Gus l’Américain a vu sa section tirer sur Walter l’Allemand, lequel a espionné dans les tranchées adverses son ami Fitzherbert dont il a épousé la sœur sans l’annoncer.
Ces liens entre les gens sont mis à mal par la stupidité bornée de la génération d’avant, celle des pères et des pairs, des hobereaux prussiens, des barines russes, des lords britanniques : tous veulent la guerre par orgueil, pour « l’honneur ». Ils croient qu’elle sera courte et en dentelles « comme avant ». Sans voir que la technique change tout dans l’art de la guerre (les mitrailleuses, les gaz et les tanks) et que la mobilisation de masse fait passer en force l’égalité politique et le nivellement social : les tommies de base, ouvriers dans le civil, menés au front par leurs officiers timorés sortis d’Eton, ont bien vu l’impéritie de l’organisation, les mensonges du commandement, la légèreté des ordres. Ils se sentent aussi capables et parfois plus aptes à commander que les « élites » par droit héréditaire.
D’où la chute des géants : l’empereur d’Autriche, le tsar, le kaiser, la Chambre des lords. Et l’avènement de la modernité : droits des nationalités à disposer d’elles-mêmes, droit de vote aux femmes, pensions de veuves, fin du métier de valet de chambre, essor du parti travailliste. Seule la France est quasi absente de ce mouvement ainsi conté. Après la Belle époque, les Années folles…
Le livre se lit bien, à condition de ne pas s’arrêter au bout de quelques pages avant de reprendre car on peut perdre le fil. Une récapitulation des nombreux personnages se trouve en début de volume. Cette fresque romancée d’un siècle qui a façonné notre époque donne envie de lire la suite !
Ken Follett, La chute des géants (Fall of Giants) – Le siècle 1, 2010, Livre de poche 2012, 1055 pages, €11.30

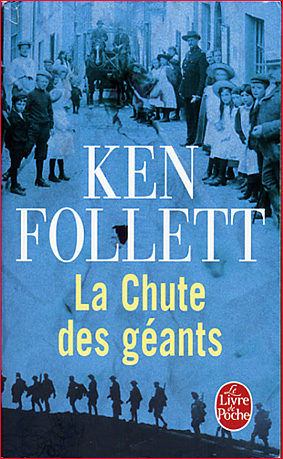
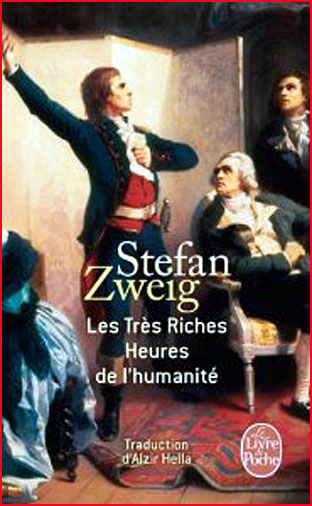



Commentaires récents