Le lendemain samedi, nous allons en visite nous-mêmes au musée de l’Ermitage, ancien palais d’Hiver d’Elisabeth 1ère achevé en 1762. L’ouverture est à 10h30.

Une exposition s’y tient, celle des « Trésors retrouvés » – il y en a 74. Les plus intéressants sont un Manet, « Portrait de Mademoiselle Lemonnier », de 1879, son beau visage songeur est à peine esquissé. De Renoir, « Dans le Jardin », de 1883, à l’atmosphère printanière, lumineuse, c’est l’amour. Les yeux bleus précis sont perdus dans un lointain. De Renoir encore « Roses et jasmin dans un vase de Delft », 1880. De Cézanne, l’une des « Montagne Sainte Victoire » de 1897 ; le tableau est très calme, apaisant, les couleurs pastels ajoutent à l’air serein du paysage. Van Gogh a échoué ici avec un « Paysage avec maison et paysan » de 1889, très coloré ; les figures montent vers la gauche, tout est mouvement. De Manet, « le jardin » de 1876 est un piquetage de touches lumineuses vertes d’une sérénité gaie, une jeune femme en blanc se tient sur la gauche dans une robe mousseline d’une séduisante transparence. Henri Fantin-Latour a peint des « Fleurs » sur quatre tableaux précis, lumineux et charnels. Camille Corot est ici pour son « Paysage avec garçon en chemise blanche » de 1855, que j’aime beaucoup ; le blanc éclate sur la poitrine du garçon, sur le bouleau et la maison, le vert et le sombre sont partout ailleurs ; une femme, cachée dans l’ombre, figure une apparition inquiétante. Empêche-t-elle de vivre tout ce qui luit, l’arbre, l’enfant, la maison ? Ou est-elle l’origine occulte de tout cela, la matrice de vie ?


Dans le reste du musée figurent trois Greuze pleins de vitalité dont un petit enfant aux joues rouges, aux mèches brunes et aux lèvres pulpeuses qui regarde le spectateur avec des yeux couleur biche ; il s’agit du comte P.A. Stroganov enfant, peint en 1778. Un Fragonard dessine le baiser volé, la fille effarouchée, délicieuse, sa commère aux cents coups. Je prends en photo un Pierre b ras droit du Christ, de Rubens, figuré en brave pêcheur rugueux, rougeaud. Et surtout « la jeune fille au chapeau », tableau ovale de Camille Joseph Roqueplan (1800-1855). Le sein gauche est offert aux bouffées de chaleur de l’été par le corsage défait, la fille semble surprise en pleine cueillette de fleurs des champs, au point d’offrir la sienne, nue, sous la jupe qui contient justement la récolte. Sa bouche pincée et son air pudique ne doivent pas tromper ; elle appelle les caresses et j’en suis très ému. Je la ravirais volontiers si elle était de chair. Las ! Pourquoi faut-il que les plus belles, les plus sensuelles, des jeunes filles désirées ne soient que pigments fixés sur une toile par l’imagination embellie ? Gérard de Lairesse (1641-1711) offre une autre désirable fille aux seins nus. Parmi les peintres français du 19ème, David a peint un très sensuel trio nu, Sapho, Phaon et l’Amour. La chair est lumineuse, les formes parfaites, le lit pareil à une nuée, les trois regards sur une même ligne comme si le désir amoureux élevait l’âme vers les hauteurs éthérées et égalait les hommes aux dieux pendant de brefs instants.


Dans la partie moderne, une gardienne me fait m’esclaffer. Cette fonctionnaire stricte, portant jupe longue noire, grosses chaussettes et chemisier blanc boutonné jusqu’au cou, s’est assise sous la vahiné langoureuse de Gauguin « Où vas-tu ? » de 1893, qui porte les seins nus et cueille les fruits (défendus) exotiques sur son île, endroit de paradis (réel et non socialiste) où l’on vit des fruits des arbres et de l’air du temps. Je peux réaliser la photo sans qu’aucune des deux femmes ainsi assemblées par le hasard, n’en rie. Dans le quartier des estampes, oh ! le beau chat noir et blanc japonais. Le peintre a saisi la bête en pleine action de guet, oreilles dressées et yeux attentifs, les pattes tendues. Les ombres noires portées au sol par les branches d’un buisson sont autant de griffes aiguës qui suggèrent la fulgurance cruelle du petit fauve et donnent son atmosphère inquiétante à la scène.


La sculpture est largement présente avec des œuvres des 18ème et 19ème siècles. Le buste de Voltaire par Houdon grimace ses sarcasmes depuis son fauteuil en pointant le bras de l’autre côté de la frontière suisse sur laquelle il s’est prudemment réfugié. L’Amour de Falconet pose son doigt sur ses lèvres mutines, tandis qu’Amour et Psyché, peaux lisses et corps délicieux, se pâment sous le ciseau de Bernozzi. Une fille de Goethe. L’Eros d’Emil Wolf est un garçonnet précieux de 7 ans au corps fin qui promet. Le petit fouleur de raisins de Lorenzo Bertolini n’est guère plus âgé mais a déjà les muscles exercés par le travail ; les boucles de sa chevelure luxuriante sont comme autant de grains de raisins sur sa tête. Le vin pressé aura-t-il autant de corps ?


Le même sculpteur a aussi dégagé du marbre une jeune fille dont la rêveuse nudité est surprise à la toilette, son ventre et ses seins sont régulièrement frottés par des mains subreptices des collégiens russes, à ce qu’il semble. De Thorvaldsen, un jeune garçon sur ses coudes est un parfait 13 ans athlétique au torse bien dessiné, à la chevelure énergique. Du même est un joli Ganymède échanson. De Dupré, un enfant. Abel gît un peu plus loin, admirable cadavre terrestre oublié de Dieu qui n’a pas reconnu les offrandes de viandes de son frère, pourtant bien respectueux lui aussi avant de devenir meurtrier par (légitime ?) jalousie. Une jeune fille semble prier, à deux genoux, avec la seule beauté de son jeune corps fragile, encore vierge, en offrande. J’ai toujours aimé cette Russie immense, énergique et affective.


La peinture à l’Ermitage est un vaste département, il est difficile de décrire tout ce qui séduit. Je note des Matisse, quelques Gauguin, presque tous les Derain, et un Bernard Buffet représentant des poissons, malheureusement exilé dans un couloir au-dessus d’un escalier. En peinture classique il y a de tout : des paysages romantiques de Corot, Ruysdaël, très peu de peinture religieuse, l’Annonciation de Filipino Lippi et une du Corregiano. Les portraits sont en grand nombre, témoignant peut-être du goût affectif des russes qui préfèrent le visage au paysage, avides de l’humain plutôt que des immensités. Le paysage russe est fait de steppes et de grandes étendues et ce qui séduit est l’humain, tout au contraire de nos contrées denses et civilisées, les villes italiennes, les villages français, les capitales régionales allemandes, les campagnes anglaises. Il y a des Van Eyck, des Greuze, quelques Renoir, des Rembrandt (ou « attribués à »).


Nous passons vite les salles de vaisselles, d’armures et d’archéologie scythe ou égyptienne. Il n’y a presque rien sur les Grecs, hors des copies de sculpture, souvent romaines, dont un torse de jeune homme à la courbure élancée. Nous passons rapidement aussi les intérieurs reconstitués, vivants mais clinquants. En fait, seule la peinture (et quelques sculptures pour ceux qui l’aiment) mérite à mes yeux le détour. Mais elle est mal présentée. Des vitres font reflet sur les toiles, les éclairages sont placés de façon scolaire et sont trop directs. En revanche, l’étendue du musée empêche qu’il y ait trop de monde dans les salles et l’on a le temps de contempler les œuvres.


Passent bien sûr des groupes, des Italiens, quelques Français, des Russes évidemment, mais nombre de visiteurs sont individuels, souvent accompagnés d’enfants en ce long week-end. L’été ouvre les cols, les petites filles sont croquignolettes, déguisées comme au ballet. Les parents prennent plaisir à les habiller de couleurs vives et de costumes très typés qui sont charmants. Les garçons sont considérés comme des sauvages qu’il faut laisser courir et se battre, vêtus à la diable ; ils sont plus ternes et n’ont pour eux que leur vigueur ou leur teint.

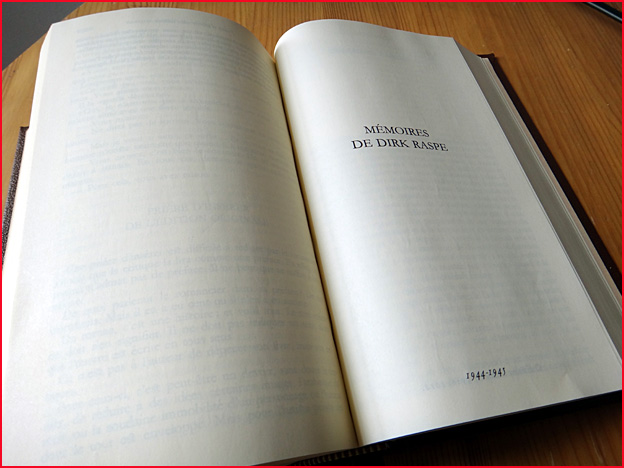
Commentaires récents