Mort à 72 ans, ce qui est jeune pour sa génération, Yves Mathieu-Saint-Laurent, né à Oran, s’est usé à créer. Tourmenté, homosexuel, immature, il s’est gavé de clopes, de drogues et d’alcool pour s’éviter. Dessinateur doué, entré chez Dior avant de fonder sa société grâce à son compagnon de six ans son aîné Pierre Bergé (Jérémie Renier) qui l’a aimé à 22 ans, vivre lui a coûté.
Un brin long (2h30), surtout au début, le biopic librement imagé prend son rythme, malgré les ruptures brutales de son entre certaines scènes. Le spectateur ne peut aimer Yves Saint-Laurent malgré son incarnation par Gaspard Ulliel (trop sain et trop musclé pour le rôle) ; peut-on aimer qui ne s’aime pas ? Le processus continu d’autodestruction par « fragilité » finit par lasser, combien aurait-on envie de coller son pied aux fesses de ce dandy enfermé par les femmes, entouré de miroirs et qui n’aime que les corps qui lui ressemblent ?
Malgré cela, Yves Saint-Laurent est une icône de la mode. Il a suivi et parfois précédé son époque, sensitif aux tendances de l’air : la « libération » de la femme (qui consiste surtout à adapter le caban de marin, le trench-coat flic, la saharienne aventurier et le smoking des hommes…), l’obsession sexuelle (les mousselines qui laissent voir les seins), la « création » spontanéiste.
Comme il a habillé le théâtre (Roland Petit, Jean-Louis Barrault, Luis Buñuel, François Truffaut, Alain Resnais) et les grandes stars médiatiques (Jean Marais, Zizi Jeanmaire, Arletty, Jeanne Moreau, Claudia Cardinale, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve) il a été porté au pinacle de la mode.
Comme il a une sensibilité d’artiste, lui-même peint par Andy Warhol, Saint-Laurent s’inspire de Mondrian, Picasso, Matisse, Cocteau, Braque, Van Gogh, ce qui plaît beaucoup aux classes montantes qui se piquent d’Hârt (comme disait Flaubert) et qui se logent rive gauche. La fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent attire les artistes qui veulent percer et sa « reconnaissance d’utilité publique » en 2002, tandis que Pierre Bergé soutient le parti alors branché, finance les grandes causes médiatiques et devient maître du « journal de référence » en 2010. Qu’aurait été la France des années 1970 et 1980 sans Yves Saint-Laurent dirigé par Pierre Bergé ?
Une France superficielle, défoncée, préférant les mirages de la mode aux tristes réalités économiques, rêvant de changer la vie à l’aide des petites pilules de couleur, se voulant autre qu’elle est. Le dandy trop riche Jacques de Bascher (Louis Garrel) est à pleurer d’insignifiance, il emmène Yves l’inverti s’initier aux bosquets des Tuileries la nuit ; Loulou de la Falaise (Léa Seydoux) s’alcoolise ; l’autre muse Betty Catroux (Aymeline Valade) au beau corps ferme de blonde s’oublie dans la danse sous la musique assourdissante des boites underground, seins nus sous sa veste ; le chien Moujik (« mon fils » disait Saint-Laurent – un fils qui toujours obéit) avale gloutonnement les pilules extatiques tombées de la tablette des deux camés à poil sur le canapé… et crève. Crève-cœur pour le « maitre » immature et insouciant !
En regard, à peine suggéré mais présent, le monde des « petites mains » ouvrières, travailleuses d’étoffes, que ces célèbres artistes défoncés méprisent tout en affectant, par hypocrisie de communication, de leur rendre hommage. Comme s’ils étaient une même famille, comme s’ils ne gagnaient pas cent ou mille fois plus qu’elles. Yves Saint-Laurent donne deux billets de 500 francs à la couturière qui s’est « laissé avoir » et doit avorter – mais il demande à son contremaître « Monsieur Jean-Pierre » (Micha Lescot) de la virer à son retour – se comportant comme une ordure cynique. Pierre Bergé en affairiste logique est très brillant – même s’il exploite la pauvre petite chose fragile qui dessine pour son entreprise. Encenser un artiste à prétexte de gauche permet de mettre sous le tapis tout ce que l’idéologie refuse de voir, malgré ses grands mots plein la bouche et sa morale plein la (bonne, forcément bonne) conscience.
Cette immersion dans la psyché d’YSL, bien que trop longue, est plus intéressante que la bio pure et simple. Elle incite à imaginer plutôt que constater, se révélant plus « vraie » probablement que la réalité. Saint-Laurent sur le grill ? Pierre Bergé ne s’y est pas trompé, qui a renié le film.
DVD Saint-Laurent de Bertrand Bonello, 2014, Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Louis Garrel, Léa Seydoux, Amira Casar, Aymeline Valade, Micha Lescot, EuropaCorp 2015, €9.29

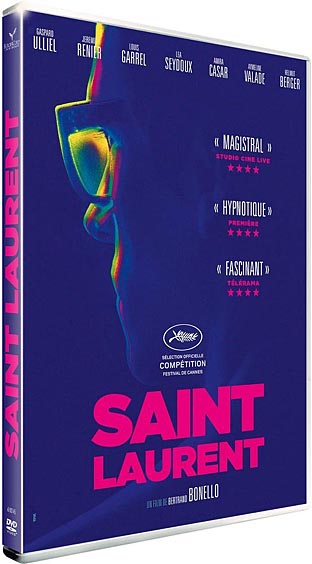


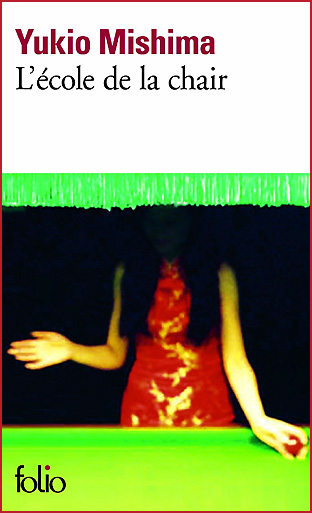
Commentaires récents