Le capitalisme, tout le monde en parle, rare sont ceux qui savent ce que c’est.
Il est en premier lieu une technique d’efficacité économique née avec la comptabilité en partie double à la Renaissance dans les villes italiennes, puis développé par le crédit – basé sur la confiance. Il devient avec la révolution technique puis la révolution industrielle un système de production qui prend son essor et submerge progressivement les velléités du politique. Si les guerres et les grandes crises ramènent l’Etat sur le devant de la scène, le système de production, par son efficacité, reprend très vite le dessus.
La démocratie n’est pas indispensable au capitalisme, puisque les régimes autoritaires comme la Chine l’utilisent à leur plus grand profit ; mais c’est en démocratie, où règne le maximum de libertés, que le capitalisme peut s’épanouir le mieux. Tout le processus démocratique réside cependant dans le délicat équilibre à tenir entre le politique et l’économique, l’intérêt général et les intérêts particuliers. L’historien Fernand Braudel a défini le capitalisme comme outil de la puissance d’Etat pour fonder une économie-monde (aujourd’hui les Etats-Unis, demain peut-être la Chine) : « Puissance dominante organisée par un État dont l’économie, la force militaire (Hard Power), l’influence culturelle (Soft Power) rayonnent partout ailleurs, dominant les puissances secondaires ».
Ce n’est qu’à la pointe du système d’efficacité économique que « le capitalisme » prend la forme idéologique répulsive de l’opinion commune. Fernand Braudel : « Les règles de l’économie de marché qui se retrouvent à certains niveaux, telles que les décrit l’économie classique, jouent beaucoup plus rarement sous leur aspect de libre concurrence dans la zone supérieure qui est celle des calculs et de la spéculation. Là commence une zone d’ombre, de contre-jour, d’activités d’initiés que je crois à la racine de ce qu’on peut comprendre sous le mot de capitalisme, celui-ci étant une accumulation de puissance (qui fonde l’échange sur un rapport de force autant et plus que sur la réciprocité des besoins), un parasitisme social, inévitable ou non, comme tant d’autre. » Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVE –XVIIIe siècles, 1979, t.2 p. 8.
David Djaïz, « haut fonctionnaire » mais diablement intelligent, livre dans le numéro 209 de la revue Le Débat, mars-avril 2020, une brève histoire du processus capitaliste dans l’histoire. S’il est né dans les villes italiennes et flamandes au XVe siècle, il est resté « en taches de léopard » dans les villes libres et les grandes foires, « espaces de transaction d’où étaient exclues la violence et la ruse ; [né] d’une accumulation ‘primitive’ de capital par des marchands devenus des banquiers et des assureurs ; de la construction d’un réseau d’infrastructures et de moyens de transport (ports, routes, flottes de bateaux) ; d’une sécurité juridique naissante des contrats et des lettres de change ».
En revanche, l’expansion « systématique » du capitalisme ne fut est possible qu’avec la formation de l’Etat-nation moderne. « L’Europe a été le berceau de ce processus puisqu’elle a vu, entre le XVIe et le XIXe siècle, se produire une triple révolution : spirituelle (la Réforme et la Contre-Réforme), politique (la Révolution française et ses épigones), et productive (la révolution industrielle) ». Le capitalisme a cependant dû s’émanciper du carcan des Etats-nations pour repousser les frontières du possible, au-delà du cadre institutionnel, réglementaire et politique. Le pays de la Frontière (les Etats-Unis) est le lieu où le capitalisme s’est épanoui le mieux parce que la mentalité du pionnier encourageait de repousser n’importe quelle borne (l’Ouest, le monde, l’espace, le « trans » humanisme). « Lorsqu’un marché intérieur approche de la saturation, que l’équilibre épargne/investissement est rompu à l’intérieur d’un territoire donné (le plus souvent en raison d’un excès d’épargne qui n’arrive pas à ‘s’allouer’), les capitaux cherchent à se déployer à l’extérieur du périmètre géographique dans lequel ils se sont formés ». D’où les liens avec l’impérialisme hard (colonialisme européen ou soviétique) ou soft (hégémonie culturelle, économique, militaire américaine ou chinoise). D’où la pression pour désocialiser de l’intérieur les Etats en repoussant les limites du travail et de la fiscalité. Enfin la sape systématique de la propension à « économiser » des individus en poussant la consommation par la publicité et en suscitant le désir via le prestige social et la mode.
La disposition à créer sans cesse de nouvelles inégalités sociales est la règle, puisqu’elle permet l’émulation du désir, donc du commerce. Il s’agit « d’intégrer au circuit de l’échange marchand non plus simplement les biens matériels qui sont produits, mais les facteurs de production eux-mêmes – la terre, la force de travail, le capital financier, les savoir-faire – et ce afin d’intensifier et d’optimiser leur utilisation dans le cadre du processus productif ». Je vous le disais : le capitalisme est la forme d’efficacité économique la plus avancée. En tant que méthode de production, il peut s’appliquer à tout : y compris l’écologie. Car produire le plus avec le moins est son système – donc l’épargne maximum des ressources et l’optimisation du savoir. Sauf que « le capitalisme » n’a pas de but autre que persévérer dans sa propre technique. C’est le rôle des politiques de le faire servir – aux Etats-nations puisque nous en sommes toujours là, à la planète Terre puisque c’est indispensable. L’outil n’agira pas de lui-même, il servira ceux qui l’utilisent.
Ce pourquoi nous assistons à une « réaction » – analogue à celle des années 1930 après la Grande guerre puis la Crise de 29 – contre « le capitalisme ». Mais c’est accuser le marteau d’écraser plutôt que celui qui le tient… « Lorsque la marchandisation du travail et de la terre atteint un degré tel que la dignité humaine, la culture, les traditions, le cadre de vie sont menacés par la transgression du marché en dehors de la sphère économique, la société cherche à se protéger ». Après 1945 par exemple, le capitalisme « fut reterritorialisé, resocialisé et respécialisé ». Les Etats devant se reconstruire, les entreprises ne visaient pas le grand large. La croissance forte des Trente glorieuse a servi à financer plus de protection sociale et « le pouvoir d’achat réel des salariés a triplé en 25 ans » (1950-1975). Le développement du droit du travail et du droit international a démarchandisé le travail humain (durée maximum du travail, interdiction du travail des enfants, etc.). Mais ces « progrès » ne sont pas acquis une fois pour toutes car ils ont été permis par « les bas coûts de l’énergie, ainsi que la fluidité et la disponibilité des réseaux d’extraction et de circulation du pétrole » – avec les « perturbations irrémédiables que celle-ci engendra sur le système Terre ».
Le « système » de progrès indéfini – économique, social – n’est donc pas possible sans énergie abondante et bon marché. Dès lors que nous ne l’avons plus, deux voies s’ouvrent : la voie autoritaire (à la chinoise) où le capitalisme devient « vert » au prix du rationnement ; la voie démocratique qui négocie capitalisme et soutenabilité dès la base locale en associant le citoyen à « la production de la politique publique ». La troisième voie existe, mais elle est purement réactive, comme un combat désespéré pour persévérer selon le passé, par refus de voir la réalité et sans véritable espoir : « du Brésil à l’Inde, en passant par les Etats-Unis, nous voyons surgir un néonationalisme morbide, viril et excluant, peu soucieux des libertés individuelles, dont il est peu niable qu’il soit le résultat de la polarisation des sociétés provoquée par la grande crise de 2008 et, plus structurellement, par quarante années de mondialisation libérale mal maîtrisée ».
Où l’on en revient à Fernand Braudel : le capitalisme efficace exige un Etat puissant qui organise l’économie et la société et qui fait face à l’extérieur. L’article a été publié avant, mais la maladie Covid-19 l’a démontré sans conteste.




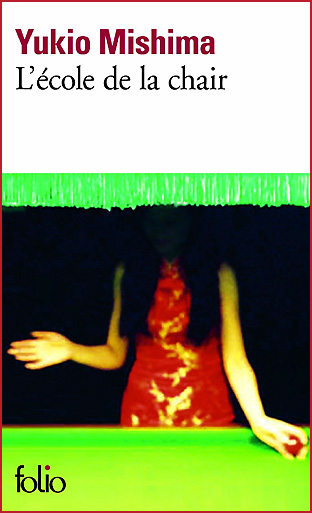
Commentaires récents