Nous voici donc libres d’organiser le reste de la journée à notre guise. Nous changeons tout d’abord un peu d’argent à la banque Aeroflot, située canal Griboïedova. Avec 20 US$, je me retrouve avec un gros paquet de roubles, à 4400 roubles pour 1 seul dollar. Un seul billet de 200 roubles représentait un mois de salaire de fonctionnaire sous Brejnev ; aujourd’hui, il ne vaut plus que 20 centimes de francs au change officiel…


Vers la Perspective Nevski, sous les arches de Notre-Dame de Kazan, je photographie un gavroche blond de 7 ans avec ses deux petites sœurs. Ils sont pauvres et jouent avec application. Il manque nombre de boutons à sa chemise, comme David Copperfield, mais le garçon est une boule de joie. Il a construit un bateau avec une caissette de polystyrène servant à livrer le poisson, un bâtonnet en guise de mât et une voile en papier. Il vient de le faire voguer sur le canal. Quand il me voit prendre la photo, il essaye de se planquer, ne se sentant peut-être pas à son avantage ainsi dépoitraillé, puis il rit. Je regrette que mon russe soit quasi inexistant, j’aurais aimé lui dire quelques compliments.

Comme il est 13h30, nous allons nous restaurer pour 24 US$ chacun au « Café Littéraire » non loin de là. Ce café est le dernier dans lequel Pouchkine se soit rendu avant de mourir en duel. Nous prenons une viande originale, « à la Pétersbourg » : il s’agit d’une tranche de bœuf roulée sur une purée d’oignons, pommes de terre et lardons. Nous goûtons une vodka parfumée à l’écorce d’orange.


Puis le couple entame ses courses de souvenirs à rapporter aux filles et aux parents, sur un marché libre à l’extrémité nord du canal Griboïevda. Les commerçants sont des jeunes un peu émancipés, s’intéressant au monde et faisant leurs les nouvelles normes d’initiative. Ils portent des jeans et certains sont torse nu. Le soleil s’est remis de la partie et il fait chaud mais la ville reste prude et le gamin le plus déluré ne va pas torse nu par les rues comme un petit américain moyen – à l’époque. De même que chez nous dans les années 50, ici « cela ne se fait pas ». On porte débardeur ou l’on ouvre sa chemise, et même largement, à la prolétaire, mais on ne la quitte pas. Le faire est preuve ici d’émancipation des « vieilles mœurs », sur le modèle occidental – ce qui sera remis en cause avec la réaction moraliste sous Poutine.
Les achats du couple se résument à quelques matriochkas, dont une série de chats et une autre des divers présidents… américains ! Il existe aussi une série reprenant les souverains de Russie, de Pierre le Grand (en tout petit à l’intérieur) à Boris Eltsine (la poupée qui englobe toutes les autres jusqu’à présent). Pour la ville, Pierre le Grand est bien le noyau. C’était un dictateur détesté mais aussi un maître d’école qui a discipliné les rustres en édifiant une cité moderne sur de vulgaires marécages. Il était volontaire, mais d’un tel orgueil qu’il se prenait pour Dieu. Ambivalence russe : on ne peut entreprendre sans déraper dans l’excès, ou alors on ne fait rien et l’on s’enfonce dans l’arriération. Poutine, dans la décennie 2010, en a retenu les leçons.

Une fois ce devoir familial des cadeaux accompli, nous joignons à pied la gare de Finlande qui est assez loin, puisqu’il faut traverser la Neva. La gare a été reconstruite dans les années 1960, mais je veux depuis de longues années photographier la statue en bronze de Lénine haranguant la foule du haut d’une tourelle blindée lors de son retour d’exil le 3 avril 1917. Elle date de 1926. Le portrait coulé en bronze de la gare de Finlande présente le « vrai » Lénine, celui que l’histoire retiendra. Il a le front aussi obtus que la tourelle de l’engin blindé, les yeux comme des obus, la main telle un canon. Il est l’incarnation de la paranoïa fanatique, obsédé de pouvoir, blindé dans sa pensée, éliminant impitoyablement tous les tièdes dans un holocauste permanent au Baal terroriste. Encore une fois, Poutine se voudra en un sens son héritier.

Ce pieux devoir accompli, nous revenons par la maison de Pierre le Grand – qui est fermée. C’est une maisonnette de bois construite près de la Neva, habitée l’été 1703 par le tsar. Nous ne verrons que son enveloppe en briques. La basilique aussi est fermée.


Nous passons devant la forteresse Pierre et Paul au plan en étoile à la Vauban, qui n’a jamais servie. Trois jeunes garçons se baignent au pied de la forteresse, dans la Neva qui roule ses eaux que l’on voit rapides sous le pont un peu plus loin. Ces baigneurs ont la charpente vigoureuse des gens d’ici, habitués au froid d’hiver et à l’exercice, mais la peau trop blanche de connaître si peu le soleil. Malgré les 18°, c’est bien l’été à Saint-Pétersbourg, et la jeunesse en profite. Le costume de jean, porté sur un tee-shirt blanc ou une chemise blanche, ou à même la peau, fait fureur. Je remarque peu de visages aux traits réguliers mais une aura de blondeur, de force et de santé. Nous croisons des familles, des gamins en chemisettes ouvertes ou en tee-shirts marins, venues visiter le croiseur Aurora aux trois cheminées droites et au museau obtus du style naval 1903. C’est lui qui donna le signal de la Révolution de 1917 en tirant sur le Palais d’Hiver.









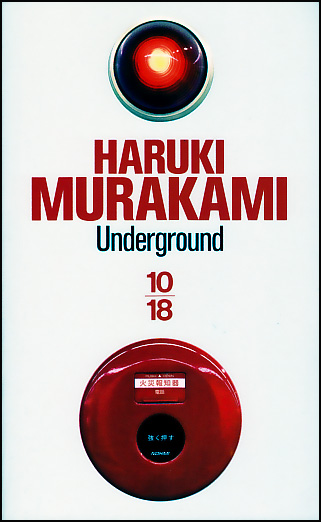
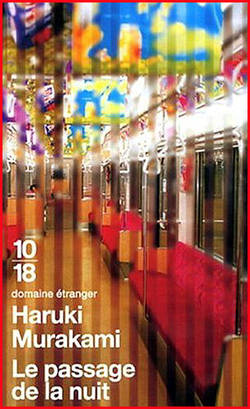

Commentaires récents