Long est ce chapitre XVII du Livre II des Essais. Sous le titre général « De la présomption », Montaigne parle de lui. Il s’y étale, il s’y roule. Non par vanité mais par souci de bien parler de ce qu’il connaît. « Il y a une autre sorte de gloire, qui est une trop bonne opinion que nous concevons de notre valeur », commence-t-il. Et il va l’étirer sur 23 pages de l’édition Arléa. C’est qu’il n’est pas aisé de se connaître soi-même. Nous nous aimons et cela fausse notre jugement sur nous-même. Mais se déprécier par principe est aussi vain. « Je ne veux pas que, de peur de faillir de ce côté-là, un homme se méconnaisse pourtant, ni qu’il pense être moins que ce qu’il est. »
La société formate l’être humain et le déforme. « Nous ne sommes que cérémonie », dit Montaigne, parure apprêtée pour le regard d‘autrui, tout d’apparences et de convenances. « La cérémonie nous défend d’exprimer par la parole les chose licites et naturelles, et nous l’en croyons. » Laissons donc la cérémonie, dit l’auteur. La fortune fait beaucoup pour le jugement, ce qu’on appelle la réputation. Mais les autres, les communs, les anonymes ? Montaigne se met parmi eux et veut être jugé par ses écrits.
Jeune, on remarquait en lui « je ne sais quel port de corps et des gestes témoignant quelle vaine et sotte fierté. » Et alors ? dit-il : « il n’est pas inconvenant d’avoir des conditions et des propensions si propres et si incorporées en nous, que nous n’avons pas moyen de les sentir et reconnaître. » Et de citer Alexandre, César et Cicéron. Ces mouvements sont naturels, différents des artificiels que sont les « salutations et révérences » qui sont politesse mais peuvent devenir servilité.
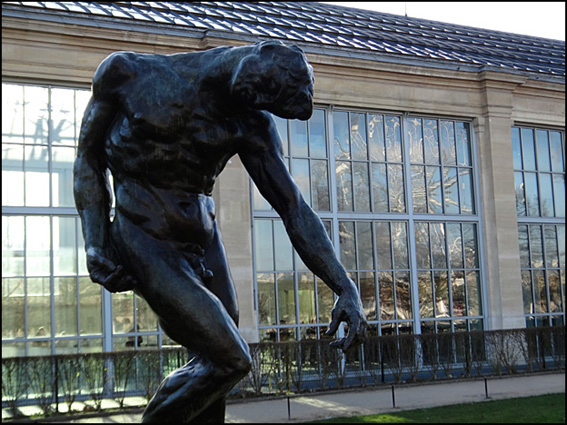
Pour ce qui est de « l’âme », il distingue « deux parties en cette gloire : savoir est, de s’estimer trop, et n’estimer pas assez autrui ». Pour Montaigne, son « erreur d’âme » est de diminuer les qualités qu’il possède et hausser les qualités de ce qu’il ne possède pas. L’herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, avait coutume de dire un mien patron à qui voulait partir évoluer ailleurs. Ce qui fait déconsidérer ce que l’on a et envier ce que l’on n’a pas. Travers commun : un blond imberbe de corps enviera sans raison le brun velu (j’en ai connu un) ; une brune aux cheveux plats enviera une blonde aux cheveux bouclées (j’en ai connu une).
La philosophie aide à reconnaître en l’être humain « son irrésolution, sa faiblesse et son ignorance. » Car « il me semble que la mère nourrice des plus fausses opinions et publiques et particulières, c’est la trop bonne opinion que l’homme a de soi ». D’où la morgue des faux savants, la certitude technocratique des politiciens, la croyance dure comme fer des complotistes pour leurs élucubrations.
Cette digression digérée, Montaigne en revient à lui. « Il est bien difficile, ce me semble, qu’aucun autre s’estime moins, voire qu’aucun autre m’estime moins, que ce que je m’estime ». Une fois ces jeux de mots faits, le propos est de dire que rien ne satisfait Montaigne : ni le mouvement en lui, ni le jugement d’autrui. « J’ai le goût tendre et difficile, et notamment en mon endroit. » Il voit clairement mais fait mal. C’est particulièrement le cas en poésie ! « Je suis envieux du bonheur de ceux qui savent réjouir et gratifier en leur besogne, car c’est un moyen aisé de se donner du plaisir, puisqu’on le tire de soi-même. » Lui peine à écrire – comme Flaubert. Il n’est jamais satisfait des idées qu’il exprime, n’a qu’« une certaine image trouble » d’une forme qui serait meilleure sans qu’il puisse la saisir. « Tout est grossier en moi », résume-t-il. De même parler : « je ne sais parler qu’en bon escient, et suis dénué de cette facilité que je vois en plusieurs de mes compagnons, d’entretenir les premiers venus et tenir en haleine toute une troupe, ou amuser, sans se lasser, l’oreille d’un prince de toutes sortes de propos, la matière ne leur faillant jamais… »
Quant à la beauté, c’est « une pièce de grande recommandation au commerce des hommes », constate Montaigne en citant les antiques. Le corps en premier car l’âme n’est rien sans son enveloppe selon « les chrétiens », dit-il. Pour le mâle, il doit être grand – « or je suis d’une taille un peu au-dessous de la moyenne », avoue Montaigne. « Les autres beautés sont pour les femmes », assure-t-il un brin amer. Le front, les yeux, le nez, la bouche, les dents, l’épaisseur de la barbe, la fraîcheur du teint, la proportion légitime des membres ne comptent pas, quand il s’agit des hommes. Lui avait tout cela, avec la santé, en son adolescence et son âge mûr, dit-il. Mais, « ayant piéça franchi les 40 ans (…) je m’échappe tous les jours et me dérobe à moi. » Il devient un « demi-être ».
« D’adresse et de disposition, je n’en ai point eu », dit-il, ni pour la musique, ni aux sports ou à la danse, ni pour nager, escrimer, voltiger ; ni pour bien rédiger ni écrire. Et il se compare à son père qui avait toutes les qualités. Il se résume ainsi : « Mes conditions corporelles sont en somme très bien accordantes à celles de l’âme. Il n’y a rien d’allègre ; il y a seulement une vigueur pleine et ferme. » Mais ce n’est pas si mal… Il se dit « extrêmement oisif, extrêmement libre, et par nature et par art » – que lui faut-il de plus ? S’il a du plaisir à faire, il s’y lance et le fait bien – que dire de mieux ? N’ayant eu ni commandant, ni maître forcé une fois adulte, il se juge « paresseux et fainéant » – mais selon quelle règle ? « J’ai marché aussi en avant et le pas qu’il m’a plu » – n’est-ce pas là une sagesse ?
Il n’a pas été ambitieux, ni n’a convoité la fortune, ayant à sa suffisance et dédaignant de compter. Il n’a « eu besoin que de jouir doucement des biens que Dieu par sa libéralité m’avait mis entre les mains ». « Mon enfance même a été conduite de façon molle et libre, et exempte de sujétion rigoureuse », dit-il – mais n’est-ce pas l’éducation que nous prônons ? Le terme de « molle » ne signifie pas pour lui à la paresseuse, mais sans grandes contraintes, en douceur. Il « s’abandonne du tout à la fortune », il s’efforce « de prendre toutes choses au pis. » N’est-ce pas cela la sagesse issue des stoïciens et des épicuriens ? En se dévalorisant en apparence, Montaigne dessine en creux la force qu’il a et la personne qu’il est. « Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même, et m’applique à eux s’ils ne s’appliquent à moi. » N’est-ce pas une attitude raisonnable et plus efficace que de se révolter contre « le sort » et de rêver à d’inutiles « yaka » ?
Il est mal en son siècle de troubles civils, de peste pandémique et de guerre de religions. Il se serait trouvé mieux chez les Romains. « Les qualités mêmes qui sont en moi non reprochables, je les trouvais inutiles en ce siècle. La facilité de mes mœurs, on l’eût nommée lâcheté et faiblesse ; la foi et la conscience s’y fussent trouvées scrupuleuses et superstitieuses ; la franchise et la liberté, importunes, inconsidérées et téméraires. » Le siècle de turpitudes, tout « de feintises et de dissimulation » rend vertueux à peu de frais ; il suffit d’être bon. « Il ne faut pas toujours dire tout, car ce serait sottise ; mais ce qu’on dit, il faut qu’il soit tel qu’on le pense, autrement c’est méchanceté. » Montaigne avoue être mauvais dans cet art politique. « Présentant aux grands cette même licence de langue et de contenance que j’apporte de ma maison, je sens combien elle, décline vers l’indiscrétion et incivilité. Mais, outre que je suis ainsi fait, je n’ai pas l’esprit assez souple pour gauchir à une prompte demande et pour en échapper par quelques détour, ni pour feindre une vérité, ni assez de mémoire pour la retenir ainsi feinte, ni certes assez d’assurance pour la maintenir ; et fais le brave par faiblesse. » Montaigne avoue avoir peu de mémoire, ce qui le handicape dans la vie courante – mais lui permet d’écrire ce que lui pense, sans passer par les filtres des autres, bien qu’il assaisonne ses Essais, par convenance sorbonagre, de citations diverses. Il avoue aussi avoir l’esprit peu aiguisé : « Aux jeux, où l’esprit a sa part, des échecs, des cartes, des dames et autres, je n’y comprend que les plus grossiers traits. L’appréhension, je l’ai lente et embrouillée ; mais ce qu’elle tient une fois, elle le tient bien et l’embrasse universellement, étroitement et profondément, pour le temps qu’elle le tient. » Encore une fois, Montaigne fait de ses faiblesses des forces…
Le scrupule et l’embrouillamini de son esprit le conduisent à balancer pour toute décision. Il se laisse porter par le sort, ou la foule, dit-il. Ce pourquoi il est conservateur. « Il n’est aucun si mauvais train, pourvu qu’il ait de l’âge et de la constance, qui ne vaille mieux que le changement et le remuement ». L’instabilité est pire que le mal, observe-t-il. Il se pique d’être commun, donc d’avoir du bon sens – le sens commun. « Je pense avoir les opinions bonnes et saines ; mais qui n’en croit autant des siennes ? L’une des meilleures preuves que j’en aie, c’est le peu d’estime que je fais de moi » – une fois de plus, le défaut est renversé en qualité. C’est le en même temps, le yin et le yang, le balancement de sagesse. « Chacun regarde devant soi ; moi, je regarde dedans moi ». Les « imaginations » qu’il a en lui, Montaigne les a « établies et fortifiées par l’autorité d’autrui, et par les sains discours des anciens », mais elles sont avant tout « naturelles et toutes miennes », dit-il.
L’éducation de son temps ne formait pas au jugement, et c’est ce qu’il lui reproche. « Elle a eu pour sa fin de nous faire non bons et sages, mais savants : elle y est arrivée. » Et elle poursuit de nos jours cette fin d’enseigner et non d’éduquer, de former de futurs professeurs, pas des citoyens ni des praticiens. « Elle ne nous a pas appris de suivre et embrasser la vertu et la prudence, mais elle nous a imprimé la dérivation et l’étymologie. » A la fin de ce chapitre, venu bien tard dans l’œuvre, le lecteur connaît mieux Montaigne ; il est moins austère et plus proche de chacun, il reconnaît ses faiblesses et les change en forces. Il donne l’exemple.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.)
Michel de Montaigne,avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog




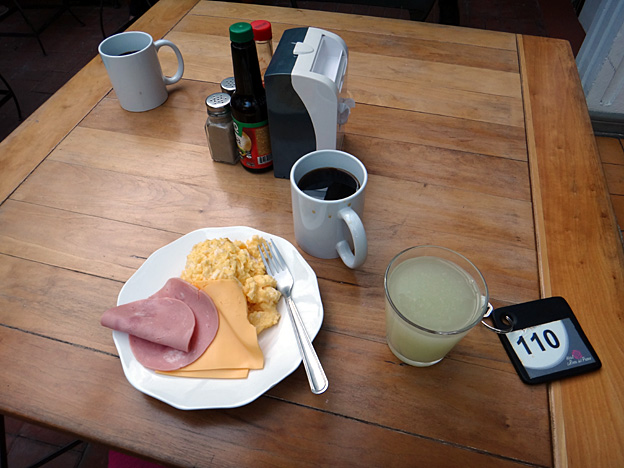




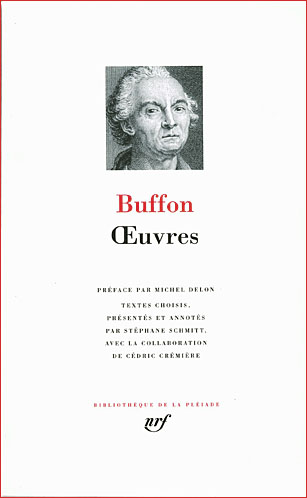

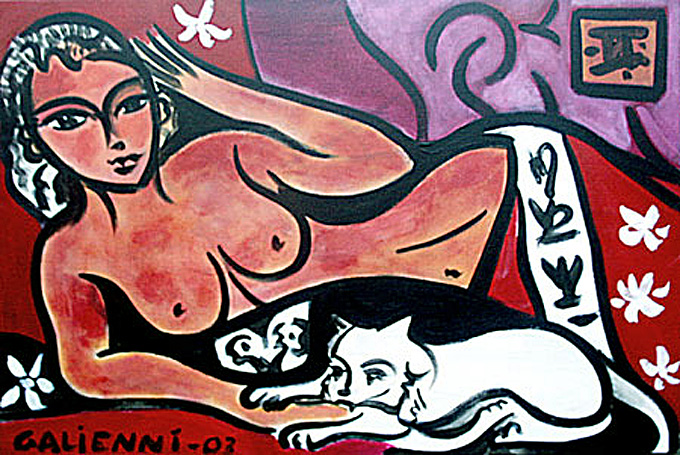

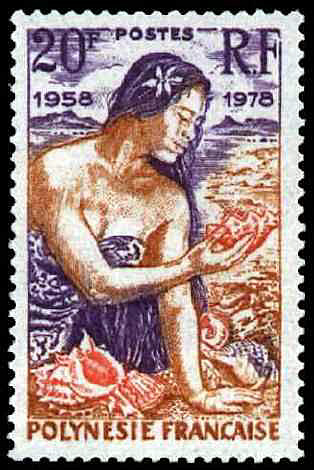
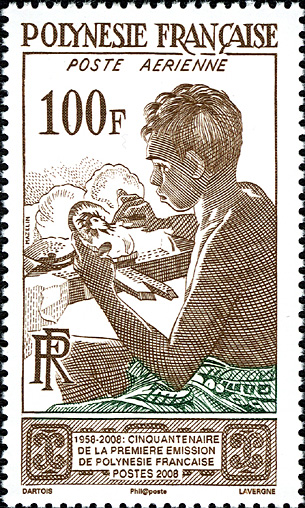

Commentaires récents