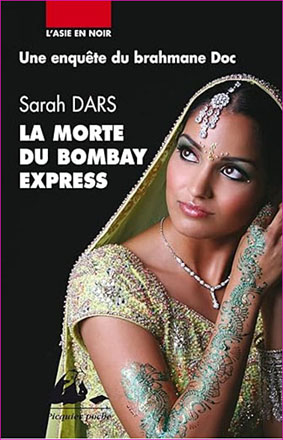
Ce livre est au croisement d’une fan de romans policiers et d’une spécialiste des langues orientales qui a beaucoup voyagé en Mongolie et en Inde entre autres. Sarah Dars, française, écrit sur la mentalité et les mœurs indienne comme si elle y était née. C’est ce qui fait son charme et ravira ceux qui sont allés en Inde du sud et connaissent ses paysages et ses habitants.
Bien sûr, son brahmane médecin détective amateur, expert en art complet du Kerala, art martial et art médical en même temps – le Kalarippayatt qui apprend à tuer et à soigner – est un peu « trop », comme disent encore les ados, trop parfait, séduisant, souple, invincible, intuitif. Mais c’est un plaisir de lire ses déductions et de suivre ses aventures. Une sorte de Sherlock Holmes en plus convivial, bien que végétarien et abstinent de tout alcool. A l’anglaise, il ne se promène jamais sans parapluie, moins contre la pluie ou le soleil que comme bâton de combat.
Doc – il ne porte que ce surnom – est flanqué d’un compère médecin à la Watson, le fidèle Arjun. Habitant Madras, ils prennent le train pour Bombay, Mumbai comme on dit aujourd’hui par nationalisme hindou anti-anglais – bien que le nom de Mumbai vienne du portugais… Le Bombay-Express se traîne sur les plaines assommées de chaleur et se tortille sur les pentes des ghats qui traversent la péninsule indienne entre deux océans. C’est lors d’une nuit à bord que, dans le compartiment des premières, une femme en sari synthétique meurt d’un incendie, la porte verrouillée.
Qui l’a fait ? S’est-elle suicidée par le feu comme les veuves traditionnelles qui suivent leur mari dans la mort ? Mais le sien de mari, le jeune producteur de Bollywood Bijal, fils de la célèbre star Tâmrâ, tous deux dans le même train, est bien vivant. Il est fusionnel avec maman et dédaigne sa jeune Priyânka, fille d’un magnat de l’industrie probablement épousée pour sa dot – que son père a finement cantonnée pour éviter que le mari ne mette la main dessus. Alors, est-ce un meurtre ? Mais quid de la porte verrouillée ? Et que vient faire le trop beau secrétaire de Bijal dans cette affaire, lui qui a tiré le signal d’alarme mais est retourné dans son compartiment immédiatement après ?
A Bombay, aux 18 millions d’habitants sous la mousson, l’enquête policière piétine et Doc joue les intermédiaires entre la famille du mari, dont il soigne la star éprouvée par ces événements, la famille de la morte, qui soupçonne fortement l’époux bollywoodien Bijal, et la police, dont l’inspectrice névrosée irascible ne sait comment avancer. Il en profite pour établir un régime pour Kaustubh son beau-frère, dont l’épouse Kamalâ cuisine trop bien pour son tour de taille. En se promenant, il est pris à partie par un malfrat à qui il fait son affaire – sans le tuer. Raghunâth le jeune secrétaire bengali disparaît, il se sent menacé, Doc le recherche. Est-il coupable de quelque chose ?
Doc le brahmane expert en arts du Kerala, se veut un homme complet, un sage qui déverse sa bienveillance sur ses semblables trop accrochés par leurs émotions. « Il devait être en plus ferré sur la philosophie, la morale, la stratégie, et capable, par conséquent, de participer à des joutes verbales comme à toutes sortes d’affrontements purement doctrinaux » p.200. Mais si cette mort n’était au fond qu’une sinistre plaisanterie ? Un rire du destin ? Un karma qui se gondole ?
Sarah Dars, La morte du Bombay-Express – Une enquête du brahmane Doc, 2002, Picquier poche 2013, 245 pages, €7,10 (liens sponsorisés Amazon partenaire)




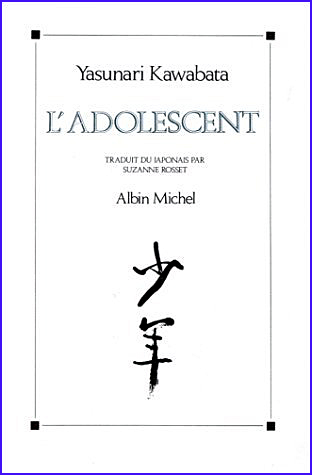

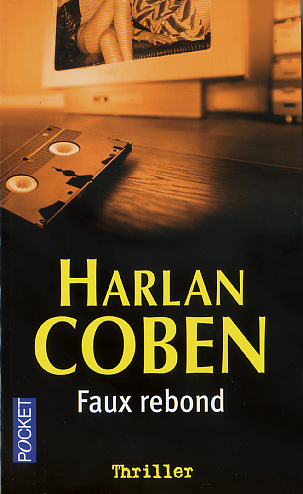
Commentaires récents