Dans le chapitre 26 du livre 1erde ses Essais, Montaigne disserte sur « l’institution des enfants », autrement dit leur éducation. Elle est bien plus qu’un élevage car elle ne se contente pas de nourrir le corps mais aussi l’âme – nous dirions aujourd’hui le caractère et l’esprit. Le philosophe a longuement préparé son texte car il le destine à Diane de Foix, comtesse de Gurson de laquelle il est proche par lien féodal, et qui va bientôt être mère.
Après s’être excusé de n’être savant que de ce qu’il a appris dans sa vie, ce qui tient bien trois grandes pages que l’on peut passer sans dommage, il affirme tranquillement : « ce sont mes humeur et opinions ; je les donne pour ce qui est en ma croyance, non pour ce qui est à croire ». Autrement dit, prêtez-y attention, comme il se doit, puis faites ce qui vous semble bon.

Car élever un petit d’homme est plus difficile que le planter car les humains ne sont pas des bêtes. Tout ne leur vient pas du programme génétique comme les plantes, ni de leur instinct comme les animaux, mais surtout des exemples et imitations des autres, tant l’humain est un être social. Au rebours, on ne peut non plus forcer leur nature. Il faut plutôt avoir, pour qui enseigne, plus « envie d’en tirer un habile homme qu’un homme savant ». Pour cela, « lui faire goûter les choses », ne pas parler tout seul mais l’écouter aussi, « juger de son train (…) pour s’accommoder à sa force ». Il s’agit de guider plus que d’imposer, de donner envie plus que de contraindre. Rousseau reprendra cette philosophie dans son Émile.
« Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu’il juge du profit qu’il aura fait non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. » Le par-cœur abêtit, l’assimilation élève. Pour cela, il faut des exercices, « accommodés à autant de divers sujets ». Pas de dogmes, mais un jugement personnel. « Qu’il lui fasse tout passer par l’étamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit ». Voilà qui est très Lumières et démocratie : ne rien tenir pour vrai que l’on en ait jugé par soi-même, ne suivre les autres que s’ils nous ont convaincus par des faits (ce qui est bien rare aujourd’hui). Pas plus la Bible qu’Aristote ou une autre doctrine ne doit être prise telle quelle pour vérité : de tout il y a à prendre et à laisser, selon son propre jugement. « Il n’y a que les fous certains et résolus ». Notons que la folie envahit notre époque. Les opinions des autres qui lui conviennent, qu’il les fasse sienne. « La vérité et la raison sont communes à un chacun, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement, qu’à qui les dit après ». Les abeilles font ainsi leur miel des divers pollens qu’elles pillent aux fleurs, mais ce miel n’est plus fleur, il est leur.
« Le gain de notre étude, c’est en être devenu meilleur et plus sage ». En faire un homme, pas un singe savant comme en sortent trop souvent de certaines de nos écoles. Car « savoir par cœur n’est pas savoir : c’est tenir ce qu’on a donné en garde à sa mémoire » – pire encore lorsqu’on dispose du net ! La mémoire est désormais moins utile mais le jugement beaucoup plus que du temps de Montaigne. Pour juger sainement, préconise le philosophe, « le commerce des hommes » et « la visite des pays étrangers » pour « frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui ». Curiosité entraîne humilité, soif de comprendre et – donc – intelligence. Seuls les ânes savent tout par seule croyance. L’actuel tropisme au repli sur soi, à l’entre-soi de la famille, de la bande et du milieu, à la régression nationale – ou même locale dans l’écologisme – n’est en faveur de l’intelligence…
Il ne faut surtout pas épargner la jeunesse, ce pour quoi les parents trop aimants sont nocifs. « Ils ne sont capables ni de châtier ses fautes, ni de le voir nourri grossièrement, comme il faut, et hasardeusement. Ils ne le sauraient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice. » Si la philosophie roidit l’âme, l’exercice « roidit les muscles » et la douleur physique permet de devenir apte à supporter le travail et l’effort. « La course, la lutte, la musique, la danse, la chasse, le maniement des chevaux et des armes », telle sont les activités que préconise Montaigne pour son temps. Nous pouvons le traduire en judo, footing, danse, musique, jeux vidéo pour l’adresse et l’attention, s’occuper d’un chien ou monter à cheval pour l’interaction avec l’animal, s’occuper de plus jeunes à l’adolescence.
À l’enfant, il lui faudra apprendre la modestie et le parler franc à bon escient dans le commerce des hommes. « Qu’on le rende délicat au choix et triage de ces raisons, et aimant la pertinence, et par conséquent la brièveté. » Il ne faut pas chercher à jouer un rôle, mais à se présenter en vérité. La vérité, d’ailleurs, faut la chercher en tout discours, « soit qu’elle naisse dans les mains de son adversaire, soit qu’elle naisse en lui-même par quelque ravissement. » Se corriger en abandonnant un mauvais parti est de qualité. « La sottise même et faiblesse d’autrui lui sera instruction ». Tout sert, toute observation des autres pour se régler soi-même.
Les livres complètent la société. Nous pouvons ajouter pour notre époque les films et les podcasts. « Il pratiquera, par le moyen des histoires, ces grandes âmes des meilleurs siècles ». Mais qu’il se souvienne de tirer leçon plus qu’érudition car moins importe « la date de la ruine de Carthage que les mœurs d’Hannibal et de Scipion ». Il devra voir au-delà du bout de son nez, s’élever au global : « Qui se présente, comme dans un tableau cette grande image de notre mère nature en son entière majesté (…) une si générale et constante variété (…), celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur ». Car seule la variété permet de mesurer et de se situer.
« Tant d’humeurs, de sectes, de jugements, d’opinions, de lois et de coutumes nous apprennent à juger sainement des nôtres » – plus encore dans une époque de guerres de religions comme Montaigne l’a connu, et nous-mêmes aujourd’hui. À partir de ces exercices concrets, « assortir tous les plus profitables discours de la philosophie », ce « que c’est que savoir et ignorer (…) vaillance, tempérance et justice (…) ambition et avarice, la servitude et la sujétion, la licence et la liberté ». C’est en observant la comédie humaine que l’on augmente sa propre sagesse. Combien, de nos jours, l’ont-ils appris ?
L’art qui nous fait libre doit être le premier enseigné. Il s’agit de la philosophie. « Commence et ose être sage », dit Horace, cité, « différer l’heure de bien vivre c’est faire comme ce paysan qui attend, pour passer le fleuve, que l’eau ait fini de couler ». Or on nous apprend à vivre quand la vie est passée, la jeunesse, « on la rend débauchée, l’en punissant avant qu’elle le soit ». La morale doit suivre les exemples, pas l’inverse.
Après le savoir qui règle les mœurs et l’entendement « à se connaître, et à savoir bien mourir et bien vivre », les autres sciences sont utiles : « logique, physique, géométrie, rhétorique ». Car la philosophie « on a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants ». Elle « doit par sa santé, rendre sain encore le corps », faire apparaître sa tranquillité d’esprit, montrer « une gracieuse fierté, d’un maintien actif et allègre » de qui est bien dans sa tête et son cœur, qui sait qui il est et ce qu’il fait là. « La plus expresse marque de la sagesse, c’est une jouissance constante », déclare Montaigne. Ce sont les cuistres, jaloux de leur jargon qui vaut pour eux profondeur et savoir, qui font de la philosophie aigreur et contraintes. « Il lui fera cette nouvelle leçon que le prix et hauteur de la vraie vertu est en la facilité, utilité et plaisir de son exercice, si éloigné de difficultés que les enfants y peuvent comme les hommes, les simples comme les subtils. » La philo n’est pas réservée aux profs ni à l’université, mais ouverte à tous dès le berceau, qu’on se le dise !
Car la vertu n’a rien à voir avec la pruderie offensée ni le sérieux angoissé des croyants en religions, celle du Livre mais aussi les communistes et socialistes. La vertu au contraire « aime la vie, elle aime la beauté, la gloire et la santé. Mais son office propre et particulier, c’est savoir user de ces biens-là réglement (modérément), et les savoirs perdre avec constance. »
L’éducation s’effectue par une sévère douceur, pas par la force ni par le châtiment. S’il faut endurcir l’enfant, c’est au froid, au soleil, au vent, au hasard du climat et de la nature, pas à la honte ni au fouet. « Que ce ne soit pas un beau garçon et dameret (affecté comme une femme), mais un garçon vert et vigoureux ». Nous pouvons le dire aujourd’hui autant des filles, qu’elles soient moins apprêtées que directes, saines et sportives. Le collège, où Montaigne fut de 6 à 13 ans, « c’est une vraie geôle de jeunesse captive ». La situation n’a que très peu changé de nos jours ou la contrainte règne. Surtout au lycée où l’on a pourtant passé 15 ans.
Il n’y a, selon Montaigne, qu’une règle en éducation : « pourvu qu’on puisse tenir l’appétit et la volonté sous boucle, qu’on rende hardiment un jeune homme commode à toute nation et compagnie, voire au dérèglement et aux accès, si besoin est (…), qu’il puisse faire toutes choses, et n’aime à faire que les bonnes. » C’est que l’exemple qu’on lui a donné aura été bon et qu’il sait juger par lui-même des écarts de ses pairs.
Car à la fin, « le vrai miroir de nos discours est le cours de nos vies ». Quoi qu’on pense, seul l’exemple qu’on donne est le vrai de notre personnalité. « Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu’à la bouche, un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque ». Nous dirions authentique. Il ne faut parler ou écrire ni en prof, ni en prêcheur, ni en avocat, « mais plutôt soldatesque » sur l’exemple du style de César.
Quant à apprendre les langues, mieux vaut s’y frotter tout petit qu’au collège. Chacun sait bien qu’après six ans d’anglais on ne le parle que très mal si l’on n’est pas allé dans le pays. À quoi servent donc le collège et le lycée ? Une formation de trois mois dans le bain suffirait à parler correctement, les entreprises le savent bien, pas les cuistres « inspecteurs » de l’éducation. Montaigne donne l’exemple de son père qui engagea un professeur ne lui parlant que latin. Il se reconnaît pourtant l’esprit lent, le corps paresseux, l’absence de mémoire, mais « ce que je voyais, je le voyais bien », ce qui signifie avec attention et sans illusion. Son premier livre fut les Métamorphoses d’Ovide. Au collège, il tint des rôles de théâtre qui lui ont donné « une assurance de visage, et souplesse de voix et de gestes ». Ce que les formations professionnelles aujourd’hui doivent apprendre à l’âge adulte parce que le secondaire ne se focalise que sur l’intellect. Le savoir-faire est déjà tangent, le savoir-être inexistant.
Montaigne nous a brossé l’homme complet de la Renaissance, telle qu’issu des philosophes antiques. Il s’agit d’une éducation naturelle vécue plus que de principes abstraits. L’homme est en effet un être d’imitation car très social, et la sociabilité compte avant tout pour lui faire apprendre quoi que ce soit. Les devoirs à la maison sont tout aussi inutiles que le bourrage de crâne, seuls les exemples humains et les exercices permettent de véritablement connaître. Ce que dit Montaigne il y a cinq siècles est applicable encore aujourd’hui car l’être humain ne change pas, malgré l’évolution des circonstances.
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog
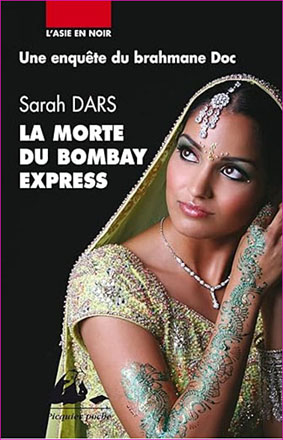




Commentaires récents