Nous quittons l’hôtel à pied, sac sur le dos, dans les embouteillages de 7 h. Nous longeons les bus fumants, les collégiens et collégiennes en bande, les mémères surchargées de paquets, le tout dans d’étouffants et âcres nuages de mauvais diesel. Nous prenons le train, heureusement que nous sommes arrivés en avance, nous l’aurions raté. Dans les wagons, un vendeur passe avec une grosse thermos et des gobelets de plastiques pour proposer du thé. Nous descendons station Idalgashina.
Nous sommes à 1570 m mais dans la brume et… il commence à pleuvoir ! Mais il y a du vent et le temps se lève vite, laissant inaugurer une belle journée pas trop chaude. La randonnée est une promenade dans les jardins de thé en pente d’un domaine étiqueté « bio ». Nous croisons un homme qui travaille à la houe entre deux rangées de théier, sur une pente à 75%, des gamins et gamines hilares en ce jour sans école pour cause de fête bouddhiste. Il est vrai que nous avons rencontré les fêtards dès après la gare ; il y avait des fleurs et des pétards et ceux qui donnaient une pièce à Ganesh ont eu droit à un tika rouge entre les deux yeux. Avec la chaleur et la transpiration, le point a coulé sur les visages occidentaux, finissant par faire mauvais effet. Les gamins réclament photos et pen, mais juste pour le plaisir. Des cueilleuses de thé sont en pause sous un auvent où la récolte de feuilles fraîches du matin est soigneusement pesée. Elles doivent cueillir le bourgeon et les quatre feuilles autour, pas plus ; les autres feuilles donnent un thé de mauvaise qualité.
Nous pique-niquons vers 11h du matin seulement, car la promenade se termine à la route… Ce n’est pas très organisé. La boite en carton contient deux beignets gras de légumes et poulet haché épicés, un chausson de légumes, une banane et une part d’un gâteau genre génoise.
Nous reprenons le chemin vers le bas. Nous pouvons voir de près des cueilleuses de thé en pleine action, sous la surveillance de leur contremaître.
Elles aussi adorent se faire prendre en photo, et le contremaître prend lui-même en photo les étrangers photographiant, sur son téléphone mobile (roue du Dharma ?).
La main droite attrape le bourgeon et les quatre feuilles tendres terminales, une fois, deux fois, trois fois. Puis la poignée de feuilles passe dans la main gauche. Quand elle est pleine, un geste la jette dans la hotte ouverte portée sur le dos, un grand sac plastique renforcé porté sur la tête et les épaules. Deux chiens agressifs nous montrent les crocs en grognant pour nous empêcher de monter vers les cueilleuses, mais elles les chassent. Le théier est reproduit surtout par marcottage. Ce serait trop long de faire pousser les graines, et trop hasardeux de constater le résultat. Le marcottage permet de cloner l’arbre existant : il suffit d’attacher à une branche un sac de terre et d’attendre quelques semaines que des racines apparaissent ; couper la branche et la planter.
Un escalier descendant ne tarde pas à nous mener sur la route, à l’entrée d’un hôtel où une gargouille en béton pour les eaux pluviales joue les horreurs. C’est une gueule de dragon pleine de dents et le plaisir gamin des trentenaires est de se faire prendre en photo entre les crocs. Certains avouent quand même qu’ils n’aiment pas ça, même si la bête est une chose en béton.
Sur la route, nous pouvons observer le transport en gerbes du riz moissonné dans les champs, son battage au fléau à main sur une aire, puis sa mise en sacs jusqu’à la route, où il est étalé sur le macadam pour sécher. Je donne mon gâteau de pique-nique à un gamin qui nous observe de ses grands yeux sombres.
A Belihuloya nous attend l’hôtel Water Garden, où nous arrivons vers 13h15. Il fait chaud et lourd, le soleil apparaît par intermittence, entre deux pluies fines. Il n’y a rien à voir dans le village, composé de boutiques le long du virage de la route et de quelques maisons un peu à l’écart dans les champs. Ceux qui sont partis explorer reviennent une vingtaine de minutes plus tard, bredouilles. Il y a quand même un sub-office postal où poster ses cartes, à condition d’avoir eu le temps d’en écrire.
Avant le dîner, le groupe est convié dans la cuisine de l’hôtel où Madame nous montre comment préparer un curry à sa façon. Deux légumes sont choisis : les lentilles jaunes et les haricots verts. Aux épices, la cuisinière ajoute de petits piments verts (une poignée), quelques gousses d’ail écrasées, cinq oignons hachés, deux bâtons de cannelle effrités, des feuilles de curry (presque impossibles à trouver chez nous), du lait de coco obtenu avec de la noix râpée infusée à l’eau chaude, malaxée et filtrée. Une fois tout cela en train de mijoter, on ajoute les épices sèches : cumin, curcuma, fenugrec (on peut le remplacer par du sel de céleri, le goût est proche), clous de girofle, gingembre, anis, du sel et du piment en poudre selon la force désirée. Les légumes doivent être cuits à suffisance, très peu, type nouvelle cuisine pour les habitudes d’ici, un peu plus chez nous. Nous voilà déguisés en chefs avec toque en carton et tablier montant ; nous aidons à éplucher, écraser et touiller, mais prenons surtout des photos. Cette « leçon » est le « plus marketing » de l’hôtel.
Le patron nous apprend ensuite à jouer à une sorte de billard carré sur table, où il faut pousser d’une pichenette un jeton pour jeter un autre de sa couleur dans l’un des trous aux quatre coins. Cela passe un moment, par roulement. Nous dînons ensuite de nos préparations, plus quelques autres réalisées directement par la cuisinière. Peu de viande, surtout du poulet, parfois du porc. Nous avons bien vu des vaches broutantes et des chèvres libres dans les plantations de thé, mais elles sont surtout destinées à fournir du lait. Il n’est pas de tradition de manger de la viande.










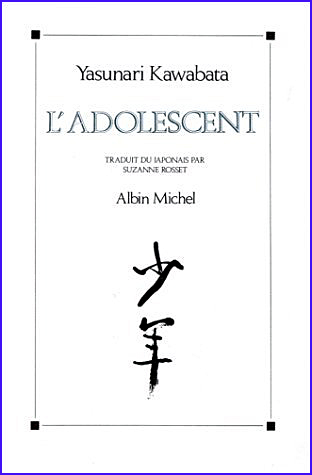


Commentaires récents