Le président Macron est en Chine. Comment comprendre le capitalisme particulier de ce pays ?
Qu’est-ce donc que « le capitalisme » ?
De façon descriptive, il s’agit d’une technique d’efficacité économique à user des ressources rares pour produire au moindre coût. Cette efficacité engendre du profit, qui peut être réparti sur l’investissement, les salaires, la rémunération du capital, ou mis en réserve. C’est cette « répartition » qui est un acte politique – donc soumis à idéologie. Elle peut être coopérative, sociale, étatiste, clanique ou libérale. Les coopératives ouvrières partagent les gains après répartition décidée par tous ; l’entreprise sociale n’a pas de « but lucratif » mais redistribue à ses clients, ses fournisseurs et ses salariés les surplus ; l’entreprise d’Etat abonde le budget du pays en contrepartie de la présence de fonctionnaires pour administrer l’entreprises et de décisions politiques pour investir ; l’entreprise clanique assure la richesse à une famille ou à un clan, ne se préoccupant que de la rentabilité ; l’entreprise libérale se soumet à la loi de l’offre et de la demande tant pour vendre ses produits que pour acheter aux fournisseurs, rémunérer ses actionnaires et payer ses salariés – le pouvoir est en ce cas un rapport de négociations successives avec les uns et les autres.
La comptabilité en partie double, les méthodes de marketing, les innovations technologiques, l’organisation fordiste de la production, les sociétés juridiquement à responsabilité limitée, le commerce au loin, sont des techniques du capitalisme. Elles évoluent, se transforment, s’adaptent depuis le XVe siècle. Le cœur de l’économique réside en cette efficacité recherchée à chaque instant, de la production à l’échange, efficacité dont « le profit » est le résultat final (et pas le but en soi) – en même temps qu’il y a goût du risque (marchands aventuriers, inventions mises sur le marché, prospection de nouveaux clients, innovations). Ce risque, apporté par les détenteurs de capitaux qui le prêtent à l’entreprise (obligations) ou prennent une part (actions) doit être rémunéré – sinon personne ne prêterait et « l’Etat » (on l’a vu avec M. Haberer, énarque au Crédit lyonnais nationalisé) est un piètre gestionnaire ! Cette technique double peut être adaptée différemment, suivant les pays et les sociétés qui l’utilisent.
Le capitalisme en Chine
Il fut d’abord d’Etat avant d’être livré aux clans (comme dans la Russie post-soviétique mais sous le contrôle du Parti communiste au pouvoir). Le deal est le suivant : faites des affaires mais ne remettez jamais en cause le pouvoir ; quiconque le remet en cause de quelque façon se voit accusé de « corruption » et mis en prison. L’entrepreneur individualiste, le self-made-man à l’américaine, n’existe pas en Chine. Selon la tradition, ce sont des familles entières qui sont actionnaires et les réseaux de relations personnelles (y compris avec les fonctionnaires d’Etat et les influents du Parti) qui sont au cœur des affaires. D’où ces relations paternalistes à l’intérieur des entreprises, ce sens des responsabilités sociales comme il existait dans l’ancien capitalisme familial français ou allemand au début du XXe siècle – mais aussi ce que les protestants puritains anglo-saxons appellent « la corruption », qui est là-bas un échange de bons procédés. La « vertu » des entrepreneurs chinois est à la fois sociale (le réseau, d’où « la corruption ») et morale (le confucianisme). On peut la mettre en parallèle avec ce qui animait les maîtres de forges européens : le statut social et le christianisme.
L’usage social de l’outil capitalisme n’est pas né en Chine d’une parole d’Etat. Deng Xiaoping a certes débloqué la situation en 1978 et tiré un trait sur le volontarisme brouillon des maos. Car le Grand Bond en avant fut un grand bond en arrière qui fit périr de faim des millions de Chinois et nul ne veut plus le voir revenir. La mégalomanie d’Etat ignore l’économie et ses lois toutes simples qui permettent de produire, d’échanger et d’élever le niveau de vie. Pour conserver le pouvoir après l’extinction de Mao, le Parti n’avait d’autres ressources qu’une perestroïka contrôlée. Elle fut conduite en douceur et dans le temps, aboutissant à l’essor que l’on observe depuis trois décennies.
Mais la Chine ne part pas de rien.
Son histoire illustre combien la société chinoise a depuis longtemps su marier la bonne économie à la bonne politique. Au moyen-âge, la production agricole et les réalisations des artisans spécialisés étaient largement diffusées dans l’empire par une classe marchande pleine d’initiatives. Le forçage anglais des ports par le traité de Nankin oblige au XIXe siècle l’empire immobile à bouger. L’ouverture commerciale à la concurrence de l’Occident montre aux Chinois le retard qu’ils prennent sur la révolution industrielle. L’équipement passe par la puissance publique, comme souvent dans les phases de décollage. C’est l’armement qui intéresse les fonctionnaires des provinces côtières. Qui dit armement dit acier et qui dit acier dit charbon – et c’est ainsi que commencent les infrastructures et la production industrielle. Se développent alors l’armement, les bateaux à vapeur, le textile, le téléphone.
La fin du XIXe voit la création d’entreprises mixtes dont le financement est à capitaux privés, la gestion par des marchands issus des ports ouverts, et le contrôle celui des fonctionnaires locaux. Le début du XXe siècle verra l’Etat central codifier et réguler le commerce. Le capitalisme n’est pas une importation d’Occident – c’est confondre la technique d’efficacité économique (le capitalisme) avec l’idéologie libérale (le laisser-faire). Les pratiques traditionnelles chinoises ne sont pas balayées et remplacées, elles amalgament les techniques nouvelles venues d’ailleurs à leur culture, habitudes et mentalité. Tout comme l’a fait le Japon à l’ère Meiji et la Corée du sud dans les années 1960. C’est bien la preuve que « la mondialisation » n’est une américanisation du monde que dans les fantasmes politiciens. La globalisation est l’ouverture des marchés à l’ensemble de la planète mais « le capitalisme » n’est pas un néo-colonialisme occidental. Si des pays aussi divers que la Chine, le Japon et la Corée ont su adapter la technique capitaliste à leur culture proprement originale – sans perdre leur âme comme on le voit tous les jours – c’est bien la preuve qu’il est sot d’amalgamer capitalisme, libéralisme et américanisation. Le propre de l’analyse est de distinguer pour comprendre. La science économique n’a rien à voir avec la croyance idéologique.
Au début du pouvoir communiste, les structures économiques familiales et claniques, mêlées de privé et d’Etat, sont conservées. Les propriétaires ne sont expropriés que pour moitié et restent actionnaires à dividendes en parallèle avec l’Etat, tout en poursuivant leur gestion. Il n’y a pas de nationalisation « idéologique » mais une inflexion en douceur qui permet à la production de continuer au profit du collectif et à la distribution d’assurer « le bol de riz » aux masses. Au nom du redressement national, les ouvriers sont même incités par l’Etat à travailler plus en gagnant moins, tout comme dans la conception organique de Vichy. La réaction « antidroitière » qui suit les Cent Fleurs de 1957 fait disparaître le secteur privé – mais pas physiquement les entrepreneurs (au contraire des propriétaires terriens). Ce qui permettra le redressement économique dès la mort de Mao. C’est ce que n’a pas su faire la Russie ex-soviétique qui a envoyé tous les spécialistes en camp de « rééducation ».
La conception « communiste » du capitalisme à la chinoise
Les officiels chinois parlent d’« entrepreneurs patriotes » (comme Bismarck) et de « socialisme de marché » (comme jadis certains socialistes français). Ce n’est pas le niveau de vie qui est mis en avant (conception individualiste hédoniste) mais la grandeur de la nation (conception collective souverainiste). Toutes les grandes entreprises ont des liens familiaux et de réseaux, et naturellement avec le pouvoir local et central. Nombre d’entrepreneurs sont membres du Parti communiste. Nul ne peut se passer des autorités pour obtenir les autorisations nécessaires à la production (trouver un terrain, bâtir, obtenir des crédits, entrer en bourse) – ou la protection contre d’éventuelles sanctions (tout le monde fraude parce que la bureaucratie est comme partout rigide et lente).
Dès lors, s’ouvre la voie royale des Quatre modernisations (agriculture, industrie, défense, science et technologie), qui passe par l’ouverture aux échanges mondiaux avec l’adhésion chinoise à l’OMC, puis la reconnaissance internationale par les Jeux Olympiques de 2008.
L’économie de commande disparaît par étapes pour l’économie de marché :
- 1979, décollectivisation de l’agriculture ;
- 1979, création de zones économiques spéciales pour attirer les capitaux étrangers ;
- 1984, autorisation des petites entreprises privées de services urbains (réparateurs de vélos, de chaussures, marchands de beignets, coiffeurs…) ;
- 1990, création de la bourse de Shanghai, 1991 création de la bourse de Shenzhen ;
- 1992, fin de la planification, transformation des sociétés d’Etat en sociétés par actions, réforme de la fiscalité ;
- 1995, restructuration du système bancaire qui rend l’autonomie de gestion aux banques ;
- 2004, reconnaissance de la propriété privée.
Restent les problèmes collectifs, dont l’Etat a pour rôle de se préoccuper :
- Les filets sociaux de toute société industrielle (santé, droit du travail, chômage, retraite)
- La protection de l’environnement et la répartition des infrastructures (routes, chemin de fer, aéroports, barrages, centrales)
- La lutte contre les excès de la corruption locale qui menace la cohésion sociale, donc le pouvoir du Parti.
- Une relative libéralisation des mœurs, du savoir, de l’Internet des réseaux (à monopole national), donc de l’opinion…
- Mais aussi la place de la Chine dans le monde, à commencer par la mer de Chine (donc renforcement de l’armée, occupation d’îlots, prospection pétrolière, chemin de fer jusqu’en Europe, nouvelle « route de la soie »).
Les Chinois réclament moins « la démocratie » que le « bon gouvernement ». Tant que le parti « communiste » assure un bien-être croissant (ce pourquoi le taux de croissance est scruté avec attention, et probablement « piloté » politiquement), même au prix de restrictions de libertés, d’une morale inquisitrice et d’un autoritarisme d’Etat venu du centre à Pékin, le système politique n’est pas vraiment contesté. L’élection du bouffon Trump montre combien « la démocratie » à l’occidentale peut être ridicule et déstabilisatrice, voire dangereuse pour un pays. En revanche, la technique d’efficacité du capitalisme apparaît (depuis 30 ans) comme le meilleur instrument pour produire, vendre et augmenter le niveau de vie. Car « les masses » ne se nourrissent pas longtemps de slogans…





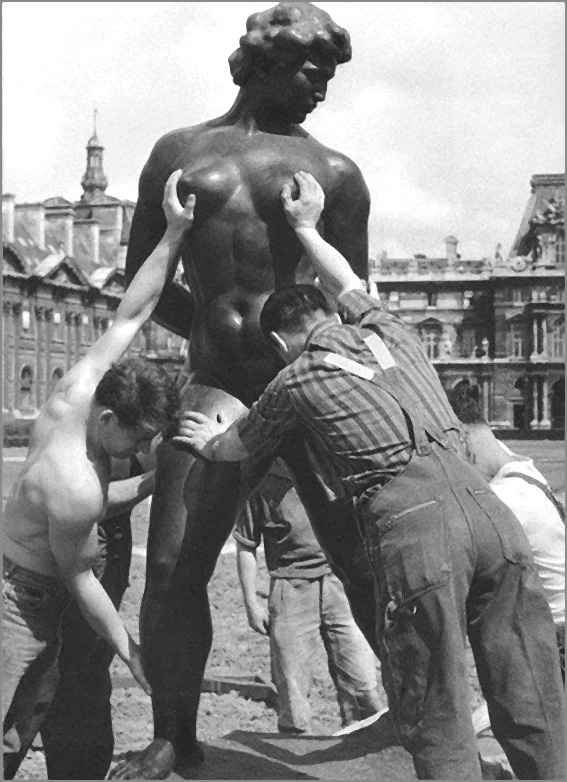
Commentaires récents