Un homme, une femme, c’est l’éternelle histoire que George Sand ne se lasse pas de conter. Elle se passe cette fois durant la Révolution française, avec les bouleversements cataclysmiques qu’elle induit dans la société et les familles. Une vieille femme raconte ses Mémoires de paysanne devenue riche et ayant fait un mariage noble, sans le vouloir, poussée par les circonstances et par cet élan de vie qui réside en chaque être moral. George Sand adore la morale et tous ses romans sont édifiants – ce pourquoi ils ont tant vieilli.
Mais le lecteur se laisse emporter par l’histoire, un brin longuette pour notre époque moins verbeuse et plus directe, mais qui se laisse lire dans les périodes où nous avons du temps. Nanette de son vrai prénom, à 9 ans est déjà bonne ménagère au foyer de son grand-père veuf qui a recueillis deux autres petits-fils. Pour encourager la fillette et espérer un peu d’aisance, le vieux achète une brebis, Rosette, qu’il confie à Nanon. Mais la sécheresse vide les prairies de son herbe et ce n’est que proche de l’eau qu’elle pousse encore. Sauf que c’est la terre des moines du lieu et que Nanon n’ose. Jusqu’à ce qu’un novice de 15 ans, qui la voit toute seulette, l’encourage à venir paître. Emilien est le cadet de la lignée du marquis de Franqueville et est destiné aux ordres pour ne point que l’héritage soit partagé. Il a donc été élevé à la va comme je te pousse, sans instruction puisqu’il n’en avait pas besoin, sans amour car on ne s’attache pas à un gosse voué à Dieu par tradition.
Les deux vont se lier l’un à l’autre, la Révolution va vider les monastères et faire jurer les prêtres, le moutier sera vendu comme bien national. Emilien qui sait à peine lire faute d’intérêt pour les livres, apprend à Nanon l’analphabète qui désire le savoir. L’un épaulant l’autre, ils se forment et deviennent adultes, très chastes selon la théorie de Rousseau que George Sand reprend chaque fois qu’elle peut. Pas sûr que ce soit très réaliste, mais c’est en tout cas édifiant et moral !
Nanon naît en 1775 mais ses Mémoires ne sont détaillées qu’entre 1787 et 1795, avec un épilogue bref en 1864. Dans la Marche, les premiers mois de la Révolution sont marqués par la Grande peur des brigands et autres étrangers, réputés venir en bande piller, violer et massacrer hommes, femmes et enfants en vrai Boko haram haineux des livres, des statues et des châteaux ou maisons fortes. La suite sera terrible et la Terreur jacobine fera monter de petits coqs revanchards qui dénonceront et feront guillotiner sur la foi de faux témoignages tous ceux qui ne leur plaisent pas. « Ils sont cruels sans en avoir conscience, dit Emilien des Jacobins qu’il comprend pourtant, et ils emploient un ramassis de bêtes féroces qui renchérissent sur leur dureté pour le plaisir de faire le mal, ou pour la sottise d’être quelque chose, pour l’ivresse de commander » p.1110 Pléiade. Les périodes de troubles font immanquablement surgir les racailles, qui viennent au premier plan par absence de tout scrupule, ce pourquoi il est extrêmement dangereux de prêter aux dérapages. Les manifs et autres marches le prouvent encore tous les jours dans notre société qui se croit pourtant « civilisée ».
Emilien est sincèrement convaincu par les idées généreuses de 1789 et veut s’engager pour défendre la patrie. Mais il est dénoncé comme réfractaire avant même de savoir comment s’y prendre et emprisonné à Châteauroux. Nanon n’aura de cesse de le faire libérer, par évasion au pire, soutenue par quelques amis. Le couple d’enfants sages vivra en cultivant leur jardin et élevant leurs chèvres quelques mois dans le « désert » de Crevant au sud de La Châtre, dans une ancienne carrière aux pierres « druidiques » (des dolmens datant en fait de bien avant). Une vraie vie de robinson avant que la Terreur ne s’apaise et que Robespierre finisse par où il a péché : la tête tranchée. Emilien peut donc partir aux armées, où il deviendra capitaine et donnera un bras, tandis que Nanon remet en état le moutier, acheté comme Bien national par l’avocat Casteljoux qui lui en confie la gérance. Elle le rachètera avec les capitaux du prieur qui s’est pris d’affection pour elle et en a fait son héritière. C’est donc comme propriétaire méritante qu’elle peut épouser son Emilien devenu marquis par la mort de son père et de son frère aîné.
Je résume le conte édifiant : ils se marièrent furent heureux et eurent cinq enfants. Tout le reste est littérature… La morale est que la Révolution a permis aux simples paysans de s’élever socialement en accédant au savoir et au pouvoir, tandis que les nobles inutiles ont pu apprendre un métier utile et se marier selon leur inclination et pas par tradition. L’énergie est également partagée et chacun peut s’il le veut : la Révolution l’a permis. La liberté est à ce prix, bien loin des ancrages sociaux d’Ancien régime. Nanon la gardeuse de brebis apprend à vivre au cadet de noblesse Emilien et ce dernier lui apprend à lire, à écrire et à compter. Tous deux sont fraternels et solidaires de leur famille et du village, malgré les malheurs, les haines et le dédain.
La grande histoire vue par le petit bout de la lorgnette a une saveur d’authentique plus forte que celle des manuels. La cause du peuple est déviée par celle des idéologues et la Révolution en périra. Les Jacobins en ont été les fossoyeurs, mais pas seulement : « Ne songeons qu’à la guerre tonnait Danton (…) ‘Que toutes affaires soient interrompues !’ – Danton pouvait dire cela aux Parisiens. Les indigents y étaient nourris aux frais de la ville, on les payait même pour former un auditoire aux assemblées des sections. Mais le paysan ! pour lui, les affaires interrompues, c’était la terre à l’abandon, le bétail mort et les enfants sans pain ! Voilà ce que les gens des villes ne se disaient pas, et ils s’étonnaient naïvement que le peuple des campagnes fût irrité ou découragé » p.1149. Cette faille entre élite parisiano-centrée et peuple des provinces n’a guère changé. Les paysans ne sont « conservateurs » que parce qu’ils se méfient des grandes idées et préfèrent les actes concrets. Mais ils n’en sont pas moins partisans de la liberté, de l’égalité et de la fraternité que les communards urbains qui se croient le sel de la France parce qu’habitant la capitale. Ils en deviennent même « Français » par patriotisme contre les émigrés de Coblence et les étrangers monarchistes.
George Sand, Nanon, 1872, Independant publishing 2019, 209 pages, €7.51
George Sand, Romans tome 2 (Lucrezia Floriani, Le château des désertes, Les maîtres sonneurs, Elle et lui, La ville noire, Laura, Nanon), Gallimard Pléiade, 1520 pages, €68.00
Les romans de George Sand chroniqués sur ce blog

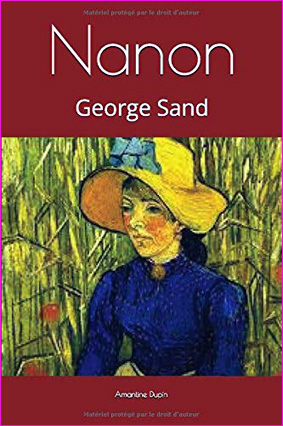


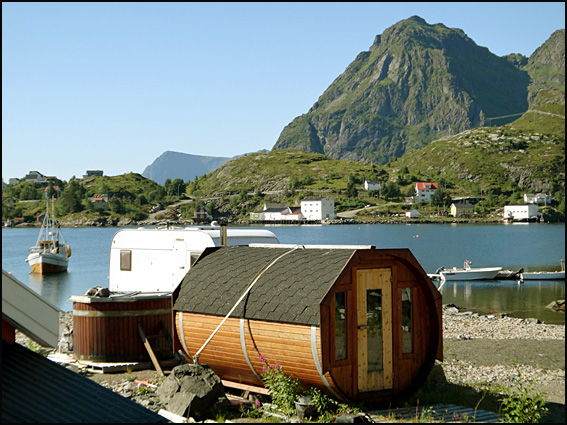





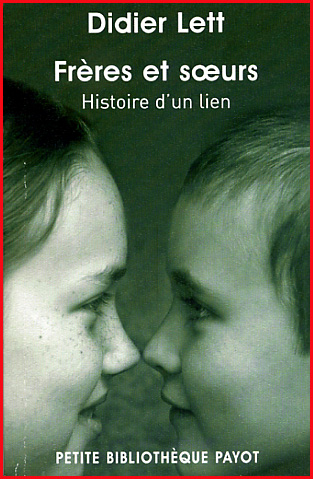

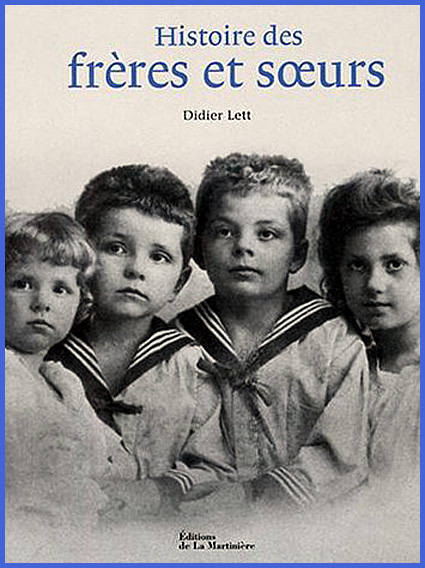
Commentaires récents