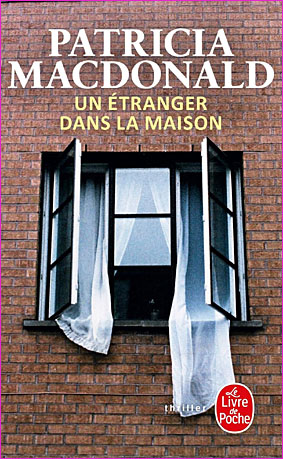
Dans une maison chic de Stanwich, dans le comté de Fairmont près de New York, Paul, un beau bébé blond de 4 ans, disparaît au bout du jardin. Il a vu un petit chat. Sa mère l’a rattrapé, mis en garde, a fermé le loquet du jardin mais, lorsqu’elle est partie s’occuper de Tracy, son bébé malade, le petit Paul est obstinément retourné au jardin. Puis il a disparu. Le loquet était mal fixé. Drame habituel des parents qui ne font pas attention.
Anna, sa mère, est effondrée. Elle l’a cherché, elle ne l’a pas retrouvé. La police est bienveillante, en la personne de l’inspecteur Mario Ferraro, mais n’a guère enquêté ; elle aurait retrouvé sinon le béret Popeye du gamin dans un fossé de l’autoroute qui passe à proximité – détail indiqué dès la fin du premier chapitre…
Onze ans plus tard, coup de téléphone de la police : Paul est retrouvé ! Il a désormais 15 ans et a été élevé par le couple Rambo, qui l’a enlevé à 4 ans. Elle était infirmière et, à l’article de la mort, a avoué. Ils l’ont appelé Billy durant toutes ces années. Paul est ramené chez ses parents biologiques, ce n’est plus un beau blond mais un adolescent maigre et mal dans sa peau, mal vêtu et inadapté. Il devient un étranger dans la maison.
Sa sœur Tracy, d’environ deux ans plus jeune, est en pleine rébellion de sensibilité adolescente et un brin jalouse du retour du fils prodigue. Thomas, le père bien musclé, avait fait son deuil du fils et a du mal à se faire à son retour inopiné ; il tente timidement une approche en lui achetant une nouvelle veste. Seule Anna, en névrosée obsessionnelle durant toutes ces années, se met en quatre pour accueillir le rescapé. Elle le surcouve, s’inquiète sans cesse pour lui, angoissée perpétuelle. Paul sent qu’il est peu désiré dans la famille, agacé par les attentions fusionnelles de la femme qui n’est pas pour lui sa mère, et reste méfiant. Thomas n’en peut plus et s’éloigne ; il ne peut plus vivre ainsi avec une épouse qui ne pense encore et toujours qu’à Paul, et Paul seulement.
Mais l’intrigue résiste dans le secret de sa disparition. L’adolescent fait sans cesse le même cauchemar où il est allongé sur un sol froid tandis que surgit un aigle toutes ailes déployées et qu’une ombre gigantesque se penche sur lui pour faire mal. Il fait une fausse route avec un morceau de viande, s’évanouit devant les copines moqueuses de Tracy, se réveille en sursaut la nuit pour aller se recroqueviller dans un coin. Et Rambo, son père adoptif, psychologiquement instable et habité par les voix de la Bible, rôde dans les parages. Il ne veut pas reprendre Billy-Paul, non, mais il a tout vu de sa disparition à l’âge de 4 ans. La police le recherche, il n’a plus guère d’argent, et compte sur le chantage pour se renflouer et partir. Las ! Rien ne se passe comme prévu. Paul, que sa mère a amené à l’aéroport pour saluer son mari parti pour Boston, ne le retrouve pas dans la voiture où elle l’a laissée. A 15 ans, Paul a de nouveau disparu !
Est-ce une fugue de mal aimé, ou un nouvel enlèvement ? Mais par qui ? Pourquoi ? Les voisins Stewart sont obligeants, mais leur couple va mal lui aussi. Iris, l’épouse qui prend du poids, est méprisée par le beau Edward son mari, qui l’a épousée pour ses relations de fille de sénateur et lancer sa carrière. Lui a acquis tous les signes de la réussite, une belle demeure dans le Fairmont, une Cadillac où il a fait monter un aigle doré sur la calandre, des maquettes de bateau qu’il assemble méticuleusement dans le moulin au fond du jardin. Iris veut le quitter et part « en cure » pour maigrir. Edward en profite pour tenter de régler le problème qui le préoccupe de plus en plus depuis que Paul a été retrouvé. La tension monte…
Un bon cru MacDonald, en ces années où les gadgets techniques (smartphone, internet, caméras de surveillance, police scientifique) n’ont pas encore envahi les romans policiers, au détriment des ressorts de l’intrigue et de la psychologie. Un enlèvement d’enfant, les obsessions d’une mère, comment se sentir père, les secrets d’une ambition – tels sont les thèmes remués dans ce roman captivant.
Patricia MacDonald, Un étranger dans la maison (Stranger in the House), 1983, Livre de poche 1988, 253 pages, €8,40, e-book Kindle €9,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans policiers de Patricia MacDonald déjà chroniqués sur ce blog


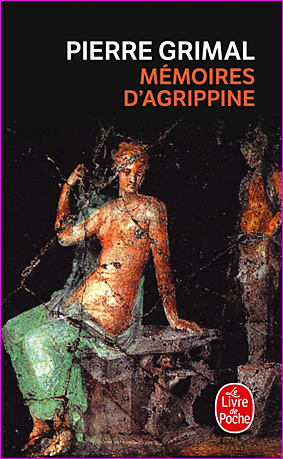


Commentaires récents