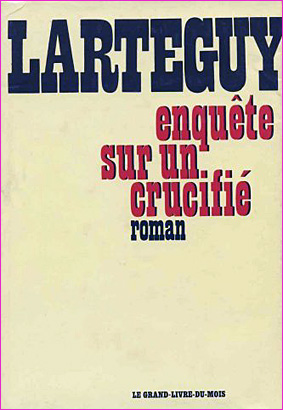
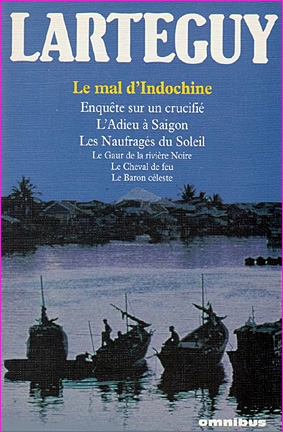
Notre époque a oublié la précédente, pourtant fertile en bouleversements du monde. La Seconde guerre mondiale et la Résistance, la décolonisation, les combats contre le communisme en Asie, contre les révolutions en Amérique latine, le journalisme d’investigation. Lucien Osty dit Jean Lartéguy, neveu du chanoine Osty qui traduisit la Bible qu’on lit encore, a vécu tout ce siècle. Né en 1920, il a été militaire, évadé, capitaine décoré, correspondant de guerre, écrivain, papa de deux filles. Il a écrit des récits, mais aussi des romans à propos de ce qu’il a vécu.
Enquête sur un crucifié évoque le Vietnam en 1970, envahi par une armée américaine de drogués et de hippies qui se reposait sur la grosse technologie du bombardement à haute altitude. Des guerriers, les Yankees ? De pauvres loques, manipulées par l’idéologie à la mode dans les campus, et par des stratèges en chambre au Pentagone. Où s’est-elle enlisée, la Mission de sauver le monde de la dictature froide des nouveaux curés rouges ? Dans l’héroïne, les putes à quelques piastres et les gamins orphelins qui se vendent avec plaisir pour survivre… L’époque de libération sexuelle semble littéralement obsédée par baiser les très jeunes ; l’auteur le relate, un brin dégoûté. Il faudra attendre quarante ans pour que cela devienne un délit moral et un crime puni par la loi.
L’auteur met en scène trois « jeunes hommes déboussolés qui se jettent dans les guerres en les haïssant, dans les dangers en les redoutant. Et, un jour, meurent où disparaissent sans que personne, même pas eux, ait connu les raisons qui les avaient poussés à se conduire de la sorte. » C’est le Christ, Ron Clark, flanqué de ses deux larrons, le drogué Jockey et le mercenaire Max. A trente ans, ils seront tous les trois exécutés par les Vietcongs, au Cambodge, dans l’affolement d’une retraite précipitée sous la poussée sud-vietnamienne.
Le juriste banquier neutre Hans Julien Brücker, est chargé par sa banque suisse de prouver que Ron est mort ou vivant. Il a pour le moment simplement « disparu » comme journaliste cameraman de la CBS, avec ses deux compagnons. Sa femme Andrea, comtessa italienne de pacotille, qui adore baiser avec n’importe qui et si possible avec deux éphèbes à la fois, voudrait bien qu’il soit déclaré mort pour toucher le pactole de sa fortune, alors qu’ils étaient en instance de divorce. Mais Ron n’a rien signé et la banque suisse, qui tient à garder les millions dans ses coffres, fait tout pour rechercher une preuve qu’il est encore vivant. Brücker est envoyé à la recherche d’une preuve.
C’est une véritable enquête de personnalité, qui le conduit tout d’abord aux États-Unis pour y rencontrer le père de Ron, un acteur américain célèbre, Edwin Clark, le double d’Errol Flynn dont l’auteur s’est inspiré (le Fletcher Christian du film Bounty de Charles Chauvel en 1933). Errol Flynn, comme Edwin Clark, était un homme à femmes, surtout mineures, à fêtes et à cuites. Pour les 18 ans de son fils Ron, Edwin Clark lui offre une pute de 15 ans sur un plateau, s’attendant à ce qu’il la prenne sur le champ, devant tous, comme c’était l’usage. A peine sorti de son collège suisse, l’adolescent est écœuré, mais June s’accroche à lui et le dissuade de mettre fin à ses jours. Ron a une demi-sœur, Sabrina, tout aussi paumée que lui, qui le recueille à Londres. Il va la quitter lorsqu’il rencontrera Andrea, trop belle pour lui, qui s’attachera comme une sangsue, profitant des dollars pour assouvir ses passions comme celle de son frère pédé et de son ami, fort amateur de petits garçons de Madère. Les années soixante avaient tellement désorienté les Yankees qu’ils avaient jeté toute morale et tout simple bon sens aux orties, contaminant le reste du monde occidental de leur argent et de leur tout-est-permis. Ron, élevé en Europe selon des principes calvinistes, en est révulsé.
Il n’aura de cesse de se plonger dans les aventures les plus extrêmes pour se prouver que l’argent qu’il a ne fait pas tout, qu’il existe en tant qu’homme, et qu’il peut témoigner des horreurs de la guerre. Les massacres à la bombe, mais aussi les trahisons, la drogue, les trafics, la prostitution. Cette mission personnelle lui sera fatale, lui qui rêvait, comme le Christ, de changer le monde. L’auteur se délecte à calquer la vie de Ron sur celle de Jésus, avec son faux père Erwin, June en Marie-Madeleine, Sabrina en sœur de Lazare, et les deux larrons. Manquent cependant son saint Jean et ses disciples.
Dans ce monde des années soixante où tous trichent et trahissent, où les religions et la morale ont disparu dans les petits intérêts commerciaux et doctrinaux, la vertu personnelle est la seule qui vaille. De même que Ron, le fils d’Edwin Clarck, Sean, le fils d’Errol Flynn, a lui aussi été porté disparu le 6 avril 1970, capturé par l’Armée populaire vietnamienne alors qu’il circulait sur les pistes du Cambodge en moto Honda. Et exécuté sans délai ; on relate aussi deux prêtres crucifiés comme leur Christ par les athées adeptes du petit Livre rouge.
Un beau roman d’aventure sous couvert d’une enquête quasi policière, qui fait se ressouvenir de cette époque tragique du jeu des puissances et de la tectonique des plaques idéologiques, au moment où un noveau mouvement des plaques se propage. Un livre introuvable sauf en recueil Omnibus, mais qui replace la grande histoire dans les esprits humains.
Jean Lartéguy, Enquête sur un crucifié, 1973, Flammarion, 507 pages, occasion €3,99
Jean Lartéguy, Le mal d’Indochine : Enquête sur un crucifié, L’adieu à Saïgon, Les naufragés du soleil, Le Gaur de la Rivière noire, Le cheval de feu, Le baron céleste, Omnibus 1976, €10,74
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)



Commentaires récents