Le chapitre XXXIX des Essais, livre 1, s’intitule De la solitude. Montaigne s’insurge contre l’opinion communément partagée que nous sommes nés pour les autres et non pour nous-mêmes. Il préfigure ainsi les Lumières, qui vont faire de l’individu la base de la société et non plus l’inverse. « Les états, les charges, et cette tracasserie du monde ne se recherchent plutôt pour tirer du public son profit particulier ». Tout politicien vous dira, la main sur le cœur, qu’il se dévoue à la collectivité – mais n’y trouve-t-il pas quelque satisfaction de vanité et d’orgueil ? Se faire reconnaître dans la rue, se faire écouter et avoir l’illusion de changer ainsi le cours des choses, avoir du pouvoir, ne sont-ce pas là des jouissances aussi fortes que le sexe et l’argent ? « Répondons à l’ambition que c’est elle-même qui nous donne le goût de la solitude », rétorque Montaigne.

Car côtoyer des gens de vices est dangereux pour la sagesse, « la pire part est la plus grande », constate notre philosophe. Et de citer ce « pressant exemple, Albuquerque, vice-roi en l’Inde pour le roi Emmanuel de Portugal, en un extrême péril de fortune de mer [tempête], prit sur ses épaules un jeune garçon, pour cette seule fin qu’en la société de leur fortune [partage de leur sort] son innocence lui servît de garant et de recommandation envers la faveur divine, pour le mettre à sauveté ». Le sage peut être content, seul dans la foule, dit Montaigne « mais, s’il est à choisir, il en fuir, dit-il, même la vue ». Il supportera s’il ne peut faire autrement mais évitera la contagion et la promiscuité des vices : il a déjà assez à faire avec les siens sans prendre de plus en considération ceux des autres !
Ce qui importe, pour le sage – et pour Montaigne – est de « vivre plus à loisir et à son aise ». Les affaires de la cour, celles du marché et celle de la famille, que le Périgourdin appelle joliment « la ménagerie », n’en sont pas moins importunes. Tous les instincts et toutes la passions nous suivent toujours, où que nous allions, en voyage comme au désert, dans les cloîtres comme dans les écoles de philosophie. Socrate dit que l’on s’emporte avec soi. « Notre mal nous tient en l’âme : or elle ne peut échapper à elle-même », dit Montaigne citant Horace. « Ainsi il la faut ramener et retirer en soi : c’est la vraie solitude, et qui se peut jouir au milieu des villes et des cours des rois ». C’est le quant à soi de qui pense par lui-même, le sire de soi des Normands attachés à la personne qui choisit ses allégeances, la reconnaissance de l’être unique créé par Dieu ou par le hasard naturel, l’humain désaliéné des entraves sociales et autant que possibles biologiques. « Faisons que notre contentement dépende de nous ; déprenons-nous de toutes les liaisons qui nous attachent à autrui, gagnons sur nous de pouvoir à bon escient vivre seuls et y vivre à notre aise. » Il y a une quête bouddhiste dans cette voie personnelle que Montaigne reprend au stoïcisme romain. Mesurer la vanité des choses, l’impermanence des rangs, les caprices de le fortune. S’y soustraire volontairement par le pouvoir sur soi contre les trois souffrances.
Chemin difficile, surtout lors de catastrophes. « Stilpon, étant échappé de l’embrasement de sa ville, où il avait perdu femme, enfants et chevance [biens], Démétrios Poliorcète, le voyant en une si grande ruine de sa patrie le visage non effrayé, lui demanda s’il n’avait pas eu de dommage. Il répondit que non et qu’il n’y avait, Dieu merci, rien perdu de sien. » Dur, mais blindé : c’est ainsi que l’on résiste aux forces naturelles, aux guerres, au terrorisme. Ne pas être atteint au fond de soi et recommencer à vivre et à construire. Une sagesse pour notre temps, qui a cru trop longtemps avoir échappé à la nature, aux dictatures et aux fanatiques. « Il faut avoir femme, enfants, biens, et surtout de la santé, qui peut ; mais non pas s’y attacher en manière que notre heur en dépende », explique Montaigne. En notre époque de divorces, de gestation pour autrui, d’orphelins, retrouver cette forme de renoncement est vital.
Cela ne veut pas dire indifférence aux autres ni au monde, mais « il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite et solitude. » Une amie à moi me disait jadis qu’elle était outrée d’une remarque entendue d’une de ses relations : « je ne m’ennuie jamais avec moi-même ». Elle prenait cela pour de l’orgueil, voire de l’égoïsme. C’est pourtant sagesse stoïcienne vantée par Montaigne, et il en cite Tibulle : « Dans la solitude, soyez-vous un monde à vous-même ». Puis de s’exclamer : « Notre mort ne nous faisait pas assez de peur, chargeons-nous encore de celles de nos femmes, de nos enfants et de nos gens. Nos affaires ne nous donnaient pas assez de peine, prenons encore à nous tourmenter et rompre la tête de celles de nos voisins et amis. » J’ai vu moi-même l’exemple déplorable des filles angoissées dans le RER le jour où les terroristes frères Kouachi étaient recherchés par la police après avoir tué ; elles se cramponnaient à leur smartphone pour avoir des nouvelles, sursautant au moindre bruit derrière elles, scrutant les quais aux arrêts de peur de voir surgir des démons en noir, arme à la main. Elles vivaient hors de soi, elles se faisaient un film, elles étaient possédées par leur imagination angoissée.
Il y a un temps pour tout, déclare Montaigne à la suite des Romains et des bouddhistes indiens : un temps pour apprendre, un autre pour vivre, un troisième pour se retirer et méditer. Et de citer Socrate qui « dit que les jeunes se doivent faire instruire, les hommes s’exercer à bien faire, les vieux se retirer de toute occupation civile et militaire, vivant à leur discrétion, sans obligation à nul emploi déterminé ». L’âge mûr venu, « prenons de bonne heure congé de la compagnie ; dépêtrons-nous de ces violentes prises qui nous engagent ailleurs et éloignent de nous » – ce que les politiciens, les chefs d’entreprises ou les chercheurs universitaires ont beaucoup de mal à faire, se croyant toujours indispensables aux affaires.
« La plus grande chose du monde, c’est de savoir être à soi », décrète Montaigne.
Mais il ne faut pas se retirer du monde comme un ermite si l’on ne s’y sent pas, notre sage reste toujours loin de toute radicalité vécue, morale ou politique. « Il se faut servir de ces commodités accidentelles et hors de nous, en tant quelles nous sont plaisantes, mais sans en faire notre principal fondement ; ce ne l’est pas ; ni la raison ni la nature ne le veulent ». La vertu excessive de qui jette tous ses biens, couche à la dure, se crève les yeux ou se châtre n’a rien de vertueux – avis aux écolos mystiques de notre tremps, volontiers imprécateurs d’austérité forcée, surveillée et punie. La vertu exemplaire est plutôt de se contenter de ce que l’on a et d’en être heureux. « Je ne laisse pas, en pleine jouissance, de supplier Dieu, pour ma souveraine requête, qu’il me rende content de moi-même et des biens qui naissent de moi. » Cela dépend du goût de chacun, dit Montaigne mais « ceux qui l’aiment, ils s’y doivent adonner avec modération. » Lui n’aime pas l’administration de sa « ménagerie » mais d’autres si ; lui aime les livres mais pas au point de s’en rebuter par trop d’ascèse : « ne faut point se laisser endormir par le plaisir qu’on y prend ». « Les livres sont plaisants ; mais, si de leur fréquentation nous en perdons en fin la gaieté et la santé, nos meilleurs pièces, quittons-les ». En toute activité, « il faut donner jusqu’aux dernières limites du plaisir, et garder de s’engager plus avant, où la peine commence à se mêler parmi », dit Montaigne.
Ainsi de la randonnée, activité que j’ai beaucoup pratiquée : l’âge venant, le niveau baisse, inutile de vouloir trop en faire. Moi qui ait l’âme commune, dit Montaigne, « il faut que j’aide à me soutenir par les commodités corporelles ; et, l’âge m’ayant dérobé celles qui étaient plus à ma fantaisie, j’instruis et aiguise mon appétit à celles qui restent plus sortables à cette autre saison ».
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Claude Pinganaud), Arléa 2002, 806 pages, €23.50
Michel de Montaigne, Les Essais (mis en français moderne par Bernard Combeau et al.) avec préface de Michel Onfray, Bouquins 2019, 1184 pages, €32.00
Montaigne sur ce blog


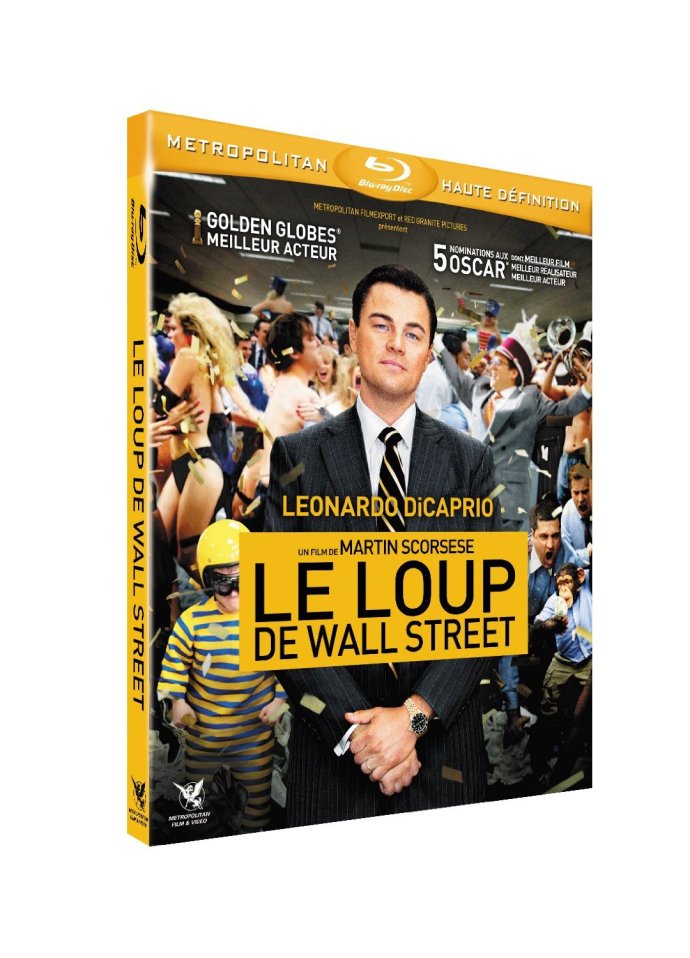
Commentaires récents