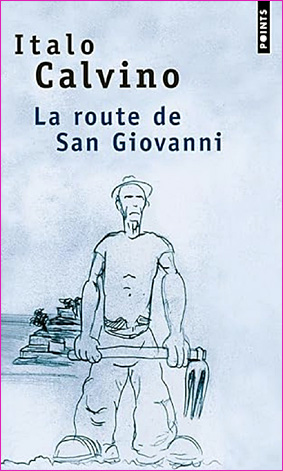
Ce livre est un racolage de cinq récits plus ou moins autobiographiques déjà paru dans des revues, de 1963 à 1977. Il a été publié par sa veuve Esther après la mort de l’écrivain en 1985 à 61 ans d’une hémorragie cérébrale. Une publication somme toute « alimentaire », car ces récits n’ont rien en commun et présentent, pour les trois derniers, une écriture expérimentale peu lisible aujourd’hui – disons-le carrément : « chiante ».
Seul les deux premiers récits sont intéressants.
La route de San Giovanni, qui donne son titre au recueil, porte sur les souvenirs d’enfance avec son père, dans un village près de San Remo. Le père est attaché à la terre, à sa propriété, à sa production ; il ne voit pas plus loin que son terroir, agricole à l’ancienne jusqu’aux bout des ongles. Le fils, né en 1923 et revenu en Italie à l’âge de 2 ans, a grandi dans le fascisme mussolinien et sa propagande. Il voit tout ce que son père a d’ancestral mais aussi d’archaïque. Lui rêve au contraire de grand large, d’ouverture au monde, de la ville plus que de la campagne.
Un exemple de style : « On comprend combien nos routes, celles de mon père et la mienne, divergeaient. Mais quelle était la route que je cherchais, moi aussi, sinon la même que celle de mon père, creusée au cœur d’une autre extranéité, dans le supramonde (ou enfer) humain, qu’est-ce que je cherchais du regard sous les porches mal éclairées dans la nuit (parfois, l’ombre d’une femme y disparaissait) sinon la porte entrouverte, l’écran de cinéma à traverser, la page à tourner qui introduit dans un monde où toutes les figures et les mots pouvaient devenir vrais, présents, mon expérience personnelle, et non plus l’écho d’un écho d’un écho. »
S’il ramène chaque jour les productions du jardin et de la ferme, dans les hauteurs, en parcourant immuablement le même chemin de San Giovanni (Saint Jean), le garçon s’intéresse peu au nom des plantes que son père aime à se remémorer. Il préfère aller à la plage, au cinéma, voir les filles et les gens. Ce contraste entre deux mentalités, et deux générations à cette période charnière du XXe siècle où l’industrialisation et la mondialisation bouleversent les sociétés, est décrit selon la mémoire, donc reconstruit, mais édifiant.
Malgré le fascisme, et sa censure nationaliste à la Poutine, le cinéma est cette porte ouverte sur le monde. C’est l’objet du second récit, Autobiographie d’un spectateur, où le jeune Italo raconte sa boulimie de films, un voire deux par jour en semaine, pris en cours de route par la manie des cinémas italiens d’ouvrir la séance à quiconque désire entrer, même au milieu d’un film. L’adolescent a vu beaucoup de cinéma américain, mais aussi des films français et italiens. Ceux qui lui ont fait le plus d’effet sont les américains, mais il rend grâce à Fellini pour avoir traduit, pour sa génération, les états d’âme de la société italienne bien mieux que les autres.
Le reste du recueil est à oublier, sauf pour les aficionado inconditionnels qui ont tout lu de l’auteur et qui aiment. Le Souvenir d’une bataille de partisans, à laquelle l’auteur a participé dans le nord de l’Italie en 1945, n’est pas un souvenir mais une glose sur comment se souvenir, ce qu’on retient et ce qu’on oublie, en bref un grand « rien ». La poubelle agréée, récit de son rituel vidage de poubelle dans sa petite maison du XIVe arrondissement de Paris où il résidait dans les années 70, ressemble à la névrose du bouton de porte chez Robbe-Grillet – dix pages au moins dans son Nouveau roman – avec une tentative d’analyse sociologique de la société tout à fait dans le ton marxisant de l’époque. Quant à De l’opaque, autant qu’il le reste, je n’ai pu aller au-delà de la troisième page.
Italo Calvino, La route de San Giovanni (La Strada di San Giovanni), 1990, Points Seuil 1998, 175 pages, €7,50 e-book Kindle €7,49

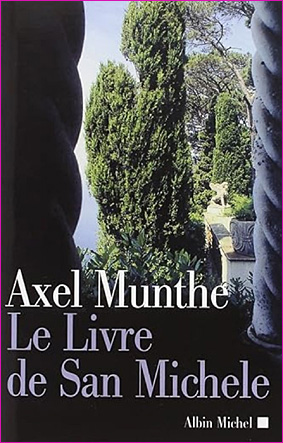
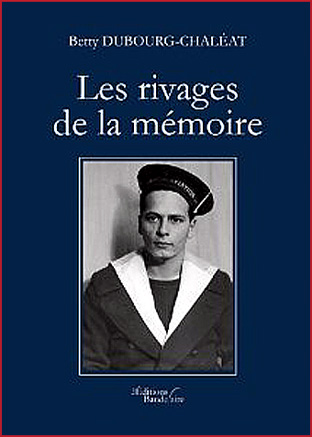
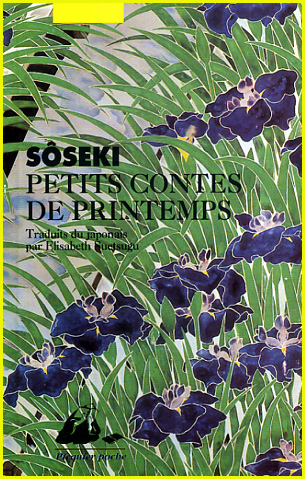



Commentaires récents