
Quatre ans ont passés depuis le retour en Russie du couple Nicolas et Sophie. Avec la naissance du bébé Serge, premier héritier mâle, le vieux Michel, boyard de Katchanovka, met de la voda dans sa vodka* et se précipite à Saint-Pétersbourg où le jeune couple s’est exilé. Mais le bébé est mort à quatre jours d’une probable malformation du cœur. Cependant, Sophie a appris le russe, qu’elle parle avec un accent délicieux. Michel, le père de Nicolas, opposé jusqu’alors au mariage, est séduit. (* de l’eau dans son eau-de-vie)
Il propose à son fils et à sa bru de revenir habiter avec lui à la campagne. Sophie y est favorable, la vie de la capitale ne l’intéresse pas, les mondanités superficielles entre Russes surtout. Nicolas, au contraire, est réticent. Lui aime refaire le monde avec ses amis, réunis dans un cercle étroit d’aristocrates, et qui lancent justement « une société secrète », l’Alliance pour la Vertu et pour la Vérité emplies de mots en majuscule pour faire universel. C’est que les militaires qui ont occupé la France ont été contaminés par les idées occidentales et en reviennent les yeux emplis des Lumières. Les yeux seulement car la Russie est la Russie et le tsar un dieu vivant : nul ne songerait à le remettre en cause, tout au plus une petite constitution… Seuls des radicaux veulent extirper l’absolutisme jusqu’aux racines en zigouillant le tsar et, peut-être sa famille (cela reste à négocier avec les « modérés »), et réaliser l’égalité de tous sans barguigner – autrement dit remplacer un absolutisme par un autre. Toujours totalitaire, la mentalité russe, de l’orthodoxie au Dieu impérieux aux révolutionnaires qui veulent formater le peuple et la nature à leurs idées en passant par le tsar, monarque absolu de droit divin.
Après Les compagnons du coquelicot, chroniqué sur ce blog, où Nicolas a fait la connaissance de Sophie à Paris et l’a ramenée dans ses fourgons, ce tome second des cinq volumes de La lumière des justes est plus intéressant par les portraits contrastés des personnages et l’analyse du pays. Nous plongeons dans la vaste et sainte Russie, fort arriérée et destinée à le rester par son immensité physique, son inertie morale et le poids des traditions où « Dieu » justifie tout (au point que Poutine, deux siècles plus tard, a repris la religion comme un pilier de son régime). « Évidemment, nous n’étions pas encore sortis de chez nous, nous n’avions aucun point de comparaison. Mais, dès qu’on a eu l’imprudence de nous lâcher dans le vaste monde, nous avons compris. Nous sommes allés en France combattre le tyran Bonaparte, et nous en sommes revenus malades de liberté ! – C‘est cela même ! dit Shédrine. Pour ma part, j’ai souffert de retrouver dans ma patrie la misère du peuple, la servilité des fonctionnaires, la brutalité des chefs, les abus de pouvoir ! » p.22.
Sophie va s’en rendre compte à Katchanovka, isolée loin de tout. Elle s’entend à merveille avec son beau-père qui aime sa résistance et fait de sa vie avec elle un jeu d’échecs, jusqu’à la désirer de façon trouble. Il perçoit à l’inverse son fils Nicolas un peu fade et léger. Normal, lui répond Sophie, il a constamment subi votre autorité sans partage ! Même chose avec le tsar, qui ne supporte pas qu’on le conteste, même avec civilité et ménagements. « L’ancien élève de La Harpe [son précepteur vaudois républicain libéral choisi par sa grand-mère Catherine II] vit dans la terreur des doctrines prêchées par les Encyclopédistes. Dès qu’un groupe d’individus redresse la tête, Alexandre découvre dans cet acte d’indépendance la manifestation de l’esprit du mal. La tâche d’un monarque chrétien lui paraît être de veiller à ce que le pouvoir absolu, émanation de la volonté divine, ne soit nulle part menacé. (…) Il rêve de devenir le policier de l’Europe. D’ici à ce que nos régiments soient obligés d’aller rétablir l’ordre partout ou un peuple se soulève contre ce gouvernement, il n’y a pas loin ! » p.134. Écrites par Henri Troyat en 1959, à l’apogée de l’URSS qui lançait le premier satellite artificiel dans l’espace, ces lignes apparaissent prophétiques. S’il n’y a pas d’âmes des peuples, il y a des constantes historiques. Et le conservatisme, l’absolutisme, l’autoritarisme armé, semblent faire partie intégrante de la Russie depuis les Mongols, quel que soit son régime. Remplacez le tsar Alexandre par le président Poutine, et il n’y a rien à changer à la phrase ci-dessus.
Mais Sophie ne renonce pas. Si Nicolas se vautre avec délices dans les grandes idées abstraites tirées de ses lectures de Voltaire, Montesquieu, Rousseau et quelques autres, il ne fait rien de réel. Comploter vaguement entre amis ne change pas la Russie. Sophie préfère le concret. Ainsi va-t-elle visiter les moujiks des villages appartenant au boyard son beau-père. Le jeune serf Nikita de 15 ans, beau blond svelte comme un saule, est en admiration devant elle. Il veut apprendre à lire et à écrire et Sophie convainc le pope de lui donner un livre ; Nikita devra tenir un cahier d’écriture où décrira sa vie quotidienne qu’il destinera à Sophie. Elle constatera ainsi ses progrès. Le jeune homme étant assidu et obstiné, elle l’enlèvera à la terre et en fera un domestique au manoir avant que Michel ne lui confie à 20 ans la comptabilité du domaine avant, à 22 ans et pour l’éloigner de Sophie, de l’envoyer à Saint-Pétersbourg faire sa vie en échange d’un affranchissement prochain. Sophie la barynia, l’épouse du seigneur appelé barine, est pour Nikita comme le tsar pour les Russes : une adoration hors d’atteinte. Il lui est entièrement soumis et dévoué. Les tomes suivants décriront cette passion absolue, jusqu’à la mort.
Entre temps, Nicolas rencontre sa voisine, la veuve Daria Philippovna, mère du jeune Vassia qu’il a connu à 12 ans avant de partir combattre en France. Le jeune homme, fade et malléable, l’admire comme un modèle et Nicolas l’enrôle dans son Alliance pour la Vertu. Ce qui ne l’empêche pas de lutiner sa mère, laquelle est demandeuse car elle n’a encore que 38 ans et que ses filles adolescentes sont amoureuses du beau Nicolas. Sophie ne voit rien, elle n’y prêterait peut-être aucune importance tant son amour est constant. Mais une lettre anonyme adressée à Vassia par le beau-frère de Nicolas, qui lui avait refusé 10 000 roubles, va engendrer un duel, heureusement sans lendemain. Michel est mis au courant, puis Sophie. Le couple se déchire. Car si les moujiks copulent dans les prés, les buissons et les foins pour faire une dizaine d’enfants, le couple des barines ne semble pas pressé de produire des héritiers. Ainsi se reproduit la misère et l’ignorance, tandis que l’aisance et l’intelligence se perdent.
L’auteur se plaît à opposer les deux enfants de l’autocrate boyard Michel : Nicolas comme Marie sa jeune sœur sont faibles à cause de son emprise. Mais Nicolas ramène de France une épouse qui le soutient comme un tuteur ; il n’y a que lorsqu’elle n’est pas auprès de lui qu’il se laisse aller à ses penchants frivoles de gamin égoïste, baisant ici ou là selon son plaisir. A l’inverse, Marie est une fille qui sèche sur pied en ne se sentant pas belle ni bien fagotée ; elle se jette dans la mariage avec le premier venu qui lui fait sentir son emprise pour échapper à son père. Mauvaise pioche : elle sera vite délaissée, réduite à vivoter dans le bourbier campagnard, nantie d’un mioche non désiré. Abandonnée par son père, son mari et par Dieu, elle se suicide en laissant le nourrisson qu’elle a prénommé Serge aux bons soins de Sophie. Qui l’impose à Michel son beau-père.
Ces intrigues nouées promettent de nouvelles aventures pour les tomes suivants. Henri Troyat est un admirable conteur.
Henri Troyat, La barynia – La lumière des justes 2, 1959, J’ai lu 1974, 374 pages, occasion €1,77
Henri Troyat, La lumière des justes : Les compagnons du coquelicot, La Barynia, La gloire des vaincus, Les dames de Sibérie, Sophie et la fin des combats, Omnibus 2011, €31,82
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)
Les romans d’Henri Troyat déjà chroniqués sur ce blog


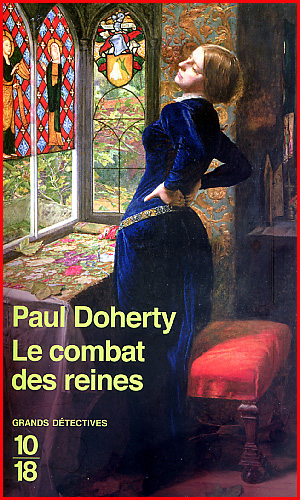
Commentaires récents