Le 10 décembre 1919, il y a un siècle exactement, le prix Goncourt a été attribué à Marcel Proust, 48 ans, né quelques mois seulement après la Commune de Paris. Il est en concurrence avec le célèbre livre de Roland Dorgelès, Les croix de bois, sur la guerre de 14 qui vient de se terminer. Mais les gens en ont assez de la guerre, de l’industrie de la poudre, de la boucherie industrielle, des miasmes des blessures. Le second volume d’A la recherche du temps perdu, intitulé A l’ombre des jeunes filles en fleurs apparaît plus séduisant. Six voix emmenées par Léon Daudet contre quatre lui accordent le prix.
Les salons parisiens puis la petite ville balnéaire normande de Balbec (imaginaire) sont loin du front et de l’univers mâle. Encore que… Rosemonde, Andrée, Albertine, on l’apprendra plus tard dans les archives, sont des garçons. Marcel, qui aimait les hommes, a travesti ses amours en femmes pour écrire les romances que chacun attendait à son époque.
La Lettre de la Pléiade de février, numéro 65, raconte sous la plume de Thierry Laget, auteur d’un Proust prix Goncourt, comment cette annonce fut reçue par le grand malade qu’était Marcel.
« L’équipe de la Nouvelle revue française – Gaston Gallimard, Jacques Rivière et Jean-Gustave Tronche – s’est installée encore plus près, à une table au rez-de-chaussée de Drouant » [le jury Goncourt ripaille et décide dans un salon privé à l’étage] « Les trois hommes sont donc les premiers informés et se précipitent chez Proust, suivis de peu par Léon Daudet, qui saute dans un taxi, direction 44 rue Hamelin. Contraint de quitter son précédent logement, Proust a échoué là le 1er octobre. C’est, au cinquième étage sans ascenseur, ce qu’il appelle un ‘taudis’, ‘un meublé aussi modeste qu’exorbitant de prix’ – seize mille francs ! » [Mais nous sommes dans le 16ème arrondissement… Proust y mourra trois ans plus tard, le 18 novembre 1922, à 51 ans].
« Ce jour-là, il se réveille en début d’après-midi. Les jours de brouillard, il respire plus mal encore. Il a terminé sa fumigation, pris son café et vient de s’assoupir de nouveau lorsque la sonnette retentit. Céleste – ‘grande femme plate ensommeillée’ – va débarricader la porte. Sur le palier, la maison Gallimard, essoufflée d’avoir monté les cinq étages. Conciliabule dans l’antichambre. (…) Gallimard déclare qu’il doit parler à Proust sans tarder. Les trois hommes sont introduits dans le salon et s’installent dans des fauteuils de velours rouge, tandis que la gouvernante va voir si son maître peut recevoir. (…)
« Il règne là un froid de caveau : les calorifères sont fermés, on ne fait jamais de feu. On n’ouvre ni fenêtres ni contrevents. »
« Céleste réveille Proust. C’est la première fois qu’elle ne respecte pas la consigne et se permet d’entrer chez lui sans avoir été appelée. « Monsieur, lui dit-elle, j’ai une grande nouvelle à vous annoncer, qui va sûrement vous faire plaisir… vous avez le prix Goncourt ! » Le laconisme de Proust trahit son émotion ; lui, d’habitude si éloquent, ne parvient à articuler à cet instant-là que la phrase la plus brève de sa vie : « Ah ? »
(…) « Céleste demande si elle peut introduire Gallimard, Rivière et Tronche qui sont « dans un état d’excitation terrible » et veulent lui parler. Proust leur fait dire qu’il n’est pas en état de les recevoir, qu’il les prie de repasser plus tard, dans la soirée ou le lendemain. Céleste transmet le message, mais Gaston insiste. Il doit prendre un train pour Deauville afin d’être, dès le matin, à pied d’œuvre chez (…) son imprimeur d’Abbeville. (…) Céleste explique cela à son maître, qui consent à accueillir les visiteurs. »
« Marcel est couché, tout habillé, dans son lit à barreaux de fer. (…) Il règne dans la pièce une odeur d’oreiller, de renfermé, de pénombre, de fumigations antiasthmatique. (…) Jacques Rivière a noté la joie que Proust éprouve, ce jour-là. « Certainement il aimait sa gloire et en quêtait les moindres signes. » Céleste confirme qu’il est ravi, mais ne le montre pas, car « il était toujours ainsi, égal et maître de lui en toutes circonstances, et ne sortant jamais de son harmonie ». (…)
« Proust congédie enfin ses visiteurs, qui ne sont restés qu’un bref instant dans sa chambre. Puis il appelle Céleste : « Il est probable que l’on va sonner beaucoup à notre porte, car on finira bien par me trouver, dit-il. Je ne veux recevoir personne, surtout pas les journalistes ni les photographes… ils sont dangereux et ils en veulent toujours trop. Mettez tout le monde à la porte. Proust est épuisé. Il fait une crise d’asthme ‘abominable’. »
C’est ainsi que Marcel Proust, probablement le plus grand écrivain français du XXe siècle, a reçu le prix Goncourt qui consacrait le second volume de sa Recherche.
Mais presque aussitôt, les « associations » et la presse se déchaînent. Les anciens combattants, les pacifistes, les réactionnaires comme les révolutionnaires trouvent répugnant que l’on couronne un livre qui ne soit pas du temps présent mais du temps perdu. Que l’on se mette à rêver aux « jeunes filles » alors que tant de jeunes gars se sont fait tuer sur le front. Comme toujours, l’émotion de l’extrême-actualité se croit génie qui va durer. Il n’en est rien. On se souvient de Roland Dorgelès et de ses croix parce que la guerre de 14 reste dans les mémoires ; mais on se souvient bien plus encore de Proust et de ses fleurs, car elles sont littérairement éternelles.
Thierry Laget, Proust prix Goncourt : une émeute littéraire, Gallimard 2019, 272 pages, €19.50 e-book Kindle €13.99
Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Folio Gallimard, €6.80 e-book Kindle €6.49


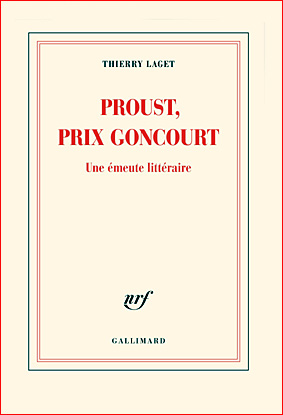


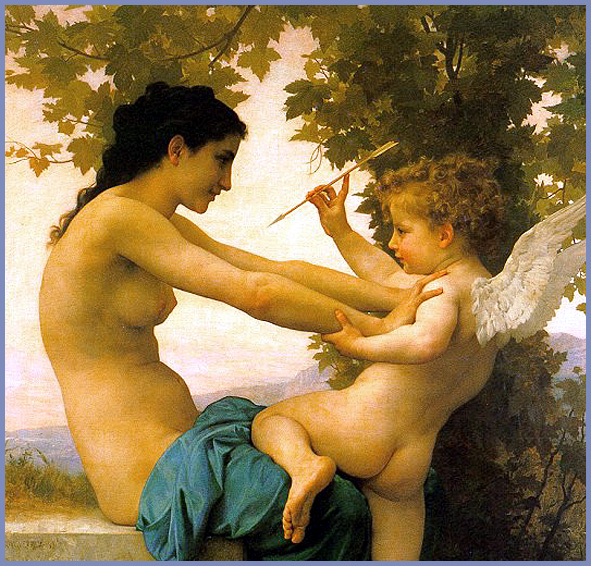
Commentaires récents