Le destin de certains écrivains est de refléter fidèlement leur époque – et d’être oubliés aussitôt après. Bien peu passent à la postérité avec un message universel traversant les générations et les milieux. Michel de Saint-Pierre fut un écrivain catholique fort lu dans les années cinquante ; après 1968, il l’a beaucoup moins été, d’autant qu’il est mort en 1987, à 71 ans. Qui s’en souvient encore ?
Il a pourtant fait partie des premiers à être édité en Livre de poche. Les aristocrates sont plus célèbres que Les murmures de Satan pour avoir fait l’objet d’un film, mais il s’agit bien du même milieu et des mêmes caractères. Nous sommes dans la France catholique traditionnelle qui tente sans grand succès de s’adapter à la modernité. La guerre et la Collaboration ont beaucoup déconsidéré la religion catholique, l’Eglise – sinon les prêtres – s’étant rangés massivement du côté de Pétain qui représentait l’ordre, donc « la volonté de Dieu ». Mai 1968 et ses suites laïcardes et « de gauche » ont achevé la déconstruction, jusqu’aux années récentes où le surgissement d’une autre religion du Livre, dans sa version sectaire et fanatique, a réveillé la Tradition. Relire Michel de Saint-Pierre peut alors aider à comprendre ce monde qui tente de renaître.
Le roman se situe à la fin des années cinquante, une dizaine d’années seulement après la guerre, et met en scène une « communauté » catholique formée par Jean, chef en tout. Chef de famille, chef croyant de la communauté qu’il a formé, chef de projet technique, chef d’entreprise – il est le « saint militant » de la cause chrétienne, celui qui remet en question le confort et les habitudes. Au point de fâcher ses proches, ses enfants, sa femme et son curé. La question est de savoir comment vivre sa foi chrétienne dans la société moderne.
L’auteur ne tranche pas, mais il met en scène le déroulement par chapitres bien séparés comme au théâtre : la pelouse, le dîner, le curé, l’atelier… Jean a la quarantaine et, dans la plénitude de ses facultés, il a engendré cinq enfants, créé son entreprise, inventé des prototypes de matériel électronique, et réuni autour de lui plusieurs couples et célibataires pour vivre ensemble dans la foi – dans le même château. Mais à se vouloir le Christ, il faut en avoir les épaules…
Satan murmure à l’oreille de chacun pour détruire l’élan et déconstruire tout cet échafaudage. La femme de Jean est-elle insensible à la robuste sensualité de Léo, sculpteur de pierre et incroyant, qui aime la chair pour la modeler sous ses mains ? L’inventeur Lemesme, associé à l’entreprise de Jean, n’est-il pas prêt à livrer tous ses secrets pour le seul plaisir de voir ses inventions publiées ? L’entreprise elle-même, perdant l’ouvrier Gros-Louis de maladie, va-t-elle perdurer, inaltérable en créativité, fraternité et production ? L’aumônier de la communauté, sceptique sur la « vie chrétienne » menée par les châtelains, ne reçoit-il pas l’ordre de dissoudre cette expérience hasardeuse, trop hardie pour l’Eglise et trop portée aux tentations mutuelles ? Jusqu’à Jean lui-même, la clé de voûte, qui a des faiblesses coupables pour la jeune Roseline, 15 ans, vue nue dans l’atelier de Léo – il la posséderait bien, après 15 ans de mariage exclusif…
Le lecteur le comprend dès le premier chapitre, c’est bien la chair qui est l’ennemi des catholiques – plus que l’argent. La sensualité affichée par Léo, chemise ouverte sur la naissance d’un torse puissant « lisse comme celui d’un adolescent », fait se pâmer les femmes – même si Léo déclare plusieurs fois à Jean qu’il « l’aime ». Est-ce fraternité chrétienne ou inversion ? Même les enfants, laissés libres puisqu’encore non dressés, révèlent leur goût pour la matière : ils préfèrent jouer dans la boue de l’égout que sur la pelouse trop policée ; de rage après que son anniversaire fut décommandé par des parents trop imbus de leur recherche sur les rats, le jeune Yves, 14 ans, en arrache sa chemise avant de massacrer tous les rongeurs, lézards et fennec de l’appartement où il est délaissé au profit des sales bêtes ; Laura la fille aînée de Jean, 13 ans, commence à jouer de sa féminité et Léo la verrait bien poser pour lui.
Dans cet univers ordonné, chacun doit être à sa place : les hommes, les femmes, les enfants ; ceux qui ont fondé un foyer et les « encore » solitaires (le rester est suspect) ; ceux qui travaillent et ceux qui se contentent de s’y efforcer. Tout grain de sable est alors « satanique ». Le désir, la passion, l’argent, l’abandon, sont autant de murmures que Satan profère pour lézarder la façade et faire retomber l’humain. Au lieu de s’adapter, on résiste – la foi est une et indivisible, elle ne souffre aucune concession. Le lecteur comprend vite que cette société va dans le mur – et qu’elle s’en doute mais ne peut s’en empêcher. « Les gens m’obéissent, me servent et m’aiment », déclare Jean p.129. Jusqu’à ce qu’ils apprennent à être eux-mêmes, et alors… tout s’écroule.
Jean ne peut rien contre la mort de Gros-Louis ; rien contre la décision de la grosse entreprise qui envisage d’acheter son brevet – ou non ; rien contre le désespoir de l’adolescent Yves que les parents ignorent ; rien contre les désirs sexuels suscités par Léo auprès de Carol, de Geneviève et de sa propre femme ; rien contre la volonté de tigresse de celle-ci à défendre le patrimoine de ses cinq petits que le père veut brader par charité chrétienne à n’importe qui ; rien contre son propre désir, violent, pour cette Roseline vierge, « ce corps lisse et frais, ces yeux bleus larges ouverts, où ne paraissait qu’une pureté animale sans appel et sans pudeur – et les petits seins de fillette, la grisante et suave odeur qui s’exhale de l’extrême jeunesse, pimentée, irremplaçable, à en fermer les yeux, soûlante comme un vin à parfum de fleur… » p.146.
Ce que l’on observe, près de soixante ans après que ces lignes furent écrites, est que le catholicisme traditionnel – lui dont le nom signifie « universel » et qui se place sous le signe de l’amour – a très peu d’universel et ne pratique que très peu l’amour. La société est corsetée par des règles de bienséance et une morale rigide, l’amour du prochain est lointain, le plus éthéré possible. Les femmes doivent obéir et les enfants être domptés, les humains doivent se soumettre à la hiérarchie sociale, bénie par l’Eglise qui interprète la volonté de Dieu via les Ecritures. Patriarcale, autoritaire, soumise au catéchisme et volontiers colonialiste (pour le bien des égarés), la société catholique française des années cinquante ainsi décrite a du mal à s’adapter aux changements incessants du monde.
Les désirs s’exacerbent d’être mis sous pression par le couvercle des bienséances, le vêtement entrouvert possède bien plus de pouvoir que le nu intégral. A se vouloir sans cesse autre que l’on est, pur esprit méprisant le corps et ses besoins, on se prépare des lendemains cruels. Satan n’existe que là où existe un pape – sans soupape.
N’est-ce pas péché d’orgueil que de se croire un saint alors que l’on n’est qu’un homme ?
Michel de Saint-Pierre, Les murmures de Satan, 1959, Livre de poche 1964, 252 pages, occasion €2.25

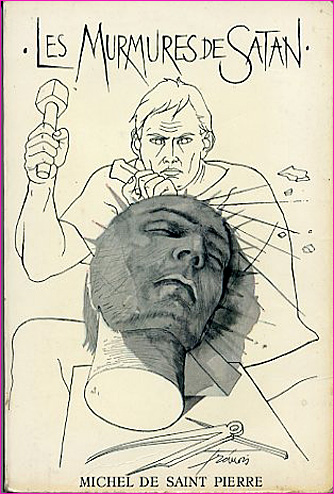







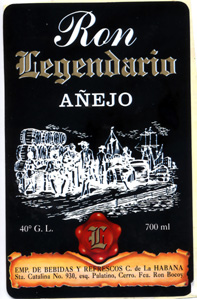

Commentaires récents